|
Jason McGehee doit être exécuté dans l’Arkansas le 27 avril pour un meurtre commis en 1999. Âgé d’à peine 20 ans au moment du crime, il en a aujourd’hui 40. Alors qu’il figurait parmi les trois principaux auteurs de cet homicide, il est le seul qui risque une exécution.
Au cours de l’été 1996, John Melbourne, 15 ans, faisait partie d’un groupe d’amis habitant une maison à Harrison, dans l’Arkansas, et utilisant des chèques falsifiés ou volés. D’après les notes d’audience du procès, le 19 août 1996, croyant que John Melbourne les avait dénoncés à la police, cinq membres du groupe – Candace Campbell (17 ans), Robert Diemart (27 ans), Christopher Epps (19 ans), Ben McFarland (17 ans) et Jason McGehee (20 ans) – l’ont conduit en voiture jusqu’à Omaha, à une trentaine de kilomètres de Harrison. Une fois sur place, John Melbourne a été longuement passé à tabac, puis Christopher Epps, Ben McFarland et Jason McGehee l’ont emmené dans une zone boisée où ils l’ont étranglé à tour de rôle. Dans une déclaration à la police, Ben McFarland a indiqué que c’était lui qui étranglait John Melbourne quand il a succombé. Candace Campbell a été condamnée à 20 ans de prison et Robert Diemart à 10 ans. Le procureur a requis la peine de mort contre les trois autres accusés, et lors de leurs procès, il a qualifié le crime de « meurtre en réunion » et d’« acte commis à plusieurs ». Christopher Epps et Ben McFarland ont été condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Jason McGehee a été jugé le dernier, en janvier 1998. Son procès a duré quatre jours, dont seulement quelques heures pour l’audience consacrée à la détermination de la peine. Le jury a voté en faveur d’une condamnation à mort. En 2008, une cour fédérale de district a statué que le juge de première instance avait eu tort d’empêcher la défense de présenter certains « éléments révélant des violences physiques et psychologiques, des négligences parentales et des événements traumatisants à répétition » qui ont eu lieu pendant « la jeunesse [de l’accusé], d’abord enfant puis adolescent, et ont contribué à former, voire formé entièrement, la personne qu’il est devenu ». Le juge de district a estimé que ces éléments auraient pu conduire le jury à voter contre une condamnation à mort et il a ordonné une nouvelle audience de détermination de la peine. Cependant, en 2009, une cour d’appel a annulé cette décision au motif que les règles de procédure empêchaient les juridictions fédérales d’examiner les éléments en question. Le même juge a présidé les procès des trois accusés encourant la peine de mort. Aujourd’hui retraité, il a appelé à la commutation de la condamnation à mort de Jason McGehee. Dans une lettre datée du 15 mars 2017, il a écrit que la mort de John Melbourne était « le résultat tragique d’une dynamique de groupe qui a mal tourné » et que cette dynamique avait « abouti à quelque chose que Jason n’aurait jamais fait individuellement ». Étant donné que Ben McFarland a bénéficié en janvier 2017 d’une réduction de sa peine de la perpétuité réelle à 40 années, ce qui lui permettra de demander une libération conditionnelle à partir de 2025, et au vu de « l’extraordinaire adaptation à la prison » de Jason McGehee, ce magistrat considère aujourd’hui sa condamnation à mort comme « excessive ». La commutation est également demandée par un ancien directeur de l’administration pénitentiaire de l’Arkansas, qui a souligné la conduite « exemplaire » de Jason McGehee dans le couloir de la mort et son dossier disciplinaire « remarquable ». Cet homme a indiqué que, durant les 40 années où il a travaillé dans les prisons, il n’a « vu aucun dossier de détenu comparable à celui de Jason ». Selon lui, il « pourrait très bien se comporter au sein de la population générale ». DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, et que vous rédigerez (en anglais ou dans votre propre langue) en utilisant vos propres mots : - appelez les autorités à faire preuve de clémence envers Jason McGehee et à commuer sa condamnation à mort ; - soulignez son jeune âge au moment du crime, les témoignages faisant état de son évolution depuis lors et le fait que le jury n’a pas été informé de certaines circonstances atténuantes incontestables ayant trait à l’enfance de l’accusé ; - faites remarquer que le juge qui a présidé les procès des trois accusés encourant la peine de mort estime que la condamnation à mort de Jason McGehee est disproportionnée, et que ce magistrat et un ancien directeur de l’administration pénitentiaire sont favorables à une mesure de clémence. ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 27 AVRIL 2017 À : Gouverneur de l’Arkansas The Honorable Asa Hutchinson, Governor of the State of Arkansas State Capitol, Suite 250, 500 Woodlane St, Little Rock, AR 72201, États-Unis Fax : +1 501 682 3597 Courriel : http://governor.arkansas.gov/contact-info/ (coordonnées aux États-Unis nécessaires) ; ou (en demandant que le message soit transmis au gouverneur) Formule d’appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur, *Pour ceux à l'extérieur des États-Unis désirant agir via le site Internet, veuillez utiliser l'adresse du bureau de Washington d'AI États-Unis : 600 Pennsylvania Ave. SE, 5th Floor Washington, D.C. Zip Code: 20003 Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays. Copies à : Ambassadeur des États-Unis Ambassadeur Bruce A. Heyman Ambassade des États-Unis 490, chemin Sussex Ottawa, Ontario K1N 1G8, Canada Télécopieur : 613-688-3082 Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. COMPLÉMENT D’INFORMATION Dans son arrêt de 2005 interdisant la peine de mort pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment du crime, la Cour suprême des États-Unis a reconnu l’immaturité, l’impulsivité, le manque de discernement et de sens des responsabilités et la sensibilité aux pressions extérieures qui caractérisent souvent les jeunes, ainsi que leur capacité de réinsertion et d’évolution positive. Elle a également relevé que « les traits caractéristiques qui distinguent les mineurs des adultes ne disparaissent pas le jour des 18 ans d’un individu ». Des études scientifiques continuent de montrer que le développement du cerveau et le processus de maturation psychologique et émotionnelle se poursuivent bien après le dix-huitième anniversaire d’une personne, parfois jusqu’à la fin de la vingtaine. D’après un article d’un expert indépendant consacré aux jeunes adultes et au système judiciaire, publié en 2015 par l’Institut national de la justice (un organe de ministère fédéral de la Justice) : « Les jeunes adultes sont différents des adultes plus âgés sur le plan du développement. Les récents travaux scientifiques donnent à penser que le cerveau humain continue de se développer pendant une bonne partie de la vingtaine, notamment dans la région du cortex préfrontal, qui régule la maîtrise des pulsions et le raisonnement. Plusieurs études tendent à indiquer que l’on n’acquiert une capacité décisionnelle digne d’un adulte qu’à la fin de la vingtaine, et d’autres ont montré que les aptitudes psychosociales continuent de se développer même au cours de l’âge adulte [...]. En raison de [cette différence de maturité], les jeunes adultes sont plus susceptibles de se livrer à des comportements à risque, ont des difficultés à modérer leurs réactions dans des situations à forte charge émotionnelle ou n’ont pas encore fini d’élaborer une méthode de prise de décisions orientée vers l’avenir. » Quand l’avocat de Jason McGehee a tenté de présenter lors du procès certains éléments relatifs à l’enfance de l’accusé, le procureur a élevé une objection. Le juge a alors déclaré que ces éléments ne relevaient pas des circonstances atténuantes et a refusé qu’ils soient présentés au jury. Dans son arrêt de 2008, pourtant, la cour fédérale de district a estimé que ces éléments « n’étaient ni vagues ni ténus » mais concernaient « précisément M. McGehee, son enfance et les événements traumatisants qui ont eu lieu au cours des vingt années précédant le crime ». Elle a noté que des éléments de ce type étaient « régulièrement présentés » lors de procès où l’accusé encourt la peine capitale et avaient été « jugés admissibles » par la cour suprême de l’Arkansas et celle des États-Unis. Dans le cas présent, tous les événements traumatisants et les violences évoqués « lui étaient arrivés directement ou avaient eu lieu en sa présence » et « avaient certainement contribué à en faire le jeune homme qu’il était devenu ». En raison du fait que l’accusé était âgé de 20 ans à l’époque du crime, « ces événements n’étaient pas trop éloignés dans le temps » pour être pertinents et « auraient pu inciter à la clémence » s’ils avaient été présentés au jury. En 2002, la cour suprême de l’Arkansas a rejeté l’argument selon lequel la condamnation à mort de Jason McGehee était disproportionnée par rapport aux peines de réclusion à perpétuité de ses deux coaccusés. Elle a indiqué que « l’examen de la proportionnalité relative n’[était] pas prévu par la Constitution » et que le « contrôle obligatoire du caractère arbitraire » était assuré par l’audience consacrée à la détermination de la peine, au cours de laquelle le jury est informé des circonstances aggravantes ou atténuantes. Néanmoins, elle a souligné que, au cours des quatre décennies précédentes, il était apparu « de plus en plus clairement que la peine de mort est imposée arbitrairement », c’est-à-dire « sans la cohérence minimum juridiquement nécessaire pour rendre son utilisation conforme aux exigences de la Constitution », comme l’a également relevé Stephen Breyer, juge à la Cour suprême fédérale, en juin 2015. Comme de nombreux autres États, l’Arkansas rencontre des difficultés pour se procurer les produits chimiques nécessaires aux exécutions par injection létale et pour appliquer des protocoles respectant, selon les juges, les critères de conformité à la Constitution. Le 23 juin 2016, la cour suprême de l’Arkansas a validé la méthode d’exécution par injection de trois substances, selon laquelle les autorités pénitentiaires choisissent soit un barbiturique soit le midazolam comme sédatif, puis utilisent du bromure de vecuronium comme agent paralysant, et enfin du chlorure de potassium pour provoquer un arrêt cardiaque entraînant la mort. À la suite du refus de la Cour suprême fédérale d’intervenir en février 2017, le gouverneur Hutchinson a fixé des dates d’exécution pour les huit hommes au nom desquels le recours judiciaire contre le protocole d’injection létale avait été déposé : Don Davis et Bruce Ward doivent être exécutés le 17 avril ; Ledelle Lee et Stacey Johnson, le 20 avril ; Marcel Williams et Jack Jones, le 24 avril ; et Jason McGehee et Kenneth Williams, le 27 avril (voir https://www.amnesty.org/fr/documents/amr51/5816/2017/fr/). Six exécutions ont déjà eu lieu cette année aux États-Unis, ce qui porte à 1 448 le nombre de personnes auxquelles les autorités de ce pays ont ôté la vie depuis la reprise de cette pratique en 1977, après l’approbation de la nouvelle législation relative à la peine capitale par la Cour suprême fédérale en 1976. La dernière exécution recensée en Arkansas – la 27e depuis 1977 dans cet État – a eu lieu en 2005. Amnistie internationale s’oppose catégoriquement à la peine de mort, en toutes circonstances et dans tous les pays.
0 Commentaires
Paul Storey, 32 ans, doit être exécuté au Texas le 12 avril. Parmi les personnes qui appellent à la clémence figurent les parents de l’homme qu’il est accusé d’avoir tué en 2006. L’un des jurés qui ont voté en faveur de sa condamnation à mort s’oppose également à son exécution.
Le 16 octobre 2006, Jonas Cherry, 28 ans, a été tué par balle au cours d’un vol à main armée au parc de loisirs Putt-Putt Golf and Games à Hurst, au Texas, où il était responsable adjoint. Deux jeunes hommes, Mark Porter, 20 ans, et Paul Storey, alors âgé de 22 ans, ont été inculpés de meurtre passible de la peine capitale. Chacun s’est vu proposer un accord par le ministère public, aux termes duquel il serait condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle s’il acceptait de plaider coupable. Mark Porter a accepté cet accord et a été condamné à la perpétuité en 2008. Paul Storey l’a refusé. Il a alors été jugé et condamné à mort. Il est incarcéré dans le couloir de la mort depuis le 25 novembre 2008. Lors de la phase du procès consacrée à la détermination de la peine, son avocat n’a présenté aucun témoignage d’expert en psychologie. Il a surtout fait appel à des membres de la famille de l’accusé en tant que témoins de moralité. Une psychologue engagée par ses avocats en appel en 2010 a constaté qu’il existait de « nombreuses circonstances atténuantes » qui auraient dû être présentées au jury, notamment les antécédents familiaux de grave dépression du côté de la mère de Paul Storey, ses propres épisodes dépressifs et ses capacités intellectuelles limitées. Elle a conclu que ces informations relatives à ses «limites intellectuelles, sa suggestibilité, sa tendance à suivre les autres et son manque de ressources pour faire face au stress (dû à de multiples facteurs) auraient pu constituer des arguments en termes de circonstances atténuantes». Au sujet de sa dangerosité future, la psychologue a écrit: «Les données disponibles au moment où il a été condamné montraient que M. Storey présentait globalement un faible risque de faire du mal à autrui.» En 2010, l’un des jurés du procès a signé une déclaration sous serment après avoir lu ce compte rendu. Il a expliqué: «Avec ces nouvelles informations, je suis certain que je n’aurais pas voté en faveur d’une condamnation à mort», et que «j’aurais voté que M. Storey ne représentait pas un danger futur». Le dossier de recours en grâce de Paul Storey souligne que, lors de l’audience de détermination de la peine, le procureur a affirmé au jury: «Si toute la famille [de l’accusé] est venue ici hier vous supplier d’épargner sa vie, il va sans dire que toute la famille de Jonas [Cherry] et tous ceux qui l’aimaient pensent que la peine de mort est adaptée.» Les parents de Jonas Cherry ont récemment écrit aux autorités pour les appeler à commuer cette condamnation à mort. Ils ont également enregistré une vidéo, dans laquelle ils expliquent: «Nous ne voulons absolument pas que Paul Storey soit exécuté pour le meurtre de notre fils et demandons que sa peine soit commuée en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.» La mère de Jonas Cherry a déclaré: «Cela nous fait de la peine de penser que, à cause de la mort de notre fils, une autre personne va être volontairement mise à mort», ce qui fera souffrir une autre famille. Elle a ajouté: «Une exécution ne nous apportera pas l’apaisement par rapport à la mort de Jonas, mais de la douleur en plus.» DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais ou dans votre propre langue (en précisant le matricule de Paul Storey, #999538) : - demandez l’annulation de l’exécution de Paul Storey et la commutation de sa peine de mort ; - faites remarquer que l’un des jurés a déclaré qu’il n’aurait pas voté en faveur de la peine de mort si le jury avait été informé des circonstances atténuantes révélées en appel, ce qui aurait suffi à obtenir une peine de réclusion à perpétuité, que le ministère public avait proposée aux deux coaccusés ; - soulignez que les parents de Jonas Cherry ont appelé à la commutation de la condamnation à mort de Paul Storey. ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 12 AVRIL 2017. Comité des grâces et des libérations conditionnelles du Texas Clemency Section, Board of Pardons and Paroles, 8610 Shoal Creek Blvd. Austin, Texas 78757-6814 États-Unis Télécopieur : +1 512 467 0945 Courriel : Formule d’appel : Dear Board members, / Mesdames, Messieurs, Gouverneur du Texas Governor Greg Abbott Officer of the Governor PO BOX 12428 Austin, Texas 78711-2428 États-Unis Télécopieur : +1 512 463 1849 Courriel : https://gov.texas.gov/contact/assistance.aspx Formule d’appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur, Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays. Ambassadeur des États-Unis Ambassadeur Bruce A. Heyman Ambassade des États-Unis 490, chemin Sussex Ottawa, Ontario K1N 1G8, Canada Télécopieur : 613-688-3082 Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. COMPLÉMENT D’INFORMATION Sur les 1448 exécutions auxquelles ont procédé les États-Unis depuis la reprise de cette pratique en 1977 après l’approbation de nouvelles lois relatives à la peine capitale par la Cour suprême fédérale en 1976, 37% (542) ont eu lieu au Texas. Le système d’application de la peine capitale aux États-Unis est frappé au coin de l’arbitraire, entaché de discrimination et marqué par des erreurs. Aux termes de la Constitution, ce châtiment est réservé aux crimes les plus graves et aux accusés déclarés coupables au plus haut degré mais, dans les faits, il est souvent prononcé lorsque les personnes mises en cause ne disposent pas des ressources suffisantes pour préparer une défense efficace ou lorsque le lieu du crime relève de la compétence d’un parquet plus volontariste en ce qui concerne le recours à la peine capitale ou doté de moyens lui permettant de l’infliger plus fréquemment que d’autres. Cette inégalité géographique du système se retrouve au Texas. À titre d’exemple, 40 personnes ont été exécutées depuis 1976 après avoir été jugées dans le comté de Tarrant, au Texas, où s’est déroulé le procès de Paul Storey. Seuls 10 États entiers ont procédé à plus de 40 exécutions au cours des 40 dernières années. Au Texas, pour qu’une condamnation à mort puisse être prononcée, il faut que le jury estime que l’accusé commettrait probablement de futurs actes de violence qui feraient de lui une «menace permanente pour la société» si on le laissait en vie. Si les jurés ne répondent pas unanimement par l’affirmative à cette question de la «dangerosité future», le juge doit prononcer une peine de réclusion à perpétuité. Le jury doit également examiner s’il existe suffisamment d’éléments atténuants pour justifier le choix de la réclusion à perpétuité plutôt que de la peine de mort. Si les jurés ne sont pas unanimes pour répondre «non» à cette question, c’est également la réclusion à perpétuité qui s’applique. En 2015, deux juges de la Cour suprême des États-Unis, Stephen Breyer et Ruth Bader Ginsburg, ont estimé qu’il était temps de réexaminer la constitutionnalité de la peine de mort dans le pays, compte tenu des éléments attestant son caractère arbitraire et son manque de fiabilité. Parmi les sources d’incohérence ou d’erreur, selon eux, figurait le processus de sélection des jurés: «Aucune personne ne peut participer à un jury dans une affaire où l’accusé encourt la peine capitale si elle n’est pas prête à prononcer la peine de mort», a écrit le juge Breyer, qui a noté qu’un demi-siècle de recherches, dont il a cité certaines conclusions, avait «démontré que les critères de sélection des jurés orientent les jurys vers un verdict de culpabilité et une condamnation à mort». Lors de la sélection du jury, la défense et l’accusation interrogent les jurés potentiels et peuvent en récuser un certain nombre, en exposant leurs motifs (récusation pour cause) ou non (récusation péremptoire). En vertu d’un arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1968, les citoyens qui se sont «irrévocablement engagés» à voter contre la peine capitale peuvent être récusés pour cause par le ministère public. En 1985, la Cour a assoupli la règle, élargissant ainsi la catégorie des jurés potentiels susceptibles d’être récusés pour cause. Depuis lors, un juré peut être récusé pour cause si son avis sur la peine de mort «empêche ou entrave considérablement l’exercice de ses fonctions de juré conformément à ses instructions et son serment». En 1986, la Cour suprême a reconnu l’existence de conclusions d’études montrant que les critères de sélection des jurés pour les procès dans lesquels l’accusé encourt la peine de mort «produisent des jurys plus enclins à condamner» que ceux qui ne sont pas sélectionnés selon leur avis sur la peine capitale. En 2016, le juré qui a signé une déclaration sous serment en 2010 a exposé ses souvenirs de la délibération du jury au procès de Paul Storey: «Je sais que nous n’avons pas délibéré longtemps – une à deux heures, peut-être. La salle était très silencieuse ; on aurait dit que tout le monde était entré en sachant déjà comment voter. Tous les autres jurés pensaient qu’il devait être mis à mort. Si j’avais pu faire quelque chose, cela aurait été de mettre le jury dans l’impasse, mais je n’avais pas la force de caractère pour le faire. J’avais 28 ans, et je n’étais pas très mûr pour mon âge. J’ai beaucoup grandi depuis, mais à l’époque, j’avais vraiment du mal à m’affirmer.» La cour d’appel au niveau de l’État a refusé de prendre en compte sa déclaration sous serment en vertu des règles d’administration de la preuve applicables au Texas, et lorsque la cour fédérale de district a confirmé la condamnation à mort en 2014, le juge a précisé qu’il n’avait «donné aucun poids à cette déclaration sous serment» car il n’avait pas été démontré que la juridiction d’État avait agi de façon déraisonnable en refusant de la prendre en compte. Six exécutions ont déjà eu lieu cette année aux États-Unis, dont quatre au Texas. Amnistie internationale s’oppose catégoriquement à la peine de mort, en toutes circonstances. À l’heure actuelle, 141 pays sont abolitionnistes en droit ou dans la pratique. Jack Jones, 52 ans, doit être exécuté dans l’Arkansas le 24 avril pour un meurtre commis en 1995. Les jurés qui l’ont condamné à mort ne savaient pas qu’il avait été diagnostiqué comme atteint de troubles bipolaires, une grave maladie mentale, peu avant le crime.
Le 6 juin 1995, Mary Phillips, 34 ans, a été victime d’un vol et d’un viol avant d’être tuée au cabinet comptable où elle travaillait à Bald Knob, dans l’Arkansas. Sa fille de 11 ans, qui était présente, a été étranglée, rouée de coups et laissée pour morte, mais a survécu. En avril 1996, Jack Jones, alors âgé de 31 ans, a été déclaré coupable de meurtre passible de la peine capitale, de viol et de tentative de meurtre passible de la peine capitale. Au cours de la phase du procès consacrée à la détermination de la peine, le jury a été informé de la réaction négative de l’accusé à la prise de Ritalin, un médicament destiné à traiter les troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), lorsqu’il était enfant. Ces éléments ont été fournis en grande partie par la soeur de Jack Jones, et non par un spécialiste. Un médecin appelé à la barre par la défense a indiqué que Jack Jones avait tenté de se suicider à plusieurs reprises, que son TDAH était passé avec l’âge et qu’il convenait désormais mieux de le décrire comme présentant une personnalité antisociale. Un autre expert témoignant pour la défense a certifié que Jack Jones n’était pas atteint de troubles bipolaires. Ce médecin, qui avait cessé d’exercer deux ans auparavant lorsqu’il avait entamé une cure de désintoxication à la suite de problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie, a affirmé qu’il avait prescrit des antidouleurs à Jack Jones mais qu’il ne se souvenait pas quand ni lesquels, et qu’il n’avait pas consulté d’autres médecins ayant traité l’accusé quant à leurs diagnostics. Le jury a condamné Jack Jones à la peine de mort. Cependant, le jury n’a pas été informé que, quelques mois avant le crime, Jack Jones s’était présenté de lui-même à un hôpital où on lui avait diagnostiqué des troubles bipolaires (autrefois appelés « maladie maniaco-dépressive »), une grave maladie mentale. Le compte rendu d’examen indiquait qu’il ressentait « beaucoup d’idées suicidaires, en imaginant de nombreuses façons de se faire du mal ». Puis, le 8 mai 1995, moins d’un mois avant le crime, il a de nouveau été diagnostiqué comme atteint de troubles bipolaires, et le médecin ayant procédé à l’évaluation a même relevé une « bipolarité extrême ». Quatre ans auparavant, il avait été hospitalisé d’office dans un service psychiatrique après une tentative de suicide dans l’État de l’Ohio. À l’époque, il avait été diagnostiqué comme atteint d’un trouble schizo-affectif avec dépression. Il avait déjà tenté de se suicider en 1989. En 2005, un expert spécialiste des circonstances atténuantes a procédé à une évaluation de la recherche et de la présentation d’éléments atténuants par la défense lors du procès. Il a conclu que la prestation de son avocat à l’audience de détermination de la peine avait été « bien en-deçà des normes attendues d’un avocat dans une affaire où l’accusé encourt la peine capitale, en passant à côté des principaux thèmes de la vie de M. Jones, en soumettant des éléments psychologiques négatifs quand une multitude de témoins auraient pu présenter un récit social probant, et en ne présentant pas, au fond, une plaidoirie pour la vie ». Il a affirmé que les éléments disponibles laissaient penser que Jack Jones avait été mal diagnostiqué comme atteint de TDAH et qu’il s’agissait plus probablement d’un « début de troubles bipolaires pendant l’enfance ». Il a en outre souligné que Jack Jones avait « commencé à consommer des drogues illicites à un âge précoce afin d’améliorer les symptômes de sa maladie mentale », un phénomène fréquent, selon lui, chez les enfants et adolescents atteints de troubles bipolaires non traités. DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais ou dans votre propre langue : - appelez les autorités à faire preuve de clémence envers Jack Jones et à commuer sa condamnation à mort ; - dites-vous préoccupé-e par le fait que le jury n’a jamais été informé que Jack Jones avait été diagnostiqué comme atteint de troubles bipolaires, une grave maladie mentale, au cours des mois ayant précédé le crime ; - expliquez que vous ne cherchez aucunement à excuser le crime violent dont il est question dans cette affaire, ni à minimiser les souffrances qu’il a causées. ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 24 AVRIL 2017 À : Gouverneur de l’Arkansas The Honorable Asa Hutchinson, Governor of the State of Arkansas State Capitol, Suite 250, 500 Woodlane St, Little Rock, AR 72201, États-Unis Télécopieur : +1 501 682 3597 Courriel : http://governor.arkansas.gov/contact-info/ (coordonnées aux États-Unis nécessaires) Formule d’appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur, *Pour ceux à l'extérieur des États-Unis désirant agir via le site Internet, veuillez utiliser l'adresse du bureau de Washington d'AI États-Unis : 600 Pennsylvania Ave. SE, 5th Floor Washington, D.C. Zip Code: 20003 Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays. Ambassadeur des États-Unis Ambassadeur Bruce A. Heyman Ambassade des États-Unis 490, chemin Sussex Ottawa, Ontario K1N 1G8, Canada Télécopieur : 613-688-3082 Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. COMPLÉMENT D’INFORMATION Lorsque la cour suprême de l’Arkansas a confirmé le verdict de culpabilité et la condamnation à mort de Jack Jones en 1997, elle a noté que le jury avait retenu à l’unanimité trois circonstances atténuantes : il avait coopéré avec la police en se rendant de lui-même au poste de police ; il avait fait des aveux complets et accepté la pleine responsabilité des crimes ; et il avait connu une « enfance agitée et tourmentée ». Elle a en revanche constaté que le jury avait rendu des « conclusions variables » quant aux autres éléments atténuants, notamment sur le fait que Jack Jones « souffrait d’une maladie mentale ou de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité » et que « malgré ses efforts, M. Jones avait été mal diagnostiqué et traité avec des médicaments inadaptés à plusieurs reprises ». Cette juridiction a estimé qu’on ne pouvait pas savoir, à la lecture du formulaire remis par le jury, si « certains ou aucun des jurés avaient conclu que ces facteurs constituaient des circonstances atténuantes ». Elle a toutefois statué que les contradictions figurant dans le formulaire du jury étaient « anodines ». Personne ne lui a demandé, et elle n’a pas vérifié, si les conclusions variables étaient liées à une insuffisance de la part de la défense dans la recherche et la présentation de circonstances atténuantes. Cette question n’a guère été abordée lors des procédures en appel devant les juridictions d’État, et Jack Jones n’a pas pu bénéficier d’une audience fédérale lorsque les juridictions d’appel fédérales ont été saisies de l’affaire. Le droit international et les normes internationales sur le recours à la peine capitale énoncent clairement que ce châtiment ne peut pas être imposé ou appliqué à des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un handicap mental. Cela est valable y compris si un tel trouble est diagnostiqué après la survenance des faits reprochés à la personne condamnée. Étant donné le caractère irréversible de la peine capitale, les procédures dans les affaires où elle peut être prononcée doivent être rigoureusement conformes à toutes les normes internationales garantissant le droit à un procès équitable, quelle que soit la gravité du crime commis. Toute personne qui encourt la peine de mort doit bénéficier des services d’un avocat compétent à tous les stades de la procédure. De plus, toutes les circonstances atténuantes doivent être prises en compte. Comme de nombreux autres États, l’Arkansas rencontre des difficultés pour se procurer les produits chimiques nécessaires aux exécutions par injection létale et pour appliquer des protocoles respectant, selon les juges, les critères de conformité à la Constitution. Le 23 juin 2016, la cour suprême de l’Arkansas a validé la méthode d’exécution par injection de trois substances, selon laquelle les autorités pénitentiaires choisissent soit un barbiturique soit le midazolam comme sédatif, puis utilisent du bromure de vecuronium comme agent paralysant, et enfin du chlorure de potassium pour provoquer un arrêt cardiaque entraînant la mort. À la suite du refus de la Cour suprême fédérale d’intervenir en février 2017, le gouverneur Hutchinson a fixé des dates d’exécution pour les huit hommes au nom desquels le recours judiciaire contre le protocole d’injection létale avait été déposé : Don Davis et Bruce Ward doivent être exécutés le 17 avril ; Ledelle Lee et Stacey Johnson, le 20 avril ; Marcel Williams et Jack Jones, le 24 avril ; et Jason McGehee et Kenneth Williams, le 27 avril (voir https://www.amnesty.org/fr/documents/amr51/5816/2017/fr/). Six exécutions ont déjà eu lieu cette année aux États-Unis, ce qui porte à 1 448 le nombre de personnes auxquelles les autorités de ce pays ont ôté la vie depuis la reprise de cette pratique en 1977, après l’approbation de la nouvelle législation relative à la peine capitale par la Cour suprême fédérale en 1976. La dernière exécution recensée en Arkansas – la 27e depuis 1977 dans cet État – a eu lieu en 2005. Amnistie internationale s’oppose catégoriquement à la peine de mort, en toutes circonstances et dans tous les pays. À l’heure actuelle, quelque 141 pays sont abolitionnistes en droit ou dans la pratique. Stacey Johnson, 47 ans, doit être exécuté dans l’Arkansas le 20 avril pour un meurtre commis en 1993. Trois juges de la cour suprême de l’Arkansas ont estimé qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable car il n’avait pas eu accès à des informations concernant la fiabilité d’un témoin essentiel de l’accusation.
Le 2 avril 1993, le corps de Carol Heath a été retrouvé dans son appartement à DeQueen, dans l’Arkansas. Elle avait la gorge tranchée et d’autres blessures. Sa fille de six ans a déclaré qu’un homme noir avec un « nom de fille » était venu à leur domicile, que lui et sa mère s’étaient battus et qu’il avait un couteau. La fillette a désigné Stacey Johnson parmi une série de photos représentant sept hommes noirs qui lui a été montrée par des policiers. Celui-ci a été arrêté le 14 avril 1993 au Nouveau-Mexique et conduit dans le comté de Sevier, dans l’Arkansas, pour être jugé. Il a été déclaré coupable du meurtre et condamné à mort en 1994. En appel, en 1996, la cour suprême de l’Arkansas a ordonné un nouveau procès au motif que le témoignage de la police au sujet de l’identification de l’accusé par la fillette (que le juge avait déclarée inapte à témoigner) constituait une preuve par ouï-dire irrecevable. L’avocat de Stacey Johnson a requis un renvoi du procès devant une autre juridiction en raison de son grand retentissement. Le juge a accepté ce dépaysement mais a choisi le comté de Pike au lieu de celui de Little River, qui avait été demandé. L’avocat a contesté ce choix, en soulignant que la population du comté de Pike comportait un pourcentage bien plus faible de citoyens noirs (3 % des électeurs inscrits contre 19 % dans celui de Little River), alors qu’il s’agissait d’une affaire où l’accusé était noir et la victime blanche. Le nouveau procès a néanmoins eu lieu dans le comté de Pike en 1997, devant un jury dont un seul membre était afro-américain. La fille de la victime, alors âgée de 10 ans, a été déclarée apte à témoigner et est devenue un témoin essentiel de l’affaire. Stacey Johnson a de nouveau été déclaré coupable et condamné à mort. En 2000, la cour suprême de l’Arkansas a confirmé de justesse le verdict de culpabilité et la condamnation à mort. Trois des sept juges qui la composaient ont rendu un avis divergent. Ils ont relevé que la fille de la victime suivait une psychothérapie depuis le meurtre. Avant le premier procès, sa tutrice légale avait levé le secret des communications entre thérapeute et patient pour la psychologue en question. Cette dernière a certifié lors d’une audience sur son aptitude à témoigner que l’état de santé mentale de la fillette se dégraderait si on la faisait témoigner et qu’elle ne se souvenait pas exactement de ce qui s’était passé un an auparavant. Entre 1996 et 1998, la fillette a été traitée par une autre thérapeute. Lors du nouveau procès de 1997, sa tutrice a refusé de lever le secret professionnel pour cette thérapeute. Par conséquent, l’avocat de Stacey Johnson n’a pas pu accéder à ses notes. S’il avait pu les consulter, ont estimé les trois juges, « il aurait pu fouiller dans les conclusions [de la thérapeute] indiquant que les récits [de la fillette] étaient profondément incohérents et qu’elle subissait une pression considérable de la part de sa famille et du procureur pour faire condamner Stacey Johnson », informations qui auraient pu apporter « un tout nouvel éclairage permettant de contester la fiabilité du témoignage [de la fillette] ». Ils ont également écrit : « Si un patient est autorisé à faire son choix entre plusieurs professionnels amenés à témoigner et peut, au nom du secret professionnel, empêcher que des éléments remettant un témoin en cause soient dévoilés au tribunal, il peut s’agir d’une parodie de justice. » Un tel « choix », ont-ils poursuivi, est « exactement ce qui s’est produit » dans ce cas et Stacey Johnson s’est retrouvé « paralysé » pour son contre-interrogatoire de ce témoin, pour assurer sa défense en général et « a donc été privé de son droit à un procès équitable ». DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais ou dans votre propre langue : - appelez les autorités à faire preuve de clémence envers Stacey Johnson et à commuer sa condamnation à mort ; - mettez en avant l’utilisation sélective du secret des communications entre thérapeute et patient, qui a entraîné selon trois juges de la cour suprême de l’Arkansas l’iniquité du procès en empêchant la défense d’accéder à des informations concernant la fiabilité d’un témoin essentiel de l’accusation ; - expliquez que vous ne cherchez aucunement à excuser le crime violent dont il est question dans cette affaire, ni à minimiser les souffrances qu’il a causées. ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 20 AVRIL 2017 À : Gouverneur de l’Arkansas The Honorable Asa Hutchinson, Governor of the State of Arkansas State Capitol, Suite 250, 500 Woodlane St, Little Rock, AR 72201, États-Unis Télécopieur : +1 501 682 3597 Courriel : http://governor.arkansas.gov/contact-info/ (coordonnées aux États-Unis nécessaires) Formule d’appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur, *Pour ceux à l'extérieur des États-Unis désirant agir via le site Internet, veuillez utiliser l'adresse du bureau de Washington d'AI États-Unis : 600 Pennsylvania Ave. SE, 5th Floor Washington, D.C. Zip Code: 20003 Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays. Ambassadeur des États-Unis Ambassadeur Bruce A. Heyman Ambassade des États-Unis 490, chemin Sussex Ottawa, Ontario K1N 1G8, Canada Télécopieur : 613-688-3082 Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. COMPLÉMENT D’INFORMATION Les trois juges qui n’étaient pas d’accord pour confirmer le verdict de culpabilité de Stacey Johnson en 2000 ont dévoilé certaines des notes de la thérapeute auxquelles la défense n’a pas eu accès. Parmi ces extraits des notes rédigées par la thérapeute à l’issue des séances avec la fillette (désignée par la lettre A) avant le deuxième procès figuraient les passages suivants : « Le procureur dit qu’elle est la seule personne qui peut “le maintenir derrière les barreaux”. » ; « Ce que dit A répète en grande partie les propos d’autres membres de sa famille. Par exemple, elle dit : “Je suis la seule qui puisse l’envoyer derrière les barreaux”. » ; « Sa grand-mère a dit à A qu’elle “doit le maintenir derrière les barreaux” car, s’il sort, il tentera ensuite de tuer A. » ; « Sa grand-mère a insisté sur la responsabilité qui pèse sur elle et, si la peine de Johnson est annulée, A se sentira totalement responsable. » ; « A voulait sans cesse donner des détails sur ce qu’elle avait vu. [Le procureur] lui a affirmé que tout ce qu’elle avait à dire était qu’elle avait vu [Johnson] tuer sa mère, un point c’est tout. » Les trois juges minoritaires ont accusé leurs quatre collègues d’adhérer à la position du ministère public, selon laquelle la tutrice de la fillette « devait pouvoir choisir quel thérapeute témoignerait et serait mis à la disposition de la défense. Cela n’aurait pas dû être autorisé. Il va sans dire que si la tutrice d’A lève le secret professionnel pour une psychothérapeute jouant un rôle essentiel, cette levée du secret doit s’appliquer à une seconde thérapeute qui l’a également traitée pour l’aider à surmonter le meurtre brutal de sa mère avant le deuxième procès. Dans le cas présent, la défense a été empêchée d’examiner les notes de [la seconde thérapeute], qui avait mené les séances de thérapie plus récentes avec A et qui, sans aucun doute, aurait présenté un meilleur aperçu de son état mental actuel ». La « seule source citée par la majorité pour valider la position unique du ministère public est une procédure civile de 1915 », dans laquelle « n’entrent pas en jeu les droits fondamentaux et les considérations politiques propres à une affaire de meurtre passible de la peine capitale ». Aux termes du droit international et des normes internationales, les personnes accusées d’infractions pénales ont le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Certaines restrictions de ce droit sont admissibles si le témoin en question est particulièrement vulnérable, par exemple dans le cas d’un enfant. Cependant, toute restriction doit être jugée objectivement nécessaire par un tribunal, être proportionnée et respecter les droits de l’accusé et les conditions d’un procès équitable. Étant donné le caractère irréversible de la peine capitale, les procédures dans les affaires où elle peut être prononcée doivent être rigoureusement conformes à toutes les normes internationales garantissant le droit à un procès équitable et appliquer strictement les critères les plus exigeants en matière de collecte et d’évaluation des preuves. Toutes les études menées sur le sujet ont démontré que l’origine ethnique, en particulier celle des victimes, joue un rôle dans l’application de la peine de mort. En 2015, par exemple, le juge Stephen Breyer de la Cour suprême des États-Unis a fait remarquer que, selon plusieurs études, les personnes accusées d’avoir tué des victimes blanches étaient plus susceptibles d’être condamnées à mort que celles accusées d’avoir ôté la vie à des victimes noires ou membres d’autres minorités. Aux États-Unis, il y a à peu près autant de Noirs que de Blancs parmi les victimes de meurtre (ce qui signifie que les personnes noires, qui ne représentent qu’environ 13 % de la population, sont touchées de manière disproportionnée). Pourtant, dans l’ensemble du pays, 78 % des personnes exécutées depuis 1977 ont été condamnées pour des crimes dont les victimes étaient blanches. En Arkansas, cette proportion s’élève à 89 %. Comme de nombreux autres États, l’Arkansas rencontre des difficultés pour se procurer les produits chimiques nécessaires aux exécutions par injection létale et pour appliquer des protocoles respectant, selon les juges, les critères de conformité à la Constitution. Le 23 juin 2016, la cour suprême de l’Arkansas a validé la méthode d’exécution par injection de trois substances, selon laquelle les autorités pénitentiaires choisissent soit un barbiturique soit le midazolam comme sédatif, puis utilisent du bromure de vecuronium comme agent paralysant, et enfin du chlorure de potassium pour provoquer un arrêt cardiaque entraînant la mort. À la suite du refus de la Cour suprême fédérale d’intervenir en février 2017, le gouverneur Hutchinson a fixé des dates d’exécution pour les huit hommes au nom desquels le recours judiciaire contre le protocole d’injection létale avait été déposé : Don Davis et Bruce Ward doivent être exécutés le 17 avril ; Ledelle Lee et Stacey Johnson, le 20 avril ; Marcel Williams et Jack Jones, le 24 avril ; et Jason McGehee et Kenneth Williams, le 27 avril (voir https://www.amnesty.org/fr/documents/amr51/5816/2017/fr/). Six exécutions ont déjà eu lieu cette année aux États-Unis, ce qui porte à 1 448 le nombre de personnes auxquelles les autorités de ce pays ont ôté la vie depuis la reprise de cette pratique en 1977, après l’approbation de la nouvelle législation relative à la peine capitale par la Cour suprême fédérale en 1976. La dernière exécution recensée en Arkansas – la 27e depuis 1977 dans cet État – a eu lieu en 2005. Amnistie internationale s’oppose catégoriquement à la peine de mort, en toutes circonstances et dans tous les pays. À l’heure actuelle, quelque 141 pays sont abolitionnistes en droit ou dans la pratique. Bruce Ward doit être exécuté dans l’Arkansas le 17 avril. Un médecin a établi qu’il était atteint de schizophrénie paranoïde. Détenu depuis 1989, il est dans le couloir de la mort depuis près de 25 ans. Âgé de 32 ans au moment du crime pour lequel il a été condamné, il en a aujourd’hui 60.
Le 11 août 1989, un policier a trouvé le corps sans vie de Rebecca Doss, 18 ans, dans une station-service de Little Rock, dans l’Arkansas, où elle travaillait. Bruce Ward a été condamné à mort pour son meurtre environ un an plus tard, le 18 octobre 1990. Sa condamnation a été annulée à deux reprises en raison d’erreurs. Lors d’une troisième procédure consacrée au jugement, en octobre 1997, il a de nouveau été condamné à mort. Avant cette condamnation, l’avocat de Bruce Ward avait demandé un sursis car l’état de santé mentale de son client s’était « détérioré à tel point qu’il ne pourrait ou voudrait pas coopérer avec son avocat actuel ». Bruce Ward a été envoyé à l’hôpital public, où il a refusé de se soumettre à une évaluation. Il n’a pas bénéficié d’un examen indépendant, mais la procédure a suivi son cours et abouti à cette nouvelle condamnation à mort. Aux termes de l’arrêt Ford c. Wainwright, rendu en 1986 par la Cour suprême des États-Unis, il est interdit d’exécuter des personnes mentalement inaptes – c’est-à-dire qui ne sont pas en mesure de comprendre le motif ou la réalité de leur peine. En 2007, dans l’arrêt Panetti c. Quarterman, la Cour suprême a statué qu’au titre de l’arrêt Ford, « le fait qu’un prisonnier ait conscience de la raison retenue par l’État pour l’exécuter n’est pas la même chose que le fait de comprendre cette raison de manière rationnelle. […] Il est possible que les délires causés par de graves troubles mentaux permettent d’établir un lien entre le crime et son châtiment, mais dans un contexte si éloigné de la réalité que le châtiment ne peut servir aucun objectif digne de ce nom ». Bruce Ward a passé plus de 25 ans dans le couloir de la mort, la plupart du temps à l’isolement. D’après ses avocats, son état de santé mentale n’a cessé de se détériorer et il croit fermement qu’ils font partie d’un complot contre lui. En 2006, 2010, 2011 et 2015, un médecin engagé par ses avocats a établi que Bruce Ward était atteint de schizophrénie paranoïde. Ce professionnel a décrit ses délires de persécution et de grandeur, notamment le fait qu’il pense être victime d’un vaste complot visant à l’accuser de crimes qu’il n’a pas commis, qu’il est convaincu « d’être voué à un destin plus grand et que son exécution n’aura jamais lieu », et qu’il « croit qu’il finira par être innocenté, connaîtra la fortune et aura de nombreux enfants ». Selon lui, bien que Bruce Ward ait « une connaissance littérale du fait qu’il a été condamné à mort », celle-ci est « compromise par des croyances et des altérations délirantes dues à une maladie mentale, la schizophrénie paranoïde ». Le médecin a conclu que Bruce Ward « n’a pas une compréhension rationnelle de sa condamnation à mort ». Son analyse du dossier l’a également amené à estimer que Bruce Ward était atteint de schizophrénie paranoïde lors de son procès en 1990 et de la procédure consacrée au nouveau jugement en 1997, et que cette maladie l’a privé d’une compréhension rationnelle de la procédure et de la faculté de participer réellement à sa défense. DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais ou dans votre propre langue : - appelez les autorités à faire preuve de clémence envers Bruce Ward et à commuer sa condamnation à mort ; - soulignez le fait que cet homme a été diagnostiqué comme atteint d’un grave trouble mental, la schizophrénie paranoïde, par un médecin qui a conclu qu’il n’avait pas une compréhension rationnelle de sa condamnation ; - expliquez que vous ne cherchez aucunement à excuser le crime violent dont il est question dans cette affaire, ni à minimiser les souffrances qu’il a causées. ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 17 AVRIL 2017 À : Gouverneur de l’Arkansas The Honorable Asa Hutchinson Governor of the State of Arkansas State Capitol, Suite 250, 500 Woodlane St, Little Rock, AR 72201, États-Unis Télécopieur : +1 501 682 3597 Courriel : http://governor.arkansas.gov/contact-info/ (coordonnées aux États-Unis nécessaires) Formule d’appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur, *Pour ceux à l'extérieur des États-Unis désirant agir via le site Internet, veuillez utiliser l'adresse du bureau de Washington d'AI États-Unis : 600 Pennsylvania Ave. SE, 5th Floor Washington, D.C. Zip Code: 20003 Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays. Ambassadeur des États-Unis Ambassadeur Bruce A. Heyman Ambassade des États-Unis 490, chemin Sussex Ottawa, Ontario K1N 1G8, Canada Télécopieur : 613-688-3082 Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. COMPLÉMENT D’INFORMATION Le droit international et les normes internationales sur le recours à la peine capitale énoncent clairement que ce châtiment ne peut pas être imposé ou appliqué à des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un handicap mental. Cela est valable y compris si un tel trouble est diagnostiqué après la survenance des faits reprochés à la personne condamnée. Dans l’arrêt Panetti c. Quarterman, la Cour suprême des États-Unis a souligné qu’« une notion telle que la capacité à comprendre de manière rationnelle est difficile à définir ». Dans l’arrêt Ford c. Wainwright de 1986, quatre des juges avaient déjà noté que les éléments de preuve concernant l’aptitude d’un prisonnier à être exécuté « seront toujours imprécis ». Un cinquième juge avait ajouté que, « à l’inverse des questions de fait historique, la question de la santé mentale d’[un] demandeur repose sur un jugement essentiellement subjectif ». Pour beaucoup, l’une des raisons invoquées afin de mettre un terme aux exécutions et d’abolir la peine de mort est précisément l’impossibilité d’éliminer la subjectivité et l’erreur humaine inhérentes à ce châtiment irréversible. Par ailleurs, le droit de grâce accordé au pouvoir exécutif existe pour compenser les erreurs et injustices auxquelles les tribunaux n’ont pas pu remédier. Le gouverneur de l’Arkansas a le pouvoir d’octroyer sa grâce même sans recommandation du comité des grâces et des libérations conditionnelles. Lorsque la cour suprême de l’Arkansas a annulé la première condamnation à mort de Bruce Ward en 1992, trois des sept juges n’étaient pas d’accord avec la décision de confirmer le verdict de culpabilité, au motif que le parti pris du juge avait rendu son procès inique. Ils ont écrit qu’un juge « doit manifester l’équité la plus impartiale au cours d’un procès, surtout lorsque l’accusé encourt la peine capitale », en relevant le fait que le juge du procès de Bruce Ward avait « semblé prendre plaisir à priver la défense de la possibilité de s’approcher de la cour », qu’il avait accordée à l’accusation. Selon eux, « il était manifeste aux yeux des jurés que les avocats de la défense n’étaient pas traités de la même façon que les représentants du parquet » et cela « pourrait bien avoir influencé les jurés contre les avocats de la défense ». Cependant, ces trois juges étaient minoritaires et le verdict de culpabilité prononcé en 1990 persiste aujourd’hui. En appel, le recours formé au motif que l’avocat ayant défendu Bruce Ward en première instance avait été inefficace car il n’avait pas demandé la récusation du juge lors du procès de 1990 a été rejeté. En 2005, la cour fédérale de district a également rejeté ce recours en vertu de la déférence avec laquelle les juridictions fédérales doivent traiter les décisions des tribunaux d’État aux termes de la législation américaine, en ajoutant que, « bien que l’histoire de la justice regorge d’exemples d’attitude sarcastique du juge lors d’un procès et parfois de son antipathie pour l’accusation comme pour la défense », leur « niveau n’atteint pas le point d’un procès inique ». Comme de nombreux autres États, l’Arkansas rencontre des difficultés pour se procurer les produits chimiques nécessaires aux exécutions par injection létale et pour appliquer des protocoles respectant, selon les juges, les critères de conformité à la Constitution. Le 23 juin 2016, la cour suprême de l’Arkansas a validé la méthode d’exécution par injection de trois substances, selon laquelle les autorités pénitentiaires choisissent soit un barbiturique soit le midazolam comme sédatif, puis utilisent du bromure de vecuronium comme agent paralysant, et enfin du chlorure de potassium pour provoquer un arrêt cardiaque entraînant la mort. À la suite du refus de la Cour suprême fédérale d’intervenir en février 2017, le gouverneur Hutchinson a fixé des dates d’exécution pour les huit hommes au nom desquels le recours judiciaire contre le protocole d’injection létale avait été déposé : Don Davis et Bruce Ward doivent être exécutés le 17 avril ; Ledelle Lee et Stacey Johnson, le 20 avril ; Marcel Williams et Jack Jones, le 24 avril ; et Jason McGehee et Kenneth Williams, le 27 avril (voir https://www.amnesty.org/fr/documents/amr51/5816/2017/fr/). Six exécutions ont déjà eu lieu cette année aux États-Unis, ce qui porte à 1 448 le nombre de personnes auxquelles les autorités de ce pays ont ôté la vie depuis la reprise de cette pratique en 1977, après l’approbation de la nouvelle législation relative à la peine capitale par la Cour suprême fédérale en 1976. La dernière exécution recensée en Arkansas – la 27e depuis 1977 dans cet État – a eu lieu en 2005. Amnistie internationale s’oppose catégoriquement à la peine de mort, en toutes circonstances et dans tous les pays. À l’heure actuelle, quelque 141 pays sont abolitionnistes en droit ou dans la pratique. Don Davis doit être exécuté dans l’Arkansas le 17 avril. Il est emprisonné dans le couloir de la mort depuis 25 ans, après avoir été condamné à la peine capitale en 1992 pour un meurtre commis au cours d’un cambriolage en 1990. Âgé de 27 ans au moment du crime, il en a aujourd’hui 54.
Le 12 octobre 1990, le mari de Jane Daniel a retrouvé sa femme tuée par balle en rentrant chez lui. L’enquête a révélé que l’arme du crime avait été volée chez un voisin plus tôt ce jour-là. À partir de celle-ci, d’une empreinte digitale et d’objets trouvés aux deux domiciles, la police a fini par faire le lien avec Don Davis. Présumant que l’état de santé mentale de l’accusé serait évoqué pendant le procès, le juge chargé de l’affaire a requis une évaluation par un psychiatre, qui a estimé que Don Davis n’était pas « en état de démence » au moment des faits, mais que son trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) « pourrait avoir contribué à l’acte criminel présumé ». Le juge a ordonné une seconde évaluation à l’hôpital public, qui a conclu qu’il était apte à être jugé. L’avocat de la défense a demandé des fonds pour faire appel à un expert psychiatre indépendant, en précisant le nom de celui qu’il souhaitait engager (pour un coût de 2 000 dollars). Il a souligné que les questions relatives à l’état de santé mentale de son client joueraient un rôle déterminant lors de la phase de détermination de la peine et que, en vertu d’un arrêt rendu par la Cour suprême fédérale en 1985 (Ake c. Oklahoma), il avait droit à une telle expertise indépendante pour l’aider à établir et présenter des circonstances atténuantes. Néanmoins, le juge a refusé d’autoriser le déblocage des fonds. L’affaire est passée en jugement et, le 6 mars 1992, Don Davis a été déclaré coupable de meurtre passible de la peine capitale. Durant la phase du procès consacrée à la détermination de la peine, la défense a fait venir le psychiatre qui avait procédé à la première évaluation ordonnée par le juge. Il a exposé de manière générale le genre de problèmes rencontrés par les personnes atteintes d’un TDAH, notamment lorsque celles-ci grandissent dans un environnement instable et qu’elles consomment des psychotropes. Don Davis a été abandonné par ses parents, a vécu chez sa grand-mère jusqu’à l’âge de 13 ans puis a été placé dans un foyer pour mineurs. Il a commencé à consommer de l’alcool et des stupéfiants dès l’âge de 12 ans. En appel, les juridictions d’État ont estimé que le juge du procès n’avait pas eu tort de refuser d’accorder une aide pour engager un expert psychiatre indépendant que Don Davis ne pouvait pas payer lui-même. En 2005, un collège de trois juges de la cour d’appel fédérale du huitième circuit a confirmé sa condamnation à mort par deux voix contre une. Le juge minoritaire a noté que l’examen réalisé par le premier psychiatre était « loin de satisfaire aux exigences de l’arrêt Ake », qui demandait « un examen complet et approfondi » suivi par l’expert travaillant « aux côtés de l’accusé et de son avocat pour établir une stratégie de défense ». Dans le cas présent, il ne faisait « aucun doute » que le psychiatre n’avait « apporté qu’une maigre assistance à la défense », que son examen pouvait être « au mieux décrit comme superficiel » et ses conclusions comme « préliminaires et peu développées ». Il n’avait « pas procédé aux tests psychologiques les plus rudimentaires, ni à des entretiens complémentaires, et n’avait pas eu l’occasion d’examiner les éléments médicaux, éducatifs et psychologiques de l’histoire personnelle de Don Davis ». Même au regard du respect dû par les juridictions fédérales aux décisions des tribunaux d’État selon le droit américain, la confirmation de la peine de mort constituait une application indue de l’arrêt Ake c. Oklahoma, a encore estimé ce magistrat. DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais ou dans votre propre langue : - appelez les autorités à faire preuve de clémence envers Don Davis et à commuer sa condamnation à mort ; - dites-vous préoccupé-e par le fait qu’il a été privé de l’aide d’un expert psychiatre qu’il ne pouvait pas payer lors de son procès ; - expliquez que vous ne cherchez aucunement à excuser le crime violent dont il est question dans cette affaire, ni à minimiser les souffrances qu’il a causées. ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 17 AVRIL 2017 À : Gouverneur de l’Arkansas The Honorable Asa Hutchinson Governor of the State of Arkansas State Capitol, Suite 250 500 Woodlane St Little Rock, AR 72201, États-Unis Télélécopieur : +1 501 682 3597 Courriel : http://governor.arkansas.gov/contact-info/ (coordonnées aux États-Unis nécessaires) Formule d’appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur, *Pour ceux à l'extérieur des États-Unis désirant agir via le site Internet, veuillez utiliser l'adresse du bureau de Washington d'AI États-Unis : 600 Pennsylvania Ave. SE, 5th Floor Washington, D.C. Zip Code: 20003 Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays. Ambassadeur des États-Unis Ambassadeur Bruce A. Heyman Ambassade des États-Unis 490, chemin Sussex Ottawa, Ontario K1N 1G8, Canada Télécopieur : 613-688-3082 Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. COMPLÉMENT D’INFORMATION Selon certaines sources, Don Davis est devenu un élément stabilisateur dans le couloir de la mort, se souciant du bien-être de ses codétenus. Il s’intéresserait à beaucoup de choses, notamment la politique, l’art, la musique et la nature. Comme de nombreux autres États, l’Arkansas rencontre des difficultés pour se procurer les produits chimiques nécessaires aux exécutions par injection létale et pour appliquer des protocoles respectant, selon les juges, les critères de conformité à la Constitution. Le 23 juin 2016, la cour suprême de l’Arkansas a validé la méthode d’exécution par injection de trois substances, selon laquelle les autorités pénitentiaires choisissent soit un barbiturique soit le midazolam comme sédatif, puis utilisent du bromure de vecuronium comme agent paralysant, et enfin du chlorure de potassium pour provoquer un arrêt cardiaque entraînant la mort. À la suite du refus de la Cour suprême fédérale d’intervenir en février 2017, le gouverneur Hutchinson a fixé des dates d’exécution pour les huit hommes au nom desquels le recours judiciaire contre le protocole d’injection létale avait été déposé : Don Davis et Bruce Ward doivent être exécutés le 17 avril ; Ledelle Lee et Stacey Johnson, le 20 avril ; Marcel Williams et Jack Jones, le 24 avril ; et Jason McGehee et Kenneth Williams, le 27 avril (voir https://www.amnesty.org/fr/documents/amr51/5816/2017/fr/). Six exécutions ont déjà eu lieu cette année aux États-Unis, ce qui porte à 1 448 le nombre de personnes auxquelles les autorités de ce pays ont ôté la vie depuis la reprise de cette pratique en 1977, après l’approbation de la nouvelle législation relative à la peine capitale par la Cour suprême fédérale en 1976. La dernière exécution recensée en Arkansas – la 27e depuis 1977 dans cet État – a eu lieu en 2005. Le gouverneur de l’Arkansas a le pouvoir d’octroyer sa grâce même sans recommandation du comité des grâces et des libérations conditionnelles. Don Davis n’a pas demandé d’audience devant ce comité. Bien que 48 % des exécutions réalisées depuis 1977 aux États-Unis aient eu lieu entre 1997 et 2006, le rythme des exécutions et des condamnations à mort a ensuite généralement diminué. Depuis 2007, cinq États américains ont modifié leur législation afin d’abolir la peine de mort : le New Jersey (2007), le Nouveau-Mexique (2009), l’Illinois (2011), le Connecticut (2012) et le Maryland (2013). De plus, l’État de New York a commué sa dernière condamnation à mort en 2007 à la suite d’une décision de justice prononcée en 2004, selon laquelle sa législation relative à la peine de mort enfreignait sa Constitution. En 2016, la cour suprême du Delaware a déclaré que la loi de cet État relative à la peine de mort était anticonstitutionnelle. Amnistie internationale est catégoriquement opposée à la peine de mort, quelles que soient la nature du crime commis, la personnalité de son auteur ou la méthode d’exécution utilisée. Ce châtiment est fondamentalement cruel et dégradant ; il est incompatible avec la dignité humaine. Mettre un terme à la peine capitale, c’est abandonner une politique qui détourne des vrais problèmes et sème la destruction et la division. Non seulement ce châtiment comporte un risque d’erreur irréparable, mais il coûte en outre très cher, que ce soit en deniers publics ou en termes sociaux et psychologiques. Il n’a jamais été prouvé qu’il ait un effet plus dissuasif que les autres peines. Il tend à être appliqué de manière discriminatoire aux États-Unis, en fonction des origines ethniques et sociales. Il exclut toute possibilité de réinsertion, prolonge la souffrance de la famille de la victime et l’étend aux proches du condamné. Il accapare des ressources qui pourraient être utilisées plus efficacement pour lutter contre les crimes violents et aider ceux qui sont touchés par ces crimes. À l’heure actuelle, quelque 141 pays sont abolitionnistes en droit ou dans la pratique. 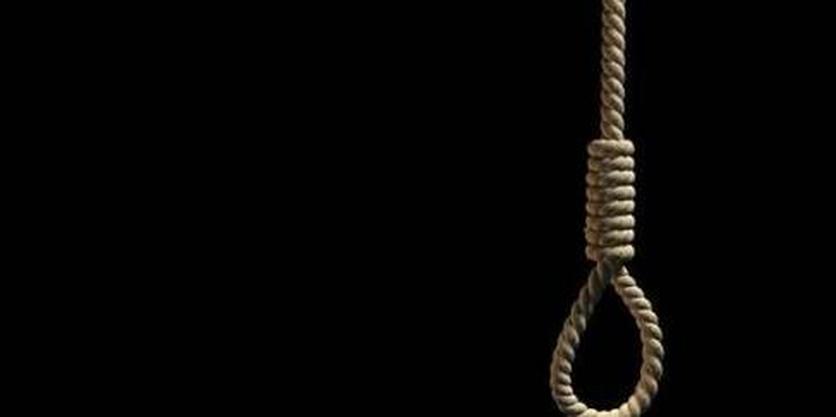 Le Bangladesh doit empêcher l’exécution imminente des trois hommes condamnés à mort pour une attaque à la grenade contre l’ambassadeur britannique, a déclaré Amnistie internationale. Le 22 mars, les autorités pénitentiaires du Bangladesh ont confirmé que les exécutions de Mufti Abdul Hannan, Sharif Shahedul Alam Bipul et Delwar Hossain Ripon, membres supposés du groupe armé interdit Harkat-ul-Jihad (HuJI), auraient lieu prochainement. Ils ont tous trois été reconnus coupables et condamnés à mort pour une attaque datant de 2004 au cours de laquelle Anwar Choudhury, alors ambassadeur du Royaume-Uni, a été blessé, et trois personnes ont été tuées. « Ces exécutions doivent être immédiatement annulées. Si les personnes reconnues coupables de crimes à l’issue de procès équitables doivent effectivement être punies, la peine de mort n’est jamais la solution. Il est consternant que les autorités bangladaises cherchent à ôter davantage de vies au nom de la lutte contre le “terrorisme” », a déclaré Olof Blomqvist, chercheur sur le Bangladesh à Amnistie internationale. « La peine de mort est toujours une violation des droits humains et n’est en aucun cas une solution plus efficace que l’emprisonnement à vie pour lutter contre la criminalité. Envoyer ces hommes à la potence ne rendra pas le Bangladesh plus sûr, cela ne fera qu’augmenter le nombre de morts. » Le 19 mars 2017, la Cour suprême bangladaise a rejeté le dernier appel des trois hommes. Leur seule option à présent est de former un recours en grâce présidentielle pour empêcher les exécutions. Le Bangladesh fait partie de la minorité d’États dans le monde qui appliquent encore la peine de mort. En 2015, quatre personnes ont été exécutées dans le pays, et au moins 200 personnes ont été condamnées à mort. « Nous appelons le président Abdul Hamid à gracier ces trois hommes et à leur laisser la vie. Le Bangladesh doit également instaurer sans délai un moratoire sur les exécutions en vue de l’abolition de la peine de mort. À travers le monde, de plus en plus de pays acceptent le fait que la peine capitale n’a pas un effet dissuasif et que ce n’est pas non plus un moyen efficace de rendre justice », a déclaré Olof Blomqvist. Amnistie internationale s’oppose en toutes circonstances et sans aucune exception à la peine de mort, quelles que soient la nature et les circonstances du crime commis, la culpabilité ou l’innocence ou toute autre situation du condamné, ou la méthode utilisée pour procéder à l’exécution.  Amnistie internationale est extrêmement préoccupée par l’exécution imminente de trois jeunes hommes qui avaient moins de 18 ans au moment de leur arrestation et qui ont été condamnés à mort en Arabie saoudite. Ali al Nimr, Abdullah al Zaher et Dawood al Marhoon, qui ont épuisé toutes leurs voies de recours, risquent d’être exécutés d’un moment à l’autre. Ces trois jeunes militants chiites ont été arrêtés séparément en 2012 alors qu’ils étaient âgés respectivement de 17, 16 et 17 ans, pour des infractions qu’ils auraient commises au cours de manifestations antigouvernementales dans la province saoudienne de l’Est. Ils ont tous trois été détenus dans un centre de réinsertion pour mineurs jusqu’à leur 18e anniversaire, ce qui indique que les autorités ont reconnu qu'ils étaient mineurs et les ont traités comme tels à l'époque. Le 27 mai 2014, le Tribunal pénal spécial de Riyadh – une juridiction chargée des affaires liées à la sécurité - a condamné Ali al Nimr à mort pour plusieurs infractions, à savoir participation à des manifestations antigouvernementales ; attaques contre les forces de sécurité ; détention d’une mitrailleuse et vol à main armée. Abdullah al Zaher et Dawood al Marhoon ont également été condamnés à mort en octobre 2014 par le même tribunal et pour les mêmes chefs d’accusation. Dans les trois cas, le tribunal a, semble-t-il, fondé sa décision sur des « aveux » dont ces jeunes hommes affirment qu'ils leur ont été extorqués sous la torture et d’autres formes de mauvais traitements. C’est ainsi qu’Ali al Nimr a affirmé qu’au cours de ses interrogatoires dans la prison de la Direction générale des enquêtes (GDI ou Al Mabahith), il avait été battu et roué de coups de pied, entre autres mauvais traitements, par quatre agents de ce service qui l’avaient contraint à signer des déclarations sans l’autoriser à les lire et en lui faisant croire qu’il s’agissait d’une ordonnance de remise en liberté. Plutôt que d’ordonner immédiatement une enquête sur les allégations d’Ali al Nimr, le juge a déclaré qu’il avait demandé au ministère de l’Intérieur d’examiner les allégations de torture formulées contre ses propres agents. Aucune enquête n’a été effectuée à la connaissance de l’organisation, et le juge a déclaré Ali al Nimr coupable en se fondant exclusivement sur ses « aveux » et l’a condamné à mort. Amnistie internationale a également appris la semaine dernière la confirmation en appel de la déclaration de culpabilité et de la condamnation à mort d’un quatrième jeune chiite, Abdulkareem al Hawaj, prononcée pour des infractions commises alors qu’il était âgé de moins de 18 ans, bien que le droit international prohibe expressément l’application de la peine de mort à des mineurs délinquants. Abdulkareem al Hawaj a été arrêté le 16 janvier 2014 pour des infractions qu’il aurait commises au cours de manifestations antigouvernementales alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a été déclaré coupable et condamné à mort le 27 juillet 2016 par le Tribunal pénal spécial à l’issue d’un procès manifestement inique. Ce jeune homme a affirmé qu’il avait été maintenu au secret et à l’isolement pendant les cinq premiers mois de sa détention avant son procès, dans les prisons de la GDI à Al Qatif puis à Dammam, dans l’est du pays. Il affirme qu’au cours des interrogatoires, des agents de la GDI l’ont torturé, et notamment battu, et qu’ils auraient menacé de tuer sa famille pour qu'il rédige et signe des « aveux ». Le Tribunal pénal spécial semble avoir fondé sa décision uniquement sur les « aveux » d’Abdulkareem al Hawaj. Le cas de ce jeune homme a été examiné par la chambre d’appel du Tribunal pénal spécial qui l’a renvoyé devant la juridiction de première instance avec des recommandations. Celle-ci a confirmé, le 14 mars, la déclaration de culpabilité et la condamnation à mort et renvoyé l’affaire devant la chambre d’appel pour réexamen. Abdulkareem al Hawaj a été déclaré coupable du « jet de deux cocktails Molotov », de « participation à des émeutes durant lesquelles un véhicule blindé a été atteint par des tirs », de « participation à des rassemblements illégaux et d’avoir scandé des slogans hostiles à l’État », ainsi que d’avoir utilisé des réseaux sociaux pour partager des photos et des séquences vidéo de manifestations organisées à Al Qatif et à Bahreïn, et « insulté les dirigeants ». Il a nié tous les faits qui lui étaient reprochés et affirme n’avoir commis aucun des actes qui lui sont imputés par l’accusation. Amnistie internationale a exhorté à plusieurs reprises les autorités saoudiennes à annuler les déclarations de culpabilité et les condamnations à mort de ces quatre hommes prononcées à l’issue de procès manifestement iniques. Aucun d’entre eux n’a été autorisé à s’entretenir avec un avocat pendant la détention précédant leur procès ou leurs interrogatoires. Détention arbitraire Le mois dernier, un groupe d’experts des Nations unies a conclu qu’Ali al Nimr, Abdullah al Zaher et Dawood al Marhoon étaient détenus de manière arbitraire et qu’ils devaient être remis immédiatement en liberté dans un avis qui exprime également leur préoccupation face aux « violations persistantes des droits fondamentaux » perpétrées par l’Arabie saoudite. L’avis adopté le 6 février par le groupe de travail a conclu que les trois jeunes hommes étaient détenus de manière arbitraire, et qu’ils étaient privés de liberté en violation d’un certain nombre de dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le groupe de travail a déclaré qu’ils avaient été privés de liberté sans fondement légal étant donné qu’ils avaient été poursuivis et condamnés sur la base de lois promulguées deux ans après leur arrestation, en violation flagrante du principe de légalité. Il est également convaincu que la privation de liberté était fondée sur l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’opinion. Enfin, le groupe de travail a considéré que leur droit à un procès équitable avait été violé, entre autres éléments, par l’absence de mandat au moment de leur arrestation ; leur détention prolongée avant leur procès sans accès à une procédure d’habeas corpus ; l’utilisation de la détention au secret et de procès secrets ; et l’importance donnée aux « aveux » extorqués sous la torture pour prononcer des condamnations. Par ailleurs, le groupe de travail a conclu que l’Arabie saoudite avait violé ses obligations en tant qu’État partie à la Convention relative aux droits de l’enfant en condamnant à mort ces jeunes hommes pour des crimes qu’ils auraient commis alors qu’ils étaient âgés de moins de 18 ans. En tant qu’État partie à cet instrument, l’Arabe saoudite est tenue de veiller à ce qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit condamnée à mort ni à la réclusion à perpétuité sans possibilité de remise en liberté. Ses lois ne contiennent toutefois pas de garanties claires empêchant l’application de la peine de mort à des mineurs, et les juges ont le pouvoir de décider de l’âge de la majorité, ce qui permet de condamner à la peine capitale des personnes considérées comme ayant atteint la maturité. Un tel pouvoir discrétionnaire peut avoir des conséquences graves. L’avis du groupe de travail souligne que l’Arabe saoudite a affirmé que les trois jeunes hommes étaient « de véritables adultes car leur capacité à exercer la responsabilité religieuse, financière et pénale démontrait qu’ils avaient atteint l’âge adulte », et que les obligations du pays découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant n’avaient pas été violées. Condamnations à mort collectives Le Tribunal pénal spécial a été créé en 2008 pour juger les infractions liées à la sécurité. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, en 2014, de la loi antiterroriste, cette juridiction est de plus en plus utilisée pour juger des défenseurs des droits humains et des militants politiques, notamment des musulmans chiites dissidents qui ont critiqué la discrimination dont leur communauté fait l’objet et dont les activités sont considérées comme représentant un risque pour la sécurité nationale. En juin, le Tribunal pénal spécial a condamné à mort 14 membres de la minorité chiite déclarés coupables, entre autres chefs d’accusation, d’avoir ouvert le feu sur des membres des forces de sécurité, incité au désordre et participé à des manifestations et à des émeutes. Neuf autres accusés ont été condamnés à des peines d’emprisonnement et un autre a été acquitté. Le tribunal a, semble-t-il, fondé sa décision sur des « aveux » qui auraient été obtenus sous la torture. Selon les pièces du dossier, tous les accusés, dont les 14 condamnés à mort, ont été maintenus en détention provisoire pendant une durée moyenne de deux ans avant l’ouverture de leur procès. La plupart d’entre eux ont été placés à l’isolement et privés de tout contact avec leur famille ainsi que de l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires. Les 14 condamnés à mort ont affirmé qu'on les avait torturés et maltraités au cours des interrogatoires pour les contraindre à faire des « aveux ». Certains ont dit qu’on les avait menacés de leur infliger de nouveaux sévices s’ils refusaient de signer leurs « aveux » devant le juge chargé de les authentifier, lequel n’a pas mis en cause la validité de ces « aveux ». L’un des accusés a déclaré lors de son procès devant le Tribunal pénal spécial : « Celui qui m’interrogeait m’a dit : Si tu n’es pas [d'accord avec ce que j'écris], je vais te suspendre par les bras et t’attacher les jambes et ensuite je vais t’administrer des décharges électriques avec une machine qui utilise du 1 000 volts ». Dans certains cas, après avoir entendu le récit des conditions dans lesquelles les « aveux » avaient été obtenus, le juge a recommandé de renvoyer les accusés pour de nouveaux interrogatoires et, par conséquent, d’autres actes de torture. Le 1er décembre 2016, le Tribunal pénal spécial a condamné à mort 15 autres chiites à l’issue d’un nouveau procès collectif manifestement inique. Les condamnés figuraient parmi 32 personnes arrêtées dans tout le pays en 2013 et en 2014 et qui étaient accusées d’espionnage pour le compte de l’Iran. Quinze autres ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de six mois à 25 ans, et les deux derniers ont été acquittés. Ces hommes étaient poursuivis pour une série d’infractions, notamment pour « haute trahison », et certains étaient accusés d’actes qui ne devraient pas être considérés comme des infractions pénales, tels que « soutien à des manifestations », « propagation du chiisme » et « détention de livres et de vidéos interdits ». Certains ont indiqué au tribunal qu’on les avait menacés de les placer à l'isolement et de les priver de tout contact avec leur famille s'ils ne signaient pas des documents contenant leurs « aveux ». On leur aurait dit que, s’ils refusaient de signer ces « aveux », leurs proches seraient emprisonnés dans des cellules à côté d’eux. Étant donné les préoccupations profondes quant à l’équité de ces procès, Amnistie internationale appelle les autorités saoudiennes à annuler les déclarations de culpabilité et les condamnations à mort et de veiller à ce que tous les accusés bénéficient d’un procès équitable conformément aux normes internationales et excluant tout recours à la peine de mort. Les autorités devraient également ouvrir une enquête indépendante sur toutes les allégations de torture et d’autres formes de mauvais traitements formulées par les accusés. La peine de mort est le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant. Amnistie internationale est opposée à la peine de mort dans tous les cas sans exception, indépendamment de la nature ou des circonstances du crime, des questions relatives à la culpabilité ou à l’innocence ou de toute autre situation de l’accusé, et quelle que soit la méthode d’exécution utilisée par l’État. L’Arabie saoudite est l’un des pays qui procèdent au plus grand nombre d’exécutions dans le monde. Plus de 2 000 personnes ont été mises à mort entre 1985 et 2016, alors que 141 pays ont aboli ce châtiment dans la législation ou dans la pratique, 104 d’entre eux ayant aboli la peine capitale pour tous les crimes. Amnistie internationale réitère son appel aux autorités saoudiennes pour qu’elles instaurent sans délai un moratoire sur toutes les exécutions à titre de première étape vers l’abolition de la peine de mort. Marcel Williams, 46 ans, doit être exécuté dans l’Arkansas le 24 avril. Le jury de son procès n’a jamais été informé des circonstances atténuantes, à savoir de graves violences et traumatismes subis pendant son enfance. Ces éléments sont maintenant entre les mains du comité des grâces et des libérations conditionnelles de l’Arkansas, qui examinera son recours le 27 mars.
Le 5 décembre 1994, la police a retrouvé le corps de Stacy Errickson, une femme de 22 ans, sommairement enterré près de Little Rock, dans l’Arkansas. Marcel Williams, alors âgé de 24 ans, a été accusé d’avoir enlevé, violé et tué la victime, qui avait disparu depuis le 20 novembre 1994. Il a été jugé en janvier 1997. Ses avocats n’ont pas contesté sa culpabilité, mais simplement tenté de convaincre le jury de prononcer une peine de réclusion à perpétuité plutôt que la peine de mort. Toutefois, ils n’ont invoqué aucune circonstance atténuante lors de la phase de détermination de la peine. Le seul témoin qu’ils ont présenté était un détenu dont la peine de mort avait été réduite en peine de réclusion à perpétuité, qui a déclaré que, à son avis, les conditions de détention des condamnés à mort étaient meilleures que celles du reste de la population carcérale. Les avocats étaient au courant, et n’ont pourtant pas évoqué, des éléments relatifs à l’histoire personnelle de Marcel Williams, marquée par la pauvreté, la négligence et la violence, qui auraient certainement pu être retenus à titre de circonstances atténuantes. En 2007, après la confirmation de la condamnation à mort par les juridictions d’État, un juge fédéral a statué que « au vu d’éléments clairs et convaincants », le travail des avocats lors du procès n’avait pas été suffisant au regard des exigences de la Constitution car ils n’avaient pas invoqué ces circonstances atténuantes. À l’issue d’une audience consacrée à l’examen des éléments du dossier qui a duré trois jours, le juge de la cour fédérale de district a récapitulé ces éléments de la manière suivante : « Marcel Wayne Williams a vécu toutes les catégories d’expériences traumatisantes généralement utilisées pour décrire les traumatismes d’enfance. Il a été agressé sexuellement par de multiples auteurs. Il a été maltraité physiquement par sa mère et son beau-père, qui étaient les principales personnes ayant la responsabilité de l’élever. Il a subi des violences psychologiques aux mains des deux principales personnes ayant la responsabilité de l’élever. Il a été l’objet de négligences flagrantes dans toutes les catégories de négligences : médicales, nutritionnelles et éducatives. Il a été témoin de violences au sein de son foyer et dans son quartier pendant toute son enfance. Adolescent, il a été victime d’un viol collectif d’une grande brutalité en prison. » Ce magistrat a conclu que si les jurés avaient été informés de ces éléments, ils auraient probablement opté pour une peine de réclusion à perpétuité plutôt que pour la peine de mort. Il a ordonné à l’État de l’Arkansas d’accorder à Marcel Williams une nouvelle audience de détermination de la peine ou de commuer sa peine en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les autorités de l’Arkansas ont fait appel et, en 2009, un collège de trois juges de la cour d’appel fédérale du huitième circuit a annulé la décision de la cour fédérale de district pour des raisons de procédure, en concluant que, au regard de la législation fédérale, Marcel Williams n’avait pas droit à l’audience fédérale consacrée à l’examen des éléments du dossier. Cette juridiction a donc ignoré les éléments présentés lors de cette audience et confirmé la condamnation à mort. En 2010, la Cour suprême des États-Unis a refusé d’examiner l’affaire, malgré l’avis divergent de deux de ses membres, qui ont estimé que la décision du huitième circuit s’était faite « aux dépens inacceptables des intérêts de la justice ». Le comité des grâces et des libérations conditionnelles de l’Arkansas doit examiner le recours de Marcel Williams le 27 mars 2017. DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais ou dans votre propre langue : - appelez les autorités à faire preuve de clémence envers Marcel Williams et à commuer sa condamnation à mort ; - dites-vous préoccupé-e par le fait que le jury n’a pas été informé de son histoire personnelle marquée par la pauvreté, la négligence et la violence, ni de ses conséquences, en soulignant que le seul juge ayant examiné ces éléments a estimé que la peine de mort ne devait pas être appliquée ; - expliquez que vous ne cherchez aucunement à excuser le crime violent dont il est question dans cette affaire, ni à minimiser les souffrances qu’il a causées. ENVOYEZ VOS APPELS RESPECTIVEMENT AVANT LE 27 MARS (au comité des grâces) ET LE 24 AVRIL (au gouverneur) 2017 À : Comité des grâces et des libérations conditionnelles de l’Arkansas Arkansas Parole Board Two Union National Plaza 105 W Capitol Avenue #500 Little Rock, AR 72201-5730, États-Unis Télécopieur : +1 501 683 5381 Formule d’appel : Dear Board members, / Mesdames, Messieurs, Gouverneur de l’Arkansas The Honorable Asa Hutchinson Governor of the State of Arkansas State Capitol, Suite 250 500 Woodlane St, Little Rock, AR 72201, États-Unis Télécopieur : +1 501 682 3597 Courriel : http://governor.arkansas.gov/contact-info/ (coordonnées aux États-Unis nécessaires) Formule d’appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur, *Pour ceux à l'extérieur des États-Unis désirant agir via le site Internet, veuillez utiliser l'adresse du bureau de Washington d'AI États-Unis : 600 Pennsylvania Ave. SE, 5th Floor Washington, D.C. Zip Code: 20003 Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays. Ambassadeur des États-Unis Ambassadeur Bruce A. Heyman Ambassade des États-Unis 490, chemin Sussex Ottawa, Ontario K1N 1G8, Canada Télécopieur : 613-688-3082 Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. COMPLÉMENT D’INFORMATION Selon la synthèse faite par la cour d’appel fédérale du huitième circuit de l’audience qui s’est tenue devant le juge de district fédéral Leon Holmes en décembre 2006, « vivant dans la pauvreté et la négligence, [Marcel] Williams a commencé à voler pour subvenir aux besoins de ses frères et soeurs » et a séjourné dans des établissements pour mineurs entre 12 et 14 ans. « Il s’est remis à voler peu après sa libération et a été reconnu coupable de vol aggravé en tant que majeur en 1986, lorsqu’il avait 16 ans. Il a été condamné à huit ans de prison, peine au cours de laquelle il aurait été violé par trois codétenus. » Un témoin-clé de l’audience de la cour de district était le docteur David Lisak, spécialiste des traumatismes psychologiques, des maltraitances subies pendant l’enfance et de la relation entre maltraitances et violence. Le résumé de son témoignage fourni par le juge Holmes indique : « Les violences physiques que M. Williams a subies étaient incessantes. Il était battu par son beau-père et par sa mère. Sa mère est probablement celle qui l’a frappé le plus, tout simplement parce qu’elle était présente sur une plus longue période. Les sévices étaient vraiment horribles. Ils l’ont tous deux frappé à coups de poing. Ils ont utilisé des ceintures. Ils ont utilisé des rallonges électriques. À deux reprises, sa mère l’a brûlé délibérément, une fois avec de l’eau bouillante et la seconde avec une bobine électrique [...]. M. Williams s’est retrouvé à maintes reprises avec des marques de coups, des coupures, des plaies ouvertes […]. Il n’y a pas de véritable moyen de quantifier la gravité des violences physiques infligées à M. Williams, mais si on devait choisir entre les qualifier de légères, de modérées ou de graves, il ne fait aucun doute que ce serait “extrêmement grave”. » Le docteur Lisak a également décrit les violences sexuelles auxquelles le jeune garçon a été soumis entre neuf et 14 ans, en précisant que, « lorsqu’il a atteint l’âge de douze ans, sa mère le prostituait régulièrement ». De plus, la violence psychologique « était permanente ». Le docteur Lisak a évoqué les conséquences possibles de telles maltraitances. Dans la suite du compte rendu de son témoignage, il est écrit : « Il est assez évident que, pour quelqu’un qui a subi ce genre de traumatismes incessants jusqu’au moment de son incarcération à l’âge de quinze ans, qui est alors violé en prison et qui passe ensuite près de dix ans en détention, il ne peut rien arriver de bon par la suite. Où apprendrait-il ce qu’il doit savoir pour vivre en société ? [...] Au cours des six mois où il a été libre avant ces terribles crimes, sa vie est rapidement partie en vrille. Je ne vois pas comment quelqu’un aurait pu parier qu’il arriverait à s’en sortir sans une grande aide extérieure, et cela n’a pas été le cas. » Comme l’a déjà fait observer Amnistie internationale, même si les liens entre les traumatismes subis par des individus au cours de leur enfance ou à un autre moment de leur vie et leur propre propension à la violence sont complexes et variables, le recours à la peine de mort ignore cette complexité et prive de ressources les efforts visant à expliquer les violences commises et à empêcher leur récurrence. La peine de mort est une solution simpliste qui nie toute relation de cause à effet et s’inscrit elle-même dans un cycle de violence qui ne fait absolument pas avancer notre compréhension des origines de la violence. Comme de nombreux autres États, l’Arkansas rencontre des difficultés pour se procurer les produits chimiques nécessaires aux exécutions par injection létale et pour appliquer des protocoles respectant, selon les juges, les critères de conformité à la Constitution. Le 23 juin 2016, la cour suprême de l’Arkansas a validé la méthode d’exécution par injection de trois substances, selon laquelle les autorités pénitentiaires choisissent soit un barbiturique soit le midazolam comme sédatif, puis utilisent du bromure de vecuronium comme agent paralysant, et enfin du chlorure de potassium pour provoquer un arrêt cardiaque entraînant la mort. À la suite du refus de la Cour suprême fédérale d’intervenir en février 2017, le gouverneur Hutchinson a fixé des dates d’exécution pour les huit hommes au nom desquels le recours judiciaire contre le protocole d’injection létale avait été déposé : Don Davis et Bruce Ward doivent être exécutés le 17 avril ; Ledelle Lee et Stacey Johnson, le 20 avril ; Marcel Williams et Jack Jones, le 24 avril ; et Jason McGehee et Kenneth Williams, le 27 avril (voir https://www.amnesty.org/fr/documents/amr51/5816/2017/fr/). Six exécutions ont déjà eu lieu cette année aux États-Unis, ce qui porte à 1 448 le nombre de personnes auxquelles les autorités de ce pays ont ôté la vie depuis la reprise de cette pratique en 1977, après l’approbation de la nouvelle législation relative à la peine capitale par la Cour suprême fédérale en 1976. La dernière exécution recensée en Arkansas – la 27e depuis 1977 dans cet État – a eu lieu en 2005. Le gouverneur de l’Arkansas a le pouvoir d’octroyer sa grâce même sans recommandation du comité des grâces et des libérations conditionnelles. Amnistie internationale s’oppose catégoriquement à la peine de mort dans tous les cas et en toutes circonstances. À l’heure actuelle, quelque 141 pays sont abolitionnistes en droit ou dans la pratique. Action urgente - Égypte. Un prisonnier en détention à l'isolement mène une grève de la faim.3/17/2017 Ahmed Amin Ghazali Amin mène une grève de la faim depuis le 9 mars. Il proteste contre sa détention à l'isolement, qui dure depuis mai 2016, lorsqu’il a été condamné à mort par un tribunal militaire. Une audience d’appel doit encore être décidée. Si son appel est rejeté, il pourrait être exécuté à tout moment.
Le 9 mars, Ahmed Amin Ghazali Amin a entamé une grève de la faim pour demander la fin de sa détention à l'isolement prolongée. Il est détenu à l’isolement depuis mai 2016, lorsqu’il a été condamné à mort avec sept autres hommes par un tribunal militaire dans le cadre de l’affaire 174 de 2015 (que les médias ont surnommée « l’affaire du comité des opérations avancées ») après avoir été condamné pour appartenance à un groupe interdit (les Frères musulmans), détention d’armes à feu et d’explosifs et obtention sans autorisation d’informations militaires classées secrètes. En décembre 2016, Ahmed Amin Ghazali Amin et cinq de ses co-accusés ont formé un recours pour interjeter appel de leur condamnation. La Haute Cour militaire doit désormais fixer une date pour l’audience d’appel. Cependant, il lui est déjà arrivé dans différentes affaires de rejeter des appels sans même programmer d’audience. Si les appelants sont déboutés, ils risqueraient d’être exécutés à tout moment. Depuis mai 2016, d’après sa famille et ses avocats, Ahmed Amin Ghazali Amin est enfermé dans une cellule de deux mètres sur un mètre cinquante dans la prison de sécurité maximale al Aqrab, au Caire, la capitale égyptienne. Il ne peut passer que quinze minutes par jour hors de sa cellule, lorsqu’il se rend dans la salle de bain. Il dort sur le sol, sans pouvoir vraiment se couvrir, n’a pas suffisamment à manger et ne peut recevoir de visites qu’une fois tous les 40 jours. Son état de santé se dégrade. Le 16 mars, il s’est évanoui et a été transféré dans le centre de santé sous-équipé de la prison. Malgré de nombreuses demandes de sa famille, les autorités pénitentiaires doivent maintenant le transférer à l’hôpital de la prison, pour qu’il reçoive les soins dont il a besoin. L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus de l’ONU (les règles Mandela) interdit les détentions à l'isolement pendant des périodes prolongées et indéterminées, et les catégorise comme une forme de « restrictions ou sanctions disciplinaires [qui constituent] des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », qui ne doivent être utilisée en aucune circonstance. DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue : - appelez les autorités égyptiennes à faire rejuger par un tribunal civil toutes les personnes déclarées coupables dans l’affaire en question, sans recourir à la peine de mort et dans le cadre de procédures conformes aux normes internationales d’équité des procès et excluant les « aveux » ou tout autre élément obtenu sous la torture ou au moyen d’autres formes de mauvais traitements ; - demandez-leur de mettre fin à la détention à l'isolement d’Ahmed Amin Ghazali Amin, de s’assurer que ses conditions de détention sont humaines et qu’il est protégé de la torture et d’autres mauvais traitements, et de lui autoriser l’accès aux soins dont il a besoin ; - engagez-les à instaurer immédiatement un moratoire officiel sur les exécutions, en vue de l’abolition de la peine capitale. ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 28 AVRIL 2017 À : Ministre de l’Intérieur Minister Magdy Abde el-Ghaffar Ministry of Interior Cairo, Égypte Télécopieur : +202 2794 5529 Courriel : ou Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre, Président de la République Abdel Fattah al-Sisi Office of the President Al Ittihadia Palace Cairo, Égypte Télécopieur : +202 2391 1441 Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre, Copies à : Ministre de la Défense Colonel General Sedqi Sobhi Ministry of Defence Cairo, Égypte Télécopieur : +202 2 414 4248 / +202 2 414 4247 Courriel : , Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l’Égypte dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la quatrième mise à jour de l’AU 91/16. Pour plus d'informations : www.amnesty.org/fr/documents/mde12/5490/2017/fr/. COMPLÉMENT D’INFORMATION Après une précédente grève de la faim, Ahmed Amin Ghazali Amin avait été transféré temporairement du 11 décembre 2016 au 8 février 2017 dans la prison de Shibin el Kom, dans le gouvernorat de Menufeya, au nord du Caire, pour passer ses examens universitaires, tout en restant détenu à l’isolement. Il a depuis été à nouveau transféré dans la prison d’al Aqrab. Il a supplié deux fois les autorités de la prison de mettre fin à sa détention à l'isolement, mais ses demandes sont restées sans réponse. Le 29 mai 2016, un tribunal militaire égyptien a condamné 26 hommes dans le cadre de l’affaire 174 de 2015 pour appartenance à un groupe interdit – les Frères musulmans –, détention d’armes à feu et d’explosifs et obtention sans autorisation d’informations militaires classées secrètes, et a acquitté deux autres hommes. Huit d’entre eux ont été condamnés à mort, tandis que les 18 autres ont été condamnés à des peines allant de 15 à 25 ans d’emprisonnement. D’après leurs avocats, le tribunal a ignoré beaucoup des plaintes de disparitions forcées de ces hommes et leurs demandes d’examen médico-légal de leurs allégations de torture. Les familles et les avocats des hommes concernés ont indiqué à Amnistie internationale que ceux-ci présentaient des plaies sur le corps, notamment des brûlures et des ecchymoses, ainsi que des blessures aux mains. Les hommes avaient été arrêtés par les forces de sécurité entre le 28 mai et le 7 juin 2015 et soumis à une disparition forcée pendant plus de six semaines pour certains ; 18 au siège du Renseignement militaire à Nasr City (Le Caire) et un à la prison militaire d’al Azouly, située à l’intérieur d’un camp militaire du gouvernorat d’Ismaïlia. Huit suspects qui n’avaient pas été arrêtés ont été jugés par contumace. Les familles des condamnés ont déclaré à Amnistie internationale que, durant cette période, elles avaient tenté d’obtenir davantage d’informations dans les postes de police, les prisons et les services du parquet, mais que les autorités avaient nié les détenir voire ignoré leurs demandes. Elles n’ont découvert qu’ils étaient détenus par l’armée que le 10 juillet 2015, lorsqu’elles ont vu à la télévision une vidéo du ministère de la Défense annonçant l’arrestation de « la cellule terroriste la plus dangereuse » d’Égypte. On y voyait des détenus qui « avouaient » appartenir à des groupes interdits et avoir attaqué des institutions militaires. |
Centre de presseLe centre de presse du Secrétariat international met à la disposition des professionnels et du grand public des nouvelles de dernière minute, des commentaires de spécialistes et des informations importantes sur la situation dans le monde relative à la peine de mort. Archives
Janvier 2023
Catégories
Tous
|
Amnistie internationale Canada francophone - Abolition de la peine de mort - Tél. : 819-944-5157
Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca
Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca

 Flux RSS
Flux RSS
