 * Des travaux de terrassement, la construction de routes, des décharges publiques et de nouvelles concessions funéraires sont utilisés pour altérer et détruire des fosses communes * Les autorités iraniennes suppriment délibérément des éléments de preuve médicolégaux cruciaux, ce qui pourrait faire obstacle aux droits à la vérité, à la justice et à des réparations * Au moins 4 000 à 5 000 personnes ont été secrètement ensevelies dans des fosses communes à la suite du massacre de 1988 De nouveaux éléments de preuve incluant des analyses d'images satellites, de photos et de vidéos montrent que les autorités iraniennes détruisent délibérément des sites présumés ou avérés de fosses communes liées au massacre de 1988, au cours duquel des milliers de prisonniers incarcérés pour des motifs politiques ont été soumis à une disparition forcée et exécutés de façon extrajudiciaire, selon le rapport publié le 30 avril par Amnistie internationale et Justice for Iran. Ce rapport, intitulé Criminal cover-up: Iran destroying mass graves of victims of 1988 killings, révèle que les autorités iraniennes procèdent à des travaux de terrassage, construisent des immeubles et des routes, déposent des ordures et établissent de nouvelles concessions funéraires sur les sites de fosses communes. En procédant de la sorte, elles détruisent des éléments de preuve cruciaux qui pourraient être utilisés pour établir la vérité au sujet de l'ampleur des crimes commis et pour permettre aux victimes et à leurs proches d'obtenir justice ainsi que des réparations. Ces sites sont constamment surveillés par des services de sécurité, ce qui incite à penser que des organes judiciaires, des services de renseignement et des services de sécurité sont impliqués dans les processus décisionnels liés à leur profanation et à leur destruction. « Les atrocités commises en Iran lors du massacre de 1988 ont ouvert une plaie qui ne s'est jamais refermée. En détruisant ces éléments de preuve médicolégaux d'une importance cruciale, les autorités iraniennes renforcent délibérément un climat d'impunité », a déclaré Philip Luther, directeur des recherches et des actions de plaidoyer du programme Afrique du Nord et Moyen-Orient d’Amnistie internationale. « Il s'agit de scènes d'infraction qui doivent être protégées en tant que telles jusqu'à ce que des enquêtes médicolégales indépendantes et dignes de ce nom soient menées en vue d'identifier les restes des victimes et de déterminer les circonstances de leur mort », a déclaré Shadi Sadr, directrice de Justice for Iran. Sur l'un de ces sites, situé à Tabriz, ville du nord du pays, les autorités ont coulé du béton sur plus de la moitié de la surface de la zone où l'on soupçonne que se trouve une fosse commune. Des images satellites obtenues par Amnistie internationale et Justice for Iran montrent que d'énormes changements ont eu lieu dans cette zone entre juin 2016 et septembre 2017. Autre exemple scandaleux : dans la ville de Qorveh, dans la province du Kurdistan, les autorités ont détruit au bulldozer des pierres tombales et d'autres signes commémoratifs déposés par des proches des victimes en juillet 2016, prétextant que cette zone avait été affectée à un usage « agricole ». Depuis près de trente ans, les autorités iraniennes dissimulent de façon persistante le sort qui a été réservé aux victimes, et ne révèlent pas où se trouvent leurs corps. Il s'agit là de disparitions forcées, cette pratique constituant un crime au regard du droit international. On ignore toujours aujourd'hui combien de prisonniers ont été exécutés de façon extrajudiciaire en 1988, même si les estimations minimales font état de 4 000 à 5 000 victimes. Aucun haut responsable iranien n'a fait l'objet d'une enquête ou de poursuites judiciaires, et certains des responsables présumés continuent d'occuper des fonctions politiques ou de jouir d'une position influente au sein du système judiciaire. Les autorités ont interdit à des familles de tenir des rassemblements pour commémorer la mémoire des disparus ou de déposer des fleurs ou des messages commémoratifs sur les fosses communes, alors qu'il s'agit là de coutumes et de rites funéraires importants en Iran. Des proches de victimes ont en outre été poursuivis en justice et emprisonnés pour avoir cherché à obtenir la vérité et justice. « Cela fait trente ans que cet impitoyable massacre a eu lieu ; il est grand temps que les autorités prennent de véritables mesures pour révéler, et non dissimuler, la vérité. On ne peut pas tout simplement effacer le souvenir des personnes qui ont été tuées, ni l'ensevelir sous une dalle de béton, a déclaré Philip Luther. « Ces crimes abominables doivent faire l'objet de véritables enquêtes et tous ceux qui ont commis, ordonné ou dissimulé ces crimes doivent être déférés à la justice dans le cadre de procès équitable et sans recours à la peine de mort, a déclaré Shadi Sadr. Justice for Iran estime qu'il existe plus de 120 sites à travers l'Iran qui contiennent les restes des victimes du massacre de 1988. Le rapport fait état de sept sites présumés ou confirmés de fosses communes menacés de destruction entre 2003 et 2017. Ils sont situés à l'intérieur ou aux abords du cimetière de Behesht Reza à Mashhad, dans la province du Khorasan Razavi ; du cimetière de Behesht Abad à Ahvaz, dans la province du Khuzestan ; du cimetière de Vadieh Rahmat à Tabriz, dans la province de l'Azerbaïdjan oriental ; du cimetière de Golestan Javid à Khavaran ; du cimetière de Tazeh Abad à Rasht, dans la province de Gilan ; du cimetière baha'i de Qorveh, dans la province du Kurdistan ; et dans l'ancienne enceinte du tribunal révolutionnaire de Sanandaj, dans la province du Kurdistan. Complément d’information Le massacre de 1988 a commencé peu après la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak et l'incursion armée menée sans succès en juillet, cette année-là, par l'Organisation des moudjahiddines du peuple iranien (OMPI), alors basée en Irak. Des personnes de tout le pays incarcérées pour des motifs politiques étaient détenues au secret. En août et en septembre, des informations ont circulé signalant que des prisonniers étaient exécutés en groupe et enterrés dans des fosses communes anonymes. Des proches désemparés ont recherché dans les cimetières des environs des traces de tombes récemment creusées. On ignore aujourd'hui encore ce qu'il est advenu de la plupart des victimes, et où se trouvent leurs corps. À partir de la fin de l'année 1988, les autorités ont indiqué verbalement aux familles de victimes que leurs proches avait été tués, sans fournir d'information sur les circonstances de leur mort. Les corps n'ont pas été rendus aux familles et les autorités n'ont pas révélé où se trouvaient la plupart des sites d'inhumation. La plupart des détenus exécutés de façon extrajudiciaire purgeaient de lourdes peines d'emprisonnement, infligées souvent en raison de leur dissidence pacifique, notamment pour des activités telles que la distribution de journaux et de brochures, la participation à des manifestations contre le gouvernement, et une affiliation supposée ou avérée à divers groupes de l'opposition politique. Certaines de ces personnes libérées plusieurs années auparavant ont été de nouveau arrêtées au cours des semaines qui ont précédé le massacre. D'autres avaient fini de purger leur peine mais n’avaient pas été libérées parce qu’elles avaient refusé de faire une déclaration de « repentir ».
0 Commentaires
Action urgente - Bahreïn. Il faut réexaminer des condamnations à mort qui avaient été confirmées.4/19/2018 Le 28 mars 2018, le procureur a annoncé qu'il avait demandé la révision des cas de Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain et Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed, tous deux ayant vu leurs condamnations à mort confirmées par la Cour de cassation en novembre 2015, tandis que de nouveaux éléments ont été mis au jour par les investigations de l'Unité des enquêtes spéciales.
Le 28 mars, le procureur a publié une déclaration, dans laquelle il a affirmé que son bureau avait reçu une note de l’Unité des enquêtes spéciales (SIU) en lien avec ses investigations sur les plaintes déposées par Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain et Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed. L’Unité recommandait que ces affaires fassent l’objet d’un réexamen, même si les condamnations à mort des deux hommes ont déjà été confirmées par la Cour de cassation. Les dossiers ont été transmis au ministre de la Justice afin qu'il examine cette recommandation. L’Unité des enquêtes spéciales assure avoir découvert des rapports médicaux rédigés par les médecins du ministère de l'Intérieur concernant les actes de torture qu'auraient subis les deux hommes, rapports qui n'ont pas été présentés au tribunal avant qu'il ne rende son verdict. Les condamnations à mort de Mohamed Ramadhan et d'Hussain Ali Moosa ont été confirmées par la Cour de cassation le 16 novembre 2015 et sont désormais entre les mains du roi, qui a le pouvoir de ratifier les sentences, de les commuer ou de gracier les condamnés. Les deux hommes sont détenus à la prison de Jaww au sud de Manama, la capitale de Bahreïn. Le 29 décembre 2014, ils ont été condamnés à mort pour le meurtre d'un policier, tué lors de l'explosion d'une bombe dans le village d'al Deir, au nord-est de Manama, le 14 février 2014. Dans le cadre de la même affaire, les peines de 10 autres personnes, allant de six ans de prison à la réclusion à perpétuité, ont aussi été confirmées. Lors du procès, les « aveux » de Hussain Ali Moosa, obtenus sous la contrainte, ont été utilisés comme principal élément de preuve à charge contre lui. Ses « aveux » ont également servi à incriminer Mohamed Ramadhan. DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue : - exhortez les autorités bahreïnites à commuer toutes les condamnations à mort et à instaurer un moratoire officiel sur les exécutions ; - appelez-les à ordonner que les deux hommes soient entièrement rejugés, dans le cadre de procédures pleinement conformes aux normes internationales d'équité, excluant tout élément de preuve obtenu sous la torture et tout recours à la peine de mort ; - demandez-leur également de mener dans les meilleurs délais une enquête adéquate et efficace sur leurs allégations de torture et d’autres mauvais traitements. ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 31 MAI 2018 À : Roi de Bahreïn Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa Office of His Majesty the King P.O. Box 555 Rifa’a Palace, al-Manama, Bahreïn Télécopieur : +973 1766 4587 Formule d’appel : Your Majesty, / Sire, (Votre Majesté, dans le corps du texte) Ministre de la Justice et des Affaires islamiques Shaikh Khalid bin Ali Al Khalifa Ministry of Justice and Islamic Affairs P.O. Box 450, al-Manama, Bahreïn Télécopieur : +973 1753 1284 Courriel : http://www.moj.gov.bh/en (formulaire à remplir) Twitter : @Khaled_Bin_Ali Copies à : Ministre de l’Intérieur Shaikh Rashid bin ‘Abdullah Al Khalifa Ministry of Interior P.O. Box 13, al-Manama, Bahreïn Télécopieur : +973 1723 2661 Twitter : @moi_Bahrain Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre, Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de Bahreïn dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la quatrième mise à jour de l’AU 200/15. Pour plus d’informations : https://www.amnesty.org/fr/documents/mde11/5516/2017/fr/. COMPLÉMENT D’INFORMATION Bahreïn a repris les exécutions le 15 janvier 2017, après une interruption de près de sept ans. Condamnés à mort à l’issue d'un procès manifestement inique, trois hommes, Ali Abdulshahed al Sankis, Sami Mirza Mshaima et Abbas Jamil Taher Mhammad al Samea, ont été exécutés ce jour-là, après confirmation de leur peine par la Cour de cassation le 9 janvier. La vitesse à laquelle le roi a ratifié leur condamnation à mort et la rapidité avec laquelle leur exécution a été appliquée étaient sans précédent à Bahreïn. En vertu du droit bahreïnite, une fois qu’une condamnation à mort a été confirmée par la Cour de cassation, elle est soumise au souverain. Celui-ci peut ensuite ratifier la peine, la commuer ou gracier le condamné. Avant les exécutions du 15 janvier, la dernière exécution qui avait eu lieu à Bahreïn était celle de Jassim Abdulmanan, un ressortissant bangladais, en 2010. Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain et Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed ont déclaré à leurs avocats qu'ils avaient été soumis à des actes de torture ou d'autres mauvais traitements au cours des premiers jours ayant suivi leurs arrestations respectives, entre février et mars 2014, pendant qu'ils étaient interrogés au siège de la Direction des enquêtes criminelles. En l'absence de leurs avocats, Mohamed Ramadhan a refusé de signer des « aveux », mais Hussain Ali Moosa assure avoir été contraint d’« avouer » et d’accuser Mohamed Ramadhan après avoir été suspendu au plafond par les membres et battu à maintes reprises pendant plusieurs jours. Ses « aveux » ont ensuite été utilisés comme principal élément à charge lors du procès et ont abouti à la condamnation des deux hommes. Hussain Ali Moosa a indiqué à ses avocats qu'il avait signalé ses « aveux » forcés et les actes de torture subis au procureur général, mais que ce dernier avait écarté ses allégations et l'avait renvoyé à la Direction des enquêtes criminelles, où il avait de nouveau été torturé pendant deux mois. Mohamed Ramadhan a affirmé avoir lui aussi signalé les actes de torture subis au procureur général, ajoutant que ses allégations avaient été écartées. Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain et Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed ont formé un recours contre leur condamnation à mort devant la Haute Cour criminelle d’appel le 30 mars 2015. Aucun nouvel élément de preuve n’a été présenté en appel. Les avocats des deux hommes ont simplement reçu une copie du jugement original lors de la première audience d'appel. À la deuxième audience, ils ont demandé au tribunal l'autorisation de citer des témoins à l'audience suivante car ils avaient manqué de temps pour préparer la défense. Le juge a rejeté leur requête et ajourné l'audience au 26 mai 2015 afin qu'une décision finale soit rendue, avant même que les avocats puissent présenter leurs plaidoiries. La Cour a confirmé leur condamnation à mort ce jour-là. Malgré les plaintes déposées en 2014 par l’épouse de Mohamed Ramadhan et une ONG basée aux États-Unis, le bureau du médiateur n'a mené aucune enquête sur ses allégations de torture pendant les deux années qui ont suivi. En avril 2016, le médiateur a informé à tort le gouvernement britannique qu'il n'avait été avisé « d'aucune allégation de mauvais traitement ou de torture » en lien avec Mohamed Ramadhan. Sous la pression internationale, le médiateur a déclaré au gouvernement britannique en juillet 2016 qu'il s'était engagé à entreprendre une « enquête complète et indépendante », et a mené par la suite des entretiens avec la femme de Mohamed Ramadhan et son avocat. Pour plus d’informations, consultez le rapport de novembre 2016 d’Amnesty : Window-dressing or pioneers of change? An assessment of Bahrain’s human rights oversight bodies (https://www.amnesty.org/fr/documents/mde11/5080/2016/fr/). À ce jour, 142 pays ont aboli la peine capitale en droit ou en pratique. Le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des actes de torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’homme et par d’autres instruments internationaux relatifs aux droits humains. Amnistie internationale s’oppose en toutes circonstances et sans aucune exception à la peine capitale car elle constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit, ainsi qu’une violation du droit à la vie.  Asmaa al Omeissy a quitté le sud du Yémen pour trouver la sécurité et retrouver son père à Sanaa, la capitale du Yémen. Mais la jeune femme de 22 ans, mère de deux enfants en bas âge, a subi un calvaire qui l'a amenée à devenir la première femme yéménite, à notre connaissance, condamnée à mort pour des infractions liées à la « sûreté de l’État ». En septembre 2016, son mari, soupçonné d'appartenance à Al Qaïda, s'est enfui et l'a quittée lors d'une embuscade tendue par les forces de la coalition menée par l'Arabie saoudite non loin de la ville d'al Mukalla, dans le sud du pays. Après l'avoir brièvement détenue à la suite de cette embuscade, les soldats de la coalition l'ont laissée repartir. Ce n'était que le début de ses problèmes. Un ami de la famille lui avait proposé de la conduire d'al Mukalla jusqu'à Sanaa, ville placée sous le contrôle des Houthis, afin qu'elle puisse retrouver son père. Un homme a fait le voyage avec eux. Le 7 octobre 2016, les forces de sécurité houthies ont arrêté leur véhicule à un poste de contrôle de la capitale et les ont emmenés pour les interroger. À la suite de leur arrestation, le père d'Asmaa al Omeissy a été convoqué et arrêté lui aussi. Leur arrestation a marqué le début d'une terrible série d'épreuves incluant une disparition forcée, des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements, ainsi qu'une condamnation à mort prononcée à l'issue d'un procès manifestement inique. Comme ces violations commises par les Houthis sont liées au conflit au Yémen, elles pourraient constituer des crimes de guerre. Des organisations de défense des droits ont indiqué que depuis que le groupe armé houthi et ses alliés ont pris le contrôle de vastes régions du Yémen fin 2014, des milliers de personnes ont été arrêtées de façon arbitraire et soumises à une disparition forcée et à la torture en raison de leur appartenance politique ou de leurs croyances religieuses supposées. Amnistie internationale et d'autres organisations locales et internationales de défense des droits humains ont rassemblé des informations sur de tels cas et demandé aux Houthis de respecter leurs obligations découlant du droit international. Mais au lieu de tenir compte de ces appels, les Houthis ont intensifié la répression exercée contre leurs opposants et ceux qui les critiquent, notamment les journalistes et les défenseurs des droits humains. Parmi ceux qui ont été arrêtés figurent des personnes considérées comme soutenant leurs adversaires, à savoir le gouvernement yéménite reconnu par l'ONU, basé dans le sud du pays, et ses soutiens, les membres de la coalition menée par l'Arabie saoudite. De plus, les Houthis utilisent de plus en plus le système judiciaire pour régler des comptes politiques, ce qui a donné lieu à des procès manifestement iniques s'étant soldé par des peines de mort. Ces procès ainsi que la procédure qui y a abouti démontrent un mépris total pour le droit yéménite et le droit international. Ainsi, Asmaa al Omeissy et ses trois coaccusés ont été empêchés pendant plusieurs mois d'avoir des contacts avec le monde extérieur, pendant qu'ils étaient déplacés d'un lieu de détention à un autre, y compris une annexe « secrète » du Département des enquêtes criminelles. Elle n'a pu obtenir aucune nouvelle de ses deux enfants, issus d'un précédent mariage et à présent âgés de quatre et sept ans, qui vivent actuellement chez des proches dans le sud du pays. Asmaa al Omeissy a été frappée sous les yeux de son père, Matir al Omeissy, qui est âgé de 50 ans ; elle a notamment été frappée à coups de poing et avec un bâton par une policière, m'a dit son père. On l'a aussi forcée à regarder pendant que deux autres personnes, arrêtées dans le cadre de la même affaire, étaient torturées, pendues au plafond par les poignets et frappées à coups de pied et de poing sur tout le corps. On l'a interrogée au sujet de liens présumés avec Al Qaïda, et accusée à tort d'avoir eu des « relations sexuelles illégitimes » avec ses compagnons de voyage masculins. « Il s'agit d'une guerre psychologique », m'a dit le père d'Asmaa al Omeissy. « Pouvez-vous imaginer ce que cela représente pour une femme d'être enfermée seule dans une salle [d'interrogatoire] et accusée de telles choses alors que vous êtes innocente ?, a-t-il dit, expliquant que ceux qui l'interrogeaient avaient essayé de la briser en attaquant son « honneur ». Au Yémen, les relations extraconjugales sont à la fois illégales et un sujet tabou. C'est seulement en mai 2017 qu'Asmaa al Omeissy et les autres personnes ont finalement été inculpées et déférées au tristement célèbre Tribunal pénal spécial de Sanaa, chargé de juger les affaires liées au « terrorisme » et à la «Sécurité de l'État ». Elle est notamment accusée d'avoir « aidé un pays étranger en guerre avec le Yémen », ce qui fait référence aux Émirats arabes unis, membres de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Aucun des accusés n'a bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours du procès. Les trois hommes ont bénéficié d'une libération sous caution plusieurs mois avant le verdict, d'eux d'entre eux notamment pour raisons médicales, mais l'on ignore pourquoi Asmaa al Omeissy est la seule à avoir été maintenue en détention dans cette affaire. Les trois hommes se sont par la suite enfuis dans des régions du Yémen n'étant pas contrôlées par les Houthis, et elle comparaissait seule devant le tribunal le 30 janvier quand le juge a condamné la jeune femme et deux de ses coaccusés à la peine de mort. Les accusations fallacieuses relatives à des « actes indécents » ont abouti pour elle à une peine supplémentaire de 100 coups de fouet, et pour son père à une peine de 15 ans d'emprisonnement. Les personnes qui ont parlé avec Asmaa al Omeissy à la prison centrale de Sanaa m'ont indiqué que son moral est au plus bas. Ses conditions de détention restent totalement inadéquates. Elle doit payer pour sa nourriture, n'a aucun accès à des vêtements ni à des produits d'hygiène, et ses proches ne lui ont pas rendu visite car ils craignent d'être à leur tour placés en détention. Les conditions de détention dans les prisons yéménites sont de longue date inhumaines et dégradantes, mais des militants locaux ont dit qu'elles n'ont fait qu'empirer sous les Houthis. Les détenus sont entassés dans des cellules répugnantes et surpeuplées, et on leur extorque systématiquement de l'argent. Des violences infligées à des détenues, notamment le viol et d'autres formes de violences sexuelles, ont été signalées dans le passé, mais des militants se sont dits choqués par la multiplication ces derniers temps des informations faisant état de tels actes. Un défenseur des droits humains m'a dit que son organisation a rassemblé des informations sur plusieurs centaines de cas de détenues soumises à la torture et à une humiliation, notamment à une « utilisation dégradante des prisonnières pour des travaux de construction ». Le père d'Asmaa al Omeissy m'a dit qu'il veut que le monde entier soit averti de ce cas et du fait que la jeune femme est innocente. Un avocat a déposé un recours en appel en son nom, mais il a eu beaucoup de mal à obtenir le dossier de cette affaire auprès du tribunal. Parallèlement à cela, le tribunal prononce de nombreuses peines de mort ; il a ainsi condamné à mort en janvier Hamid Haydara, un prisonnier d'opinion âgé de 52 ans qui appartient à la communauté baha’ie. Les autorités houthies doivent mettre un terme à cette parodie de justice : elles doivent immédiatement annuler ces condamnations contestables et ces sentences capitales, et mettre fin à l'utilisation de ce châtiment cruel par nature. Chaque jour qu'Asmaa al Omeissy passe derrière les barreaux dans le quartier des condamnés à mort ne fait qu'accroître cette injustice, l'expose à des violations supplémentaires de ses droits, et représente du temps volé à ses enfants. 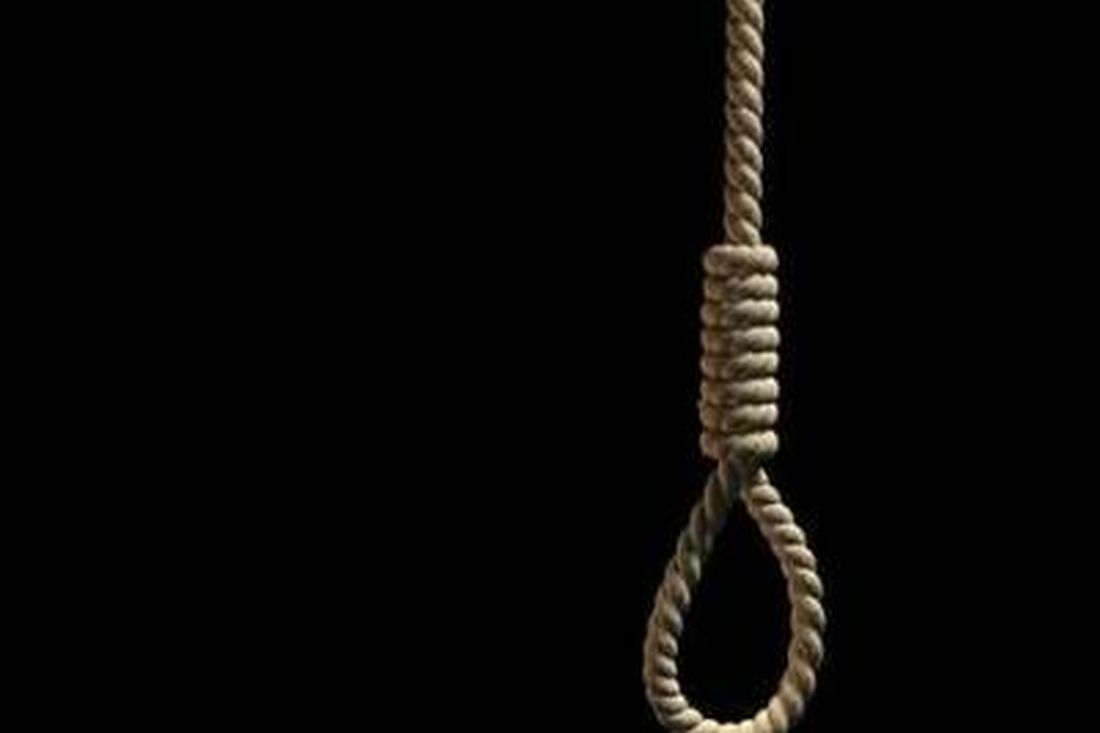 En Afrique du Nord, seule l’Égypte a procédé à des exécutions en 2017. La Tunisie, l’Algérie, et le Maroc et le Sahara occidental n’ont pas mis de prisonnier à mort depuis le début des années 90. Aucun de ces pays ne s’est cependant engagé à abolir la peine capitale en droit. Diverses dispositions juridiques dans chacun de ces États continuent à prévoir la peine de mort, ce qui va à l’encontre de la tendance internationale vers l’abolition de ce châtiment et vers le respect du droit à la vie. Si aucune exécution n’a eu lieu en Tunisie depuis 1991, Amnistie internationale a cependant recensé 25 condamnations à mort prononcées par les tribunaux à l’issue de procès en relation avec la sécurité nationale, contre 44 en 2016, ce qui semble indiquer une tendance à la baisse. À la fin de l’année 2017, au moins 77 personnes se trouvaient sous le coup d’une sentence capitale en Tunisie. En 2017, l’organisation a répertorié 27 condamnations à mort en Algérie, moins que les 50 recensées en 2016. Mais l’ampleur véritable de l’imposition de ce châtiment en Algérie n’est pas connue, les données officielles n’étant pas divulguées par les autorités. Quant au Maroc et au Sahara occidental, les tribunaux ont, selon des informations fournies par le gouvernement, prononcé au moins 15 condamnations à mort en 2017, contre au moins six en 2016. Quelque 95 personnes étaient sous le coup d’une sentence capitale à la fin de l’année 2017. « Les États de la région continuent de prendre des mesures en vue de limiter le recours à la peine capitale ou d’abolir ce châtiment alors que l’année 2018 est déjà bien entamée, et les derniers pays du monde qui procèdent encore à des exécutions se trouvent d’autant plus isolés », a déclaré Salil Shetty, secrétaire général d’Amnistie internationale. « Maintenant que 20 pays d’Afrique sub-saharienne ont aboli la peine de mort pour toutes les infractions, il est grand temps que le reste du monde suive leur exemple et renonce à ce châtiment abject et d’un autre âge. » Ailleurs sur le continent, une baisse du nombre de pays procédant à des exécutions a été constatée en Afrique sub-saharienne (deux en 2017 contre cinq en 2016) : seuls le Soudan du Sud et la Somalie ont semble-t-il ôté la vie à des condamnés l’an dernier. Le Botswana et le Soudan ont selon certaines informations repris les exécutions en 2018, mais Amnistie internationale souligne que cela ne doit pas éclipser les mesures positives prises par d’autres pays de la région. Des progrès considérables partout Si Amnistie internationale a fait état d’une baisse du recours à la peine de mort au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2017 par rapport à 2016, l’Égypte a prononcé la plupart des condamnations à ce châtiment dans cette région. Au moins 402 personnes ont été condamnées à mort par des tribunaux de droit commun et des tribunaux militaires à l'issue de procès collectifs d'une iniquité flagrante, contre 237 en 2016. En Égypte, les condamnations à mort enregistrées ont augmenté d’environ 70 % par rapport à 2016. Par ailleurs, certains pays, qui sont pourtant d’ardents défenseurs de la peine de mort, ont pris des mesures visant à limiter son imposition. En Iran, les exécutions recensées ont baissé de 11 % et la proportion d’exécutions consécutives à des infractions liées aux stupéfiants a été ramenée à 40 %. Des démarches ont également été entreprises pour relever le seuil à partir duquel la possession de stupéfiants entraînait obligatoirement une condamnation à mort. En Malaisie, la législation relative aux stupéfiants a été modifiée de sorte que le choix de la peine soit laissé à la discrétion des juges dans les affaires de ce type. Ces changements contribueront probablement à réduire le nombre de condamnations à mort prononcées dans ces deux pays. « Le fait que des pays continuent d’avoir recours à la peine de mort pour des infractions liées aux stupéfiants demeure inquiétant. Néanmoins, les mesures prises par l’Iran et la Malaisie pour modifier leur législation relative aux stupéfiants sont le signe que des failles apparaissent, même dans la minorité de pays qui continuent de procéder à des exécutions », a déclaré Salil Shetty. « En dépit des grandes avancées vers l’abolition de ce châtiment abject, quelques dirigeants continuent de recourir à la peine de mort comme solution de fortune plutôt que de traiter les problèmes à la racine grâce à des politiques humaines, efficaces et fondées sur des éléments concrets. Un dirigeant fort promeut la justice et non la peine capitale », a déclaré Salil Shetty. Le nombre de pays procédant à des exécutions n’a pas changé. Cependant, Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Jordanie et le Koweït ont repris les exécutions après une période d’interruption. L’avenir Sachant qu’au moins 21 919 personnes dans le monde sont sous le coup d’une condamnation à mort, ce n’est pas le moment de relâcher la pression. Des mesures positives ont été prises en 2017 et leurs effets ne se feront pleinement sentir que dans les mois et les années à venir. Toutefois, certains pays font marche arrière – ou menacent de le faire – et il est donc toujours aussi essentiel de faire campagne contre la peine de mort. Amnistie internationale demande aux autorités en Algérie, au Maroc/Sahara occidental, et en la Tunisie de commuer toutes les condamnations à mort, dans l’objectif d’abolir la peine capitale. « Depuis 40 ans, nous assistons à un changement important et encourageant des perspectives mondiales relatives à la peine de mort, mais il est nécessaire de prendre des mesures plus immédiates pour mettre un terme à la pratique terrifiante des homicides d’État », a déclaré Salil Shetty. « La peine capitale s’inscrit dans une culture marquée par la violence, sans apporter de remède à ce fléau. Nous savons qu’en mobilisant des personnes des quatre coins de la planète, nous pouvons lutter contre la peine de mort et mettre fin à ce châtiment cruel partout dans le monde. » Guinée. « Comment j'ai rassemblé des gens et demandé à la Guinée d'abolir la peine de mort »4/12/2018  Souleymane Sow, 43 ans, est un homme investi d'une mission. Il fait du bénévolat au sein d'Amnistie internationale depuis qu'il est étudiant. Comme il avait la volonté de faire bouger les choses, il est retourné en Guinée, où il a créé un groupe local de bénévoles d'Amnistie internationale, et ils se sont mis au travail. Leur objectif ? Promouvoir l'importance des droits humains, faire de l'éducation aux droits humains et œuvrer pour l'abolition de la peine de mort. En collaboration avec 34 autres ONG, ils ont atteint leur objectif. J'ai toujours été opposé à la peine de mort. Il y a tellement de gens qui ont été tués sous le premier régime, uniquement à cause de leurs opinions politiques. J'ai encore plus voulu me battre pour l'abolition de ce châtiment quand j'ai vu ces personnes qui avaient perdu leurs parents. Lorsque je suis retourné en Guinée, j'ai formé un groupe de bénévoles et nous nous sommes mis à faire de l'éducation aux droits humains auprès de la population. Des élections ont eu lieu en 2015 et il y a eu le lancement d'un nouveau programme, axé sur le renouvellement de toute notre législation au Parlement. Je savais que je tenais là une occasion à ne pas manquer de faire entendre notre voix. J'ai pris contact avec le bureau régional d'Amnistie internationale à Dakar, pour voir comment nous pouvions mener un travail de pression contre la peine de mort. Ils nous ont rejoints dans notre projet et nous avons publié une déclaration sur les changements que nous attendions. Une dynamique s'est engagée et 34 autres ONG ont décidé de nous rejoindre dans notre mission consistant à obtenir l'abolition de la peine de mort en Guinée. Nous avons organisé, pas à pas, des entretiens avec des ministres et des députés, en expliquant pourquoi il fallait abolir cette épouvantable pratique. Je leur ai fourni toutes les informations dont ils avaient besoin et les discussions ont été franches et honnêtes. La campagne s'est accélérée et nous avons fait entendre notre voix. Nous avons distribué du matériel de campagne, comme des autocollants et des tee-shirts, pour réclamer l'abolition de la peine de mort. J'ai été invité au ministère de la Justice pour discuter de façon plus approfondie de cette question, et j'ai exposé mes arguments en étant décidé à les faire changer d'avis : c'était essentiel de parler avec les gens afin de leur expliquer pourquoi la peine de mort devait être supprimée. Nous les avons écoutés et avons répondu à leurs propres arguments, en donnant des exemples et en expliquant de façon étayée pourquoi la peine de mort n'avait pas sa place dans la société actuelle. Avec mes camarades, nous avons mené un travail de pression contre la peine de mort chaque jour pendant cinq mois. En 2016, l'Assemblée nationale de Guinée a approuvé un nouveau Code pénal supprimant la peine de mort de la liste des peines applicables. L'an dernier, elle a également été supprimée pour le tribunal militaire. Il s'agit d'une réussite incroyable, qui démontre l'importance du pouvoir du peuple. C'était la première fois qu'un aussi grand nombre d'ONG se rassemblaient pour mener campagne sur cette question. Les gens ont dit qu'ils étaient contents de notre travail et qu'ils se rendaient compte qu'il est possible de faire bouger les choses. Et surtout, cela nous encourage à continuer de faire campagne. Il reste encore beaucoup à faire en Guinée, mais compte tenu de l'impact de notre action, je sais que nous pouvons obtenir encore beaucoup d'améliorations.  Chiffres mondiaux Amnistie internationale a recensé au moins 993 exécutions dans 23 pays en 2017, soit 4 % de moins qu'en 2016 (où 1 032 exécutions avaient été enregistrées) et 39 % de moins qu'en 2015 (année où l'organisation avait relevé le chiffre le plus élevé depuis 1989 : 1 634 exécutions). La plupart des exécutions ont eu lieu, par ordre décroissant, en Chine, en Iran, en Arabie saoudite, en Irak et au Pakistan. Cette année encore, c’est en Chine qu’ont été exécutés le plus grand nombre de prisonniers. Toutefois, il s’avère impossible d’obtenir des chiffres précis sur l’application de la peine capitale dans le pays, ces données étant classées secret d’État. Aussi le chiffre d'au moins 993 personnes exécutées dans le monde n’inclut-il pas les milliers d’exécutions qui ont probablement eu lieu en Chine. Hormis la Chine, quatre pays seulement sont responsables de près de 84 % des exécutions recensées : l'Iran, l’Arabie saoudite, l’Irak et le Pakistan. En 2017, à la connaissance d’Amnistie internationale, 23 pays ont procédé à des exécutions, comme en 2016. Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Jordanie et le Koweït ont repris les exécutions en 2017. À l'inverse, Amnistie internationale n'a enregistré aucune exécution dans cinq des pays qui avaient appliqué la peine de mort en 2016 : le Botswana, l'Indonésie, le Nigeria, le Soudan et Taiwan. Le nombre d'exécutions a considérablement baissé au Bélarus (baisse de 50 %, le pays étant passé d'au moins quatre à au moins deux exécutions), en Égypte (moins 20 %), en Iran (moins 11 %), au Pakistan (moins 31 %) et en Arabie saoudite (moins 5 %). En revanche, il a doublé ou presque doublé dans l'État de Palestine (passant de trois en 2016 à six en 2017), à Singapour (de quatre à huit) et en Somalie (de 14 à 24). En 2017, deux pays – la Guinée et la Mongolie – ont aboli la peine de mort dans leur législation pour tous les crimes. Le Guatemala est devenu abolitionniste pour les crimes de droit commun uniquement. La Gambie a signé un traité international engageant le pays à ne pas procéder à des exécutions et à s'orienter vers l'abolition de la peine de mort dans sa législation. À la fin de l'année 2017, 106 pays (la majorité des États dans le monde) avaient aboli la peine de mort dans leur législation pour tous les crimes et 142 (plus des deux tiers des États) étaient abolitionnistes en droit ou en pratique. D’après les informations dont dispose Amnistie internationale, des condamnés à mort ont bénéficié d'une commutation ou d'une grâce dans les 21 pays suivants : Bangladesh, Cameroun, Chine, Égypte, Émirats arabes unis, États-Unis, Inde, Indonésie, Japon, Koweït, Malaisie, Maroc/Sahara occidental, Mauritanie, Nigeria, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Qatar, Sri Lanka, Taiwan, Tunisie et Zimbabwe. Cinquante-cinq prisonniers condamnés à mort ont été innocentés dans six pays : Chine, États-Unis, Maldives, Nigeria, Taiwan et Zambie. Amnistie internationale a enregistré au moins 2 591 condamnations à mort dans 53 pays en 2017, ce qui représente une baisse notable par rapport au chiffre record de 3 117 enregistré en 2016. Fin 2017, au moins 21 919 personnes se trouvaient dans le quartier des condamnés à mort. Les méthodes d’exécution utilisées en 2017 à travers le monde ont été les suivantes : la décapitation, la pendaison, le peloton d'exécution et l’injection létale. Des exécutions ont eu lieu en public en Iran (au moins 31). Amnistie internationale a reçu en 2017 des informations signalant qu’au moins cinq personnes exécutées en Iran avaient moins de 18 ans au moment des faits pour lesquels elles avaient été condamnées à mort. Dans nombre de pays où des gens ont été condamnés à mort ou exécutés, la peine capitale a été prononcée à l’issue d’une procédure non conforme aux normes internationales d’équité des procès. Dans certains cas, des « aveux » ont été arrachés au moyen de la torture ou d’autres mauvais traitements, notamment en Arabie saoudite, à Bahreïn, en Chine, en Irak et en Iran. Analyse par région Amériques Pour la neuvième année consécutive, les États-Unis ont été le seul pays du continent américain à exécuter des prisonniers. Le nombre d’exécutions (23) et de sentences capitales (41) recensées aux États-Unis a légèrement augmenté par rapport à l'année 2016, mais est resté dans les moyennes historiquement faibles enregistrées ces dernières années. Pour la deuxième année consécutive et la deuxième fois depuis 2006, les États-Unis n'ont pas figuré parmi les cinq pays du monde pratiquant le plus grand nombre d’exécutions ; ils sont passés du 7e au 8e rang mondial. Huit États du pays ont exécuté des condamnés, contre cinq en 2016, l'Arkansas, l'Ohio et la Virginie ayant repris les exécutions après une interruption de plusieurs années. Quatre États – l'Idaho, le Mississippi, le Missouri et le Nebraska – ainsi que des tribunaux fédéraux ont prononcé des peines de mort en 2017, après une interruption, ce qui a porté à 15 le nombre d'États de ce pays ayant prononcé des sentences capitales (deux de plus qu'en 2016). À l'inverse, la Caroline du Nord, le Kansas et l'Oregon, qui avaient condamné des prisonniers à la peine capitale en 2016, ne l'ont pas fait en 2017. Seuls trois pays de la région – les États-Unis, le Guyana et Trinité-et-Tobago – ont prononcé des condamnations à mort. Le Guatemala est devenu le 142e pays à abolir la peine capitale en droit et en pratique. Asie et Pacifique D'après les informations disponibles, au moins 93 exécutions ont eu lieu dans neuf pays de la région en 2017, ce qui représente une baisse notable par rapport aux 130 exécutions au moins enregistrées dans 11 pays en 2016. Cette diminution est due au recul constaté au Pakistan, où une baisse de 31 % du nombre d'exécutions a été enregistrée. Toutefois, ces chiffres n’incluent pas les milliers d’exécutions qui, selon Amnistie internationale, ont eu lieu en Chine. Le nombre d'exécutions recensées à Singapour a doublé par rapport à 2016, passant de quatre à huit. Toutes ces exécutions concernent des personnes condamnées pour des infractions liées aux stupéfiants. Au moins 1 037 nouvelles peines de mort ont été prononcées, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2016. Cette baisse est liée aux variations enregistrées dans un certain nombre de pays, et aux statistiques fournies à Amnistie internationale par les autorités. Le nombre de peines de mort enregistrées en Inde, en Indonésie, au Pakistan et en Thaïlande, entre autres, a diminué par rapport à 2016. Des augmentations ont été enregistrées pour certains pays comme le Bangladesh (où ce nombre est passé d'au moins 245 à au moins 273), Singapour (où il est passé d'au moins 7 à 15) et le Sri Lanka (où il est passé d'au moins 79 à 218). À la connaissance d'Amnistie internationale, 18 pays de la région ont prononcé des sentences capitales en 2017, ce chiffre étant inchangé par rapport à 2016. Le Brunéi Darussalam a prononcé une peine de mort, alors qu'il n'en avait prononcé aucune en 2016 ; la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a prononcé aucune sentence capitale en 2017, contrairement à l'année précédente. Dans la région Asie et Pacifique, la peine de mort a été massivement prononcée pour des infractions ne répondant pas aux critères définissant les « crimes les plus graves », ce qui va à l'encontre du droit international. Europe et Asie centrale Dans la région Europe et Asie centrale, le Bélarus a été le seul pays à procéder à des exécutions. Deux exécutions au moins ont eu lieu dans ce pays en 2017, et au moins quatre nouvelles sentences capitales y ont été prononcées. Un homme était toujours sous le coup d’une condamnation à la peine capitale au Kazakhstan. La Fédération de Russie, le Kazakhstan et le Tadjikistan ont maintenu leur moratoire sur les exécutions. Moyen-Orient et Afrique du Nord Le recours à la peine de mort a connu un léger recul en 2017. Le nombre d'exécutions recensées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a diminué de 1 %, passant de 856 exécutions en 2016 à 847 en 2017. L’Iran, l’Arabie saoudite et l’Irak sont restés les trois pays procédant au plus grand nombre d'exécutions, totalisant à eux seuls 92 % des exécutions enregistrées dans la région. L’Iran a exécuté au moins 507 personnes, ce qui représentait 60 % de l’ensemble des exécutions confirmées dans la région. L’Arabie saoudite a exécuté 146 personnes, ce chiffre représentant 17 % de l'ensemble des exécutions confirmées dans la région. Au moins 264 personnes ont été exécutées pour des infractions liées aux stupéfiants (27 % de l'ensemble des exécutions recensées en 2017). Amnistie internationale a pu vérifier qu'au moins 619 condamnations à mort avaient été prononcées dans la région en 2017, un nombre en baisse comparé aux 764 sentences capitales enregistrées en 2016. L'Égypte a prononcé au moins 402 peines de mort, ce qui représentait le chiffre le plus élevé de la région. Afrique subsaharienne Des mesures positives ont été prises dans toute l'Afrique subsaharienne, conduisant à une diminution du nombre enregistré de pays procédant à des exécutions. Des exécutions ont été enregistrées dans deux pays (la Somalie et le Soudan du Sud) en 2017, contre cinq pays en 2016. Vingt-huit prisonniers ont été exécutés, 24 en Somalie et quatre au Soudan du Sud, soit une légère hausse par rapport aux 22 exécutions au moins recensées en 2016. Le nombre de condamnations à mort a diminué, passant de 1 086 au moins en 2016 à 878 au moins en 2017. Le Nigeria est le pays de la région qui a prononcé le plus grand nombre de condamnations à mort et qui comptait le plus grand nombre de prisonniers sous le coup d’une sentence capitale à la fin de l’année. La Guinée a aboli la peine de mort pour tous les crimes. Le Burkina Faso, la Gambie, le Kenya et le Tchad ont grandement progressé sur la voie de l’abolition de ce châtiment.  Peine de mort. L'Afrique subsaharienne représente « une lueur d'espoir » dans un contexte de baisse à l'échelle mondiale du nombre d'exécutions et de sentences capitales
L'Afrique subsaharienne a réalisé d'importants progrès en vue de l'abolition de la peine de mort, avec une diminution significative du nombre de sentences capitales recensées dans toute la région, comme le souligne Amnistie internationale dans son rapport mondial sur le recours à la peine de mort en 2017, rendu public le 12 avril 2018. La Guinée est devenue le 20e État de l'Afrique subsaharienne ayant aboli la peine de mort pour tous les crimes, et le Kenya a supprimé le recours obligatoire à ce châtiment en cas de meurtre. Le Burkina Faso et le Tchad ont également pris des mesures pour le supprimer en adoptant de nouvelles lois ou en déposant des projets de loi en ce sens. « Du fait des progrès enregistrés en Afrique subsaharienne, cette région continue de représenter une source d'espoir en ce qui concerne l'abolition. Les dirigeants de certains pays de la région ont pris des mesures qui permettent d'espérer que le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit sera prochainement aboli, a déclaré le secrétaire général d'Amnistie internationale, Salil Shetty. « S'ils continuent en 2018 de prendre des mesures pour restreindre le recours à la peine de mort et pour la supprimer, les pays qui continuent à travers le monde de procéder à des exécutions vont se retrouver extrêmement isolés. « Étant donné que 20 pays de l'Afrique subsaharienne ont à présent aboli la peine de mort pour tous les crimes, il est grand temps que les autres pays du monde suivent leur exemple et relèguent dans les livres d’histoires cet abominable châtiment. » L'organisation a enregistré une baisse du nombre de pays procédant à des exécutions en Afrique subsaharienne, ce dernier étant passé de cinq en 2016 à deux en 2017 : le Soudan du Sud et la Somalie sont les seuls pays, à la connaissance d'Amnistie internationale, ayant procédé à des exécutions en 2017. Les informations signalant que le Botswana et le Soudan ont repris les exécutions en 2018 ne doivent pas faire oublier toutes les avancées réalisées par d'autres pays dans toute la région. En ce qui concerne le reste de l'Afrique, la Gambie a signé un traité international engageant le pays à ne pas procéder à des exécutions et à s'orienter vers l'abolition de la peine de mort dans sa législation. Le chef de l'État gambien a mis en place en février 2018 un moratoire officiel (interdiction temporaire) sur les exécutions. Des avancées notables dans le reste du monde Les progrès enregistrés en Afrique subsaharienne en 2017 sont représentatifs des tendances positives relevées dans le reste du monde, les recherches d'Amnistie internationale indiquant un nouveau recul du recours à la peine de mort en 2017 à l'échelle mondiale. Amnistie internationale a recensé au moins 993 exécutions dans 23 pays en 2017, soit 4 % de moins qu'en 2016 (où 1 032 exécutions avaient été enregistrées) et 39 % de moins qu'en 2015 (année où l'organisation avait relevé le chiffre le plus élevé depuis 1989 : 1 634 exécutions). L'organisation a enregistré au moins 2 591 condamnations à mort dans 53 pays en 2017, ce qui représente une baisse notable par rapport au chiffre record de 3 117 enregistré en 2016. Ces chiffres n'incluent pas les milliers de sentences capitales prononcées en Chine et d'exécutions ayant eu lieu dans ce pays, selon Amnistie internationale, les statistiques en la matière relevant toujours du secret d’État dans ce pays. Tout comme la Guinée, la Mongolie a aboli la peine de mort pour tous les crimes, ce qui a porté le nombre total de pays abolitionnistes à 106 en 2017. Comme le Guatemala est devenu abolitionniste pour les crimes de droit commun tels que le meurtre, le nombre de pays ayant aboli la peine de mort en droit ou en pratique est passé à 142. Seuls 23 pays continuaient de procéder à des exécutions, ce chiffre étant inchangé par rapport à 2016 alors même que plusieurs États ont repris les exécutions après une interruption. D'importantes mesures ont également été prises pour restreindre le recours à la peine de mort dans des pays qui sont pourtant de fervents défenseurs de ce châtiment. En Iran, le nombre d'exécutions recensées a diminué de 11 % et le nombre d'exécutions de personnes condamnées pour des infractions liées aux stupéfiants a baissé de 40 %. Des mesures ont été prises pour relever le seuil de la quantité minimale de drogue à partir de laquelle la peine de mort est obligatoirement prononcée. En Malaisie, des lois relatives aux stupéfiants ont été modifiées afin de laisser aux juges une certaine latitude dans le choix de la peine en cas de trafic de drogue. Ces modifications vont vraisemblablement conduire à une réduction du nombre de sentences capitales prononcées dans ces deux pays à l'avenir. « Il est préoccupant de constater que des pays continuent de recourir à la peine de mort pour sanctionner des infractions liées aux stupéfiants. Toutefois, les mesures prises par l'Iran et la Malaisie pour modifier leur législation relative aux stupéfiants montrent bien que les choses sont en train de changer, même dans la minorité de pays qui continuent de procéder à des exécutions », a déclaré Salil Shetty. L'Indonésie, qui a exécuté quatre personnes condamnées pour des infractions liées aux stupéfiants en 2016, dans le cadre des initiatives mal avisées prises par le pays pour combattre la criminalité liée à la drogue, n'a procédé à aucune exécution l'an dernier et a fait état d'une légère diminution du nombre de sentences capitales prononcées. Des tendances inquiétantes Des tendances inquiétantes demeuraient cependant en 2017 en ce qui concerne le recours à la peine de mort. Quinze pays ont prononcé de peines capitales ou exécuté des personnes pour des infractions liées aux stupéfiants, en violation des dispositions du droit international. Si la majeure partie des exécutions dans des affaires de stupéfiants ont été enregistrées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2017, c'est dans la région Asie-Pacifique que se trouvent le plus grand nombre de pays ayant recours à la peine capitale pour ce type d'infractions (10 sur 16). Amnistie internationale a recensé des exécutions de personnes condamnées pour des infractions liées aux stupéfiants dans quatre pays : l'Arabie saoudite, la Chine (où les statistiques sont classées secret d'État), l'Iran et Singapour. En raison du secret qui entoure les questions relatives à la peine de mort en Malaisie et au Viêt-Nam, il a été impossible de savoir si des exécutions ont eu lieu dans ces pays dans des affaires liées aux stupéfiants. Singapour a procédé à huit exécutions par pendaison en 2017, à chaque fois dans des affaires liées aux stupéfiants, ce chiffre étant deux fois plus élevé qu'en 2016. Une tendance similaire a été notée concernant l'Arabie saoudite, où le nombre d'exécutions par décapitation dans des affaires liées aux stupéfiants a connu une très forte hausse, passant de 16 % du nombre total d'exécutions recensées en 2016 à 40 % en 2017. « Même si des avancées ont été réalisées en direction de l'abolition de cet ignoble châtiment, une poignée de dirigeants continuent de vouloir l'utiliser à titre de "solution expéditive" au lieu de régler les problèmes à la source avec des politiques humaines, efficaces et reposant sur des informations factuelles. Les véritables dirigeants appliquent la justice, pas la peine de mort, a déclaré Salil Shetty. « Les mesures draconiennes massivement mises en œuvre pour lutter contre les infractions liées aux stupéfiants au Moyen-Orient et dans la région Asie et Pacifique n'ont absolument pas permis de régler ce problème. » Des gouvernements ont par ailleurs violé en 2017 plusieurs autres interdictions édictées par le droit international. Cinq personnes au moins en Iran ont été exécutées pour des crimes commis alors qu'elles étaient âgées de moins de 18 ans et 80 autres au moins se trouvaient toujours dans le quartier des condamnés à mort, et des personnes présentant un handicap mental ou intellectuel ont été exécutées ou étaient sous le coup d'une sentence capitale au Japon, aux Maldives, au Pakistan, à Singapour et aux États-Unis. Amnistie internationale a enregistré plusieurs cas de personnes condamnées à mort qui avaient « avoué » des crimes après avoir été soumises à la torture ou à d'autres mauvais traitements en Arabie saoudite, à Bahreïn, en Chine, en Iran et en Irak. En Iran et en Irak, certains de ces « aveux » ont été diffusés en direct à la télévision. Même si le nombre total de pays procédant à des exécutions est resté inchangé, Bahreïn, la Jordanie, le Koweït et les Émirats arabes unis ont repris les exécutions après une interruption. En Égypte, le nombre de sentences capitales recensées a augmenté de près de 70 % par rapport à 2016. Un regard vers l'avenir Comme à la connaissance d'Amnistie internationale au moins 21 919 personnes se trouvent sous le coup d'une sentence capitale à l'échelle mondiale, il ne faut surtout pas relâcher la pression maintenant. Des mesures positives ont été prises en 2017 dont nous pourrons mesurer le plein effet dans les mois et les années à venir. Cependant, étant donné que certains pays prennent des mesures rétrogrades, ou menacent de le faire, la campagne contre la peine de mort est d'une importance toujours aussi fondamentale. « Au cours des 40 dernières années, nous avons assisté à un énorme changement allant dans le bon sens en ce qui concerne le recours à la peine de mort à travers le monde, mais il est nécessaire de continuer d'intervenir de toute urgence pour mettre fin à cette abominable pratique que constituent les homicides commis par l'État, a déclaré Salil Shetty. « La peine capitale s'inscrit dans une culture marquée par la violence et n'apporte pas de remède à ce fléau. Nous savons qu'en stimulant le soutien des personnes à travers la planète, nous pouvons lutter contre ce châtiment cruel et mettre fin à la peine de mort partout dans le monde. »  Le recours à la peine de mort pour les crimes commis par des personnes de moins de 18 ans est interdit par le droit international relatif aux droits humains, mais certains pays continuent d'exécuter des mineurs délinquants. Le nombre de ces exécutions est faible si on le compare au nombre total d'exécutions dans le monde. Toutefois, leur signification va au-delà de leur nombre et remet en question l'engagement des États à respecter le droit international. Depuis 1990, Amnistie internationale a recensé 137 exécutions de mineurs délinquants dans neuf pays : Chine, République démocratique du Congo, Iran, Nigéria, Pakistan, Arabie saoudite, Soudan, États-Unis et Yémen. Plusieurs de ces pays ont modifié leurs lois pour exclure cette pratique. Les exécutions de mineurs délinquants représentent une petite fraction du nombre total d'exécutions enregistrées par Amnistie internationale chaque année dans le monde. Les États-Unis et l'Iran ont exécuté plus de mineurs délinquants que tous les huit autres pays et l'Iran a maintenant dépassé les États-Unis depuis 1990, avec 19 exécutions de mineurs. Le premier tableau ci-dessous donne des statistiques sur les exécutions de mineurs délinquants recensées par Amnistie internationale depuis 1990. Le deuxième tableau donne des détails sur le cas. Consultez les tableaux |
Centre de presseLe centre de presse du Secrétariat international met à la disposition des professionnels et du grand public des nouvelles de dernière minute, des commentaires de spécialistes et des informations importantes sur la situation dans le monde relative à la peine de mort. Archives
Septembre 2022
Catégories
Tout
|
Amnistie internationale Canada francophone - Abolition de la peine de mort - Tél. : 819-944-5157
Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca
Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca

 Flux RSS
Flux RSS
