Arabie saoudite. Voici pourquoi le temps est venu pour l'Arabie saoudite d'abolir la peine de mort.4/29/2020  Les informations signalant que l’Arabie saoudite à l’intention d’abolir la peine de mort pour les personnes ayant commis un crime alors qu’elles étaient âgées de moins de 18 ans – exception faite des cas entrant dans le champ d’application de la législation relative à la lutte contre le terrorisme – peuvent sembler annoncer un progrès, mais il ne s’agit en réalité que d’un petit pas en avant, insuffisant, sur le long chemin qui reste à parcourir pour la protection du droit à la vie. Pendant des années, l’Arabie saoudite s’est abstenue de respecter le droit international, qui interdit de recourir à la peine de mort contre des personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment où elles ont commis un crime. Mais le fait que l’Arabie saoudite continue de condamner à mort des personnes montre que l’approche qu’a adoptée ce pays en matière d’ordre public est fondamentalement erronée. La peine de mort peut y être infligée pour un grand nombre de crimes – notamment pour meurtre, pour des infractions liées aux stupéfiants, pour apostasie et pour sorcellerie –, et elle est souvent prononcée à l’issue de procès iniques et entachés de graves irrégularités. Les condamnés à mort sont généralement décapités. Dans certains cas, il est même arrivé que les corps soient « crucifiés ». Combien de personnes condamnées l’Arabie saoudite a-t-elle exécutées l’an dernier ? Comme le montre le rapport annuel sur la peine de mort qu’Amnistie internationale a publié la semaine dernière, le taux d’exécutions en Arabie saoudite est l’un des plus élevés au monde. Les autorités saoudiennes ont mis à mort 184 personnes l’année dernière, ce qui représente le plus grand nombre d’exécutions recensées par Amnistie internationale en compilant ses recherches et les chiffres du ministère de l’Intérieur depuis 2000. La majorité des prisonniers exécutés l’ont été pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ou pour meurtre. L’an dernier, au mois d’avril, 37 personnes ont été tuées en l’espace d’une journée seulement. Au total, 32 de ces personnes étaient des hommes appartenant à la minorité chiite d’Arabie saoudite, dont un grand nombre avaient été condamnés pour des infractions liées au « terrorisme », à l’issue de procès basés sur des aveux arrachés au moyen de la torture. L’une de ces personnes était Hussein al Mossalem. Il a subi de multiples blessures, notamment des fractures du nez, de la clavicule et de la jambe, pendant sa détention à l’isolement, et a été frappé et soumis à des décharges électriques ainsi qu’à d’autres formes de torture. Il faut que cesse cette pratique cruelle d’une forme pervertie de « justice ». La peine capitale a-t-elle un effet dissuasif ? En vérité, la condamnation à mort d’une personne constitue une violation du droit à la vie. De plus, des personnes innocentes risquent ainsi d’être tuées. En Arabie saoudite, les procédures judiciaires sont loin de respecter les normes internationales d’équité des procès. Les accusés sont rarement autorisés à être officiellement représentés par un avocat, et dans nombre de cas, ils ne sont pas informés de l’avancée des poursuites engagées contre eux. Les informations rassemblées par Amnistie internationale montrent que les procès capitaux sont notamment marqués par un recours aux « aveux » obtenus sous la torture. Au moins 20 hommes chiites jugés par le Tribunal pénal spécial ces dernières années ont été condamnés à mort sur la base de tels « aveux », et 17 d’entre eux ont déjà été exécutés. Il n’a jamais été prouvé que la peine de mort ait un effet plus dissuasif que les peines d'emprisonnement sur la criminalité. En réalité, le taux de criminalité diminue souvent dans les pays qui ont aboli la peine capitale. Le fait est que les condamnations à mort ne contribuent pas à rendre nos sociétés plus sûres et moins dangereuses. La peine de mort viole le droit le plus fondamental : le droit à la vie. Il s’agit du châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. L’Arabie saoudite affirme être déterminée à mettre en place les réformes en matière de droits humains que le prince héritier Mohammed Ben Salman entend défendre dans le cadre de son plan Vision 2030. Si tel est réellement le cas, il est alors grand temps pour le pays d’abolir totalement la peine de mort.
0 Commentaires
Tchad. La décision d'abolir la peine de mort est un signal positif pour les droits humains.4/29/2020  Les autorités tchadiennes ont décidé d’abolir la peine de mort pour les « faits de terrorisme ». « La décision d’abolir la peine de mort pour les faits de terrorisme, en plus de l’abolition déjà actée en 2017 pour tous les autres crimes, est un signal fort et positif en matière de droits humains », a déclaré Tity Agbahey, chargée de campagnes pour l’Afrique centrale à Amnistie internationale. « Elle doit sans tarder ouvrir la voie à la commutation de toutes les peines d’exécutions et à la ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à l’abolition de la peine de mort. « Il est encourageant de constater que les autorités tchadiennes, malgré le contexte sécuritaire difficile lié aux attaques du groupe armé Boko Haram, ont respecté leurs engagements en mettant en œuvre les recommandations acceptées de leurs pairs visant à l’abolition complète de la peine de mort. » Complément d’information Au Tchad, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité, mardi 28 avril, l’abolition de la peine de mort pour les faits de terrorisme. A la suite des recommandations acceptées lors de son Examen périodique universel (EPU) de 2013, le Code pénal tchadien a été révisé en 2017 abolissant la peine de mort, mis à part pour les cas de « terrorisme ». Avant son adoption, 10 membres présumés du groupe armé Boko Haram avaient été condamnés à mort le 28 août 2015 lors d’un procès tenu à huis clos. Ils ont été fusillés le jour suivant. En aout 2018, quatre personnes ont été condamnées à mort pour le meurtre d’une commerçante. Le Tchad a de nouveau accepté les recommandations en faveur de l’abolition de peine de mort lors de son EPU de 2018. La peine de mort est une violation du droit à la vie et constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Dans son rapport annuel sur la peine de mort, publié le 21 avril, Amnistie internationale fait état de la tendance générale, qui a vu une diminution du nombre d’exécutions recensées à l’échelle mondiale pour la quatrième année consécutive : au moins 657 exécutions ont été recensées en 2019 contre au moins 690 en 2018, soit le chiffre le plus bas enregistré ces dix dernières années.  À la suite de l’annonce faite par l’Arabie saoudite, qui prévoit d’abolir la peine capitale contre les personnes âgées de moins de 18 ans au moment du crime commis dans les affaires ne relevant pas de la Loi de lutte contre le terrorisme, Amnistie internationale demande au pays d’aller plus loin et d’abolir totalement la peine de mort. « Cette mesure est un grand pas en avant pour l’Arabie saoudite si elle est mise en œuvre ; toutefois, le recours à la peine capitale dans le pays a atteint un record choquant en 2019, avec 184 exécutions recensées, a déclaré Heba Morayef, directrice pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient à Amnistie internationale. « La peine de mort est le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Aucun pays ne devrait plus l’appliquer et le bilan de l’Arabie saoudite à cet égard est particulièrement mauvais. Elle doit sans plus attendre instaurer un moratoire officiel sur les exécutions, à titre de premier pas sur la voie de l’abolition totale de la peine capitale. « Par ailleurs, nous ne devons pas oublier que des dizaines de défenseur·es pacifiques des droits humains sont toujours détenus pour des condamnations prononcées à l’issue de procès iniques, uniquement pour avoir fait campagne en faveur de l’égalité et de la justice dans un environnement très répressif. » Les autorités saoudiennes ont annoncé le 26 avril que le pays allait cesser de recourir à la peine de mort pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits qui leur sont reprochés. Cette sentence sera remplacée par une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. « L’Arabie saoudite doit sans plus attendre instaurer un moratoire officiel sur les exécutions, à titre de premier pas sur la voie de l’abolition totale de la peine capitale » D’après les informations obtenues par Amnistie internationale, le décret royal exclut les crimes relevant de la Loi de lutte contre le terrorisme. On ignore quelle sera la peine encourue par les mineurs délinquants s’ils sont jugés au titre de cette loi. Or, Amnistie internationale a recueilli des informations sur l’utilisation abusive par les autorités saoudiennes de la Loi de lutte contre le terrorisme, qui définit de manière excessivement générale et vague les termes « terrorisme » et « infraction terroriste », et contient des dispositions qui érigent en infraction l’expression pacifique d’opinions. Depuis des années, l’Arabie saoudite piétine le droit international interdisant l’usage de la peine capitale contre les personnes âgées de moins de 18 ans au moment du crime commis. Amnesty International fait campagne depuis longtemps pour que soient annulées les condamnations à mort prononcées contre Ali al Nimr, Abdullah al Zaher et Dawood al Marhoon, trois jeunes hommes membres de la minorité chiite, tous arrêtés alors qu’ils avaient moins de 18 ans. Ils risquent d’être exécutés de manière imminente, après avoir été jugés dans le cadre de procès iniques par le Tribunal pénal spécial. Amnistie internationale a recueilli des informations sur l’utilisation abusive par les autorités saoudiennes de la Loi de lutte contre le terrorisme, qui [...] contient des dispositions qui érigent en infraction l’expression pacifique d’opinions Les autorités n’ont pas encore rendu public le décret royal contenant l’annonce et ses règlements d’application demeurent flous. À la connaissance d’Amnistie internationale, les familles des condamnés à mort n’ont pas encore reçu d’informations concernant le cas de leurs proches. La semaine dernière, la Cour suprême saoudienne a publié une directive enjoignant aux tribunaux de ne plus prononcer de peines de flagellation à titre de châtiment discrétionnaire et de les remplacer par des peines de prison assorties ou non d’amendes. On ignore si cela s’appliquera aux peines de flagellation impérativement prévues pour diverses infractions au titre de la charia, notamment pour des infractions sexuelles ou liées à la consommation d’alcool. LOI RELATIVE AUX MINEURS La récente annonce s’inscrit dans le sillage de la Loi relative aux mineurs, promulguée en 2018, qui interdit aux juges de prononcer des condamnations à mort à titre de châtiment discrétionnaire contre les personnes âgées de moins de 15 ans. Cependant, cette loi ne leur interdit pas de prononcer la peine capitale contre les mineurs reconnus coupables au titre de la charia de crimes passibles de hadd (peines fixes et sévères) ou de qisas (« réparation »), qui prévoit de punir certains crimes comme les meurtres et les coups et blessures par des châtiments identiques (la peine de mort pour les meurtres et les mêmes blessures pour des dommages corporels). La loi ne respectait donc pas les obligations incombant à l’Arabie saoudite au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’annonce faite par les autorités saoudiennes, qui est un pas en avant dans la lignée de la Loi relative aux mineurs, doit être assortie de règlements d’application précis n’excluant aucun mineur de la réforme. Complément d’information Dans son rapport annuel sur la peine de mort, Amnesty International révélait que l’Arabie saoudite a exécuté un nombre record de personnes en 2019, dans un contexte de diminution du nombre d’exécutions recensées à l’échelle mondiale. Les autorités saoudiennes ont mis à mort 184 personnes l’année dernière, soit le plus grand nombre d’exécutions recensées par Amnistie internationale en compilant ses recherches et les chiffres du ministère de l’Intérieur depuis 2000.  Par Clare Algar, directrice générale de la recherche, du plaidoyer et des politiques à Amnistie internationale. En 2012, le Saoudien Abdulkareem al Hawaj, alors âgé de 16 ans, aurait participé à des manifestations antigouvernementales dans la province de l’Est, à majorité chiite. Deux ans plus tard, l’adolescent avait été arrêté et inculpé d’accusations liées à sa participation aux manifestations. Abdulkareem al Hawaj aurait été maintenu à l’isolement pendant les cinq premiers mois de sa détention, et des agents de la Direction générale des enquêtes l’auraient frappé, intimidé et auraient menacé de tuer sa famille pendant de violents interrogatoires destinés à lui faire signer des « aveux ». Il n’avait pas pu s’entretenir avec un avocat pendant sa détention provisoire ni ses interrogatoires. Condamné à mort par le Tribunal pénal spécial le 27 juillet 2016, Abdulkareem al Hawaj a été mis à mort, en même temps que 36 autres personnes, dans le cadre d’une exécution collective le 23 avril 2019. Sa famille, tout comme celles des autres hommes exécutés ce jour-là, a appris sa mort par les médias. Les proches de ces hommes n’ont jamais pu récupérer les dépouilles pour pouvoir faire leur deuil. Amnistie internationale considère que la peine de mort constitue le châtiment le plus cruel et le plus inhumain qui soit. Prendre une vie, que ce soit au moyen de la pendaison, de l’électrocution, de la décapitation, d’un tir d’arme à feu ou d’une injection létale, de sang-froid, est l’acte le plus vil qui soit. Condamner à mort une personne ayant moins de 18 ans au moment du crime dont elle est accusée constitue une violation du droit international. Lorsqu’elle n’est pas utilisée pour museler la dissidence ou répandre la peur parmi les minorités ou les groupes défavorisés, la peine de mort est souvent déployée pour donner l’impression que l’on se montre intransigeant envers la criminalité. Pourtant aucun élément crédible ne tend à prouver que les sociétés dans lesquelles la peine de mort est appliquée soient plus sûres, ou que les exécutions aient un effet plus dissuasif sur la criminalité que les peines d’emprisonnement. Depuis plus de 40 ans, Amnistie internationale appelle à l’abolition de la peine de mort, en toutes circonstances et sans exception. Il est donc encourageant de constater que notre dernier rapport montre que le nombre d’exécutions recensées dans le monde a diminué pour la quatrième année consécutive, pour atteindre le niveau le plus bas de ces dix dernières années. Une tendance mondiale vers l’abandon de la peine de mort Au total, 657 exécutions ont été recensées dans le monde en 2019, soit une diminution de 5 % par rapport à 2018. Ces données confirment une tendance mondiale qui a vu le recours à la peine capitale diminuer chaque année depuis le pic de 1 634 exécutions recensées en 2015. Cette diminution peut être, en partie, attribuée à un nombre d’exécutions moins élevé en 2019 dans des pays qui traditionnellement avaient largement recours à la peine de mort, comme le Japon (trois exécutions en 2019 contre 15 en 2018), Singapour (quatre exécutions en 2019 contre 13 en 2018) et l’Égypte (au moins 32 exécutions en 2019 contre au moins 43 en 2018). Pour la première fois depuis 2010, aucune exécution n’a été recensée en Afghanistan en 2019. Des interruptions ont également été constatées à Taiwan et en Thaïlande. La Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, la Malaisie et la Gambie ont en outre maintenu leurs moratoires sur les exécutions. Bien qu’aucun pays n’ait aboli la peine de mort pour tous crimes en 2019, la dynamique vers l’abolition mondiale de ce châtiment abominable a continué de prendre de l’ampleur. En Afrique subsaharienne, plusieurs pays ont pris des mesures qui pourraient mener à l’abolition de la peine de mort, notamment la Guinée équatoriale, la Gambie, le Kenya, la République centrafricaine et le Zimbabwe. Dans les Caraïbes, la Barbade a supprimé l’imposition obligatoire de la peine de mort de sa Constitution, tandis qu’aux États-Unis, le gouverneur de Californie, État où le nombre de prisonniers sous le coup d’une sentence capitale est le plus élevé, a instauré un moratoire officiel sur les exécutions, et le New Hampshire est devenu le 21e État à abolir la peine de mort pour tous les crimes. Des progrès entravés par un petit nombre de pays Cependant, ces avancées ont été entachées par plusieurs éléments, notamment la forte augmentation des exécutions dans certains pays comme l’Arabie saoudite et l’Irak. Au total, les autorités saoudiennes ont exécuté 184 personnes l’année dernière, contre 149 en 2018. La majorité des prisonniers exécutés l’ont été pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ou pour meurtre. Amnistie internationale a également constaté une augmentation du recours à la peine de mort comme arme politique contre les dissidents de la minorité musulmane chiite en Arabie saoudite. En Irak, les autorités ont davantage eu recours à la peine de mort contre des personnes accusées d’être membres du groupe armé se désignant sous le nom d’État islamique. Le nombre de personnes exécutées a presque doublé, passant de 52 en 2018 à 100 en 2019. Manque de transparence Le recours à la peine de mort est souvent entouré de secret. Malgré les demandes d’Amnistie internationale, de nombreux pays n’ont pas fourni d’informations sur leur recours à la peine capitale. Par exemple, le Viêt-Nam, l’un des cinq pays ayant procédé au plus grand nombre d’exécutions en 2018, n’a publié que des données partielles pour 2019, et la Chine, la Corée du Nord et l’Iran ont continué de dissimuler l’ampleur de leur recours à la peine de mort. Cela ne fait que renforcer notre détermination. Nous devons continuer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire pression sur la petite minorité de pays procédant à des exécutions dans le monde, afin d’abolir la peine de mort une bonne fois pour toutes. La vie humaine est sacrée. Sa valeur est inestimable. Ne l’oublions jamais.  Amnistie internationale a recensé au moins 657 exécutions dans 20 pays en 2019, ce qui représente une baisse de 5 % par rapport aux chiffres de 2018 (au moins 690). Ce chiffre est le plus faible qu’Amnistie internationale ait enregistré au cours de la dernière décennie. La plupart des exécutions ont eu lieu, par ordre décroissant, en Chine, en Iran, en Arabie saoudite, en Irak et en Égypte. Une fois de plus, c’est en Chine qu’a été exécuté le plus grand nombre de condamnés. Toutefois, il s’avère impossible d’obtenir des chiffres précis sur l’application de la peine capitale dans le pays, ces données étant classées secret d’État. Le chiffre d’au moins 657 personnes exécutées dans le monde n’inclut donc pas les milliers d’exécutions qui ont probablement eu lieu en Chine. Si l’on exclut la Chine, quatre pays seulement étaient responsables de 86 % de toutes les exécutions recensées à l’échelle mondiale : l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Irak et l’Égypte. Le Bangladesh et Bahreïn ont repris les exécutions l’année dernière, après une interruption en 2018. Amnistie internationale n’a recensé aucune exécution en Afghanistan, à Taiwan et en Thaïlande, contrairement à 2018. Le nombre d’exécutions recensées en Iran a légèrement diminué, passant d’au moins 253 en 2018 à au moins 251 en 2019. Les exécutions recensées en Irak ont presque doublé, passant d’au moins 52 en 2018 à au moins 100 en 2019, et l’Arabie saoudite a quant à elle exécuté le nombre record de 184 personnes en 2019, contre 149 en 2018. Des mesures ou des annonces positives susceptibles d’aboutir à l’abolition de la peine capitale sont à porter au crédit de la Gambie, de la Guinée équatoriale, du Kazakhstan, du Kenya, de la République centrafricaine et du Zimbabwe. La Barbade a également supprimé l’imposition obligatoire de la peine de mort de sa Constitution. Aux États-Unis, le gouverneur de Californie, État où le nombre de prisonniers sous le coup d’une sentence capitale est le plus élevé, a instauré un moratoire officiel sur les exécutions, et le New Hampshire est devenu le 21e État à abolir la peine de mort pour tous les crimes. La Fédération de Russie, la Gambie, le Kazakhstan, la Malaisie et le Tadjikistan ont maintenu leurs moratoires sur les exécutions. À la fin de l’année 2019, 106 pays (la majorité des États dans le monde) avaient aboli la peine de mort dans leur législation pour tous les crimes et 142 (plus des deux tiers des États) étaient abolitionnistes en droit ou en pratique. D’après les informations dont dispose Amnistie internationale, des condamnés à mort ont bénéficié d’une commutation ou d’une grâce dans les 24 pays suivants : Bangladesh, Chine, Égypte, Émirats arabes unis, États-Unis, Gambie, Ghana, Guyana, Inde, Indonésie, Irak, Koweït, Malaisie, Maroc et Sahara occidental, Mauritanie, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Singapour, Soudan, Thaïlande, Zambie, Zimbabwe. Amnistie internationale a recensé au moins 11 personnes condamnées à mort qui ont été innocentées dans deux pays : les États-Unis et la Zambie. Au moins 2 307 condamnations à mort ont été recensées dans 56 pays en 2019, contre 2 531 dans 54 pays en 2018. Amnistie internationale n’a cependant pas reçu de chiffres officiels sur les condamnations à mort prononcées en Malaisie, au Nigeria et au Sri Lanka, trois pays qui avaient officiellement signalé un grand nombre de condamnations à mort les années précédentes. À la connaissance d’Amnistie internationale, au moins 26 604 personnes se trouvaient sous le coup d’une condamnation à mort à la fin de l’année 2019 dans le monde. Les méthodes d’exécution utilisées dans le monde en 2019 ont été les suivantes : la décapitation, l’électrocution, la pendaison, l’injection létale et les armes à feu. Au moins 13 exécutions publiques ont été recensées en Iran. Au moins six personnes (quatre en Iran, une en Arabie saoudite et une au Soudan du Sud) ont été exécutées pour des crimes commis alors qu’elles avaient moins de 18 ans. Des personnes présentant un handicap mental ou intellectuel étaient sous le coup d’une sentence de mort dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Japon, les Maldives et le Pakistan. Des condamnations à mort ont été prononcées de manière avérée à l’issue de procédures qui n’ont pas respecté les normes internationales relatives à l’équité des procès dans plusieurs pays, notamment en Arabie saoudite, à Bahreïn, au Bangladesh, en Chine, en Égypte, en Iran, en Irak, en Malaisie, au Pakistan, à Singapour, au Viêt-Nam et au Yémen. Analyse régionale du recours à la peine de mort Amériques Pour la 11e année consécutive, les États-Unis ont été le seul pays du continent américain à exécuter des condamnés. Trinité-et-Tobago était le seul pays à maintenir la condamnation à mort automatique pour les personnes reconnues coupables de meurtre. Le nombre d’exécutions et de condamnations à mort recensées aux États-Unis a diminué par rapport à 2018, passant respectivement de 25 à 22 et de 45 à 35. Plus de 40 % des exécutions enregistrées ont eu lieu au Texas, qui demeure l’État qui exécute le plus de personnes aux États-Unis (neuf en 2019 contre 13 en 2018). Le Missouri a procédé à une exécution en 2019, alors que l’État n’avait pas mené d’exécution en 2018. À l’inverse, le Nebraska et l’Ohio n’ont exécuté personne en 2019, contrairement à l’année précédente, au cours de laquelle ces deux États avaient chacun exécuté une personne. À l’exception des États-Unis, les Amériques ont continué de progresser vers la fin du recours à la peine capitale. La Barbade a supprimé l’imposition obligatoire de la peine de mort de sa Constitution, tandis qu’Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, le Belize, Cuba, la Dominique, le Guatemala, la Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis et Sainte-Lucie ne comptaient aucune personne en attente d’exécution et n’ont déclaré aucune nouvelle sentence capitale. Asie-Pacifique Pour la première fois depuis presque dix ans, la région Asie-Pacifique a enregistré une diminution du nombre de pays procédant à des exécutions, ce nombre s’élevant à sept pour l’année 2019. Sans les données concernant le Viêt-Nam, le nombre d’exécutions recensées dans la région (29) montre une légère diminution, attribuable à une baisse du nombre d’exécutions au Japon (de 15 à trois) et à Singapour (de 13 à quatre). Comme les années précédentes, ce total régional n’inclut pas les milliers d’exécutions qui ont probablement eu lieu en Chine et reste difficile à estimer avec précision, en raison du secret entourant ces données dans ce pays, ainsi qu’en Corée du Nord et au Viêt-Nam. Bien que le Bangladesh ait repris les exécutions (deux), des interruptions ont été constatées en Afghanistan, à Taiwan et en Thaïlande, des pays qui avaient tous procédé à des exécutions en 2018. La Malaisie a maintenu le moratoire officiel sur les exécutions mis en place en juillet 2018. Le nombre d’exécutions recensées au Pakistan en 2019 était le même que l’année précédente : au moins 14 hommes ont été pendus dans le pays. Le nombre de condamnations à mort prononcées dans le pays a considérablement augmenté, pour atteindre au moins 632, notamment car de nouveaux tribunaux ont été mis en place en vue de résorber le nombre d’affaires en attente. Le nombre d’exécutions menées au Japon était de trois en 2019, ce qui représente une diminution par rapport à l’année 2018, au cours de laquelle le pays avait procédé à 15 exécutions, soit le plus grand nombre enregistré depuis 2008. Deux Japonais ont été exécutés le 2 août et un ressortissant chinois a été exécuté le 26 décembre. Ils avaient tous les trois été déclarés coupables de meurtre. Singapour a déclaré quatre exécutions en 2019, contre un nombre record de 13 en 2018. Les Philippines ont tenté de rétablir la peine de mort pour les « crimes odieux liés aux stupéfiants et au pillage ». À la connaissance d’Amnistie internationale, au moins 1 227 condamnations à mort ont été prononcées dans 17 pays, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2018. Europe et Asie centrale Au moins deux exécutions ont été recensées au Bélarus en 2019, contre au moins quatre en 2018. Depuis 2005, le Bélarus est le seul pays de la région à continuer à procéder à des exécutions. La Fédération de Russie, le Kazakhstan et le Tadjikistan ont maintenu leurs moratoires sur les exécutions. Le Kazakhstan a également annoncé des mesures en vue d’entamer les procédures d’adhésion au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui engage les États à abolir la peine de mort. Moyen-Orient et Afrique du Nord Le nombre d’exécutions recensées dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord a augmenté de 16 % en 2019, passant de 501 en 2018 à 579 l’année suivante, à l’inverse de la tendance vers une diminution des exécutions constatée depuis 2015. La hausse du nombre d’exécutions est en grande partie due à une augmentation considérable des mises à mort en Irak et en Arabie saoudite. Le nombre d’exécutions menées en Irak a presque doublé, passant d’au moins 52 en 2018 à au moins 100 en 2019, et l’Arabie saoudite a exécuté un nombre record de personnes en 2019 : 184, contre 149 en 2018. Avec l’Iran, ces pays étaient responsables de 92 % des exécutions menées dans la région. À la connaissance d’Amnistie internationale, sept pays ont procédé à des exécutions au cours de l’année : l’Arabie saoudite, Bahreïn, l’Égypte, l’Irak, l’Iran, la Syrie et le Yémen. En 2019, quelque 707 condamnations à mort ont été recensées dans la région, ce qui représente une baisse de 40 % par rapport à 2018, année durant laquelle 1 170 sentences capitales avaient été prononcées. L’Égypte a une nouvelle fois prononcé le plus grand nombre de condamnations à mort recensées dans la région, mais le nombre de ces condamnations pour 2019 (au moins 435) était considérablement plus faible qu’en 2018 (au moins 717). Le nombre de condamnations à mort prononcées par les autorités irakiennes au cours de l’année a également considérablement diminué, passant d’au moins 271 en 2018 à au moins 87 en 2019. Afrique subsaharienne Quatre pays ont procédé à un total de 25 exécutions en 2019 : le Botswana, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud. Amnistie internationale a recensé une exécution de plus qu’en 2018 dans la région. Pour la deuxième année consécutive, le Soudan du Sud a procédé à un nombre nettement plus élevé d’exécutions, mettant à mort au moins 11 personnes en 2019. C’est le nombre d’exécutions le plus élevé enregistré dans ce pays depuis son indépendance, en 2011. Parmi les personnes exécutées figuraient trois membres de la même famille et un homme qui était mineur au moment des faits qui lui étaient reprochés et qui avait environ 17 ans lorsqu’il a été condamné à mort. Le nombre de condamnations à mort recensées a augmenté de 53 %, passant de 212 au moins en 2018 à 325 en 2019. Le nombre de pays ayant prononcé des sentences capitales a augmenté, passant de 17 en 2018 à 18 en 2019.  La peine de mort en 2019. L’Arabie saoudite a exécuté un nombre record de personnes en 2019, dans un contexte de diminution du nombre d’exécutions recensées à l’échelle mondiale.
Malgré la diminution générale du nombre d’exécutions recensées à l’échelle mondiale, l’Arabie saoudite a exécuté un nombre record de personnes en 2019, indique Amnistie internationale dans son rapport mondial sur la peine de mort en 2019, publié le 21 avril 2020. Les autorités saoudiennes ont mis à mort 184 personnes l’année dernière, soit le plus grand nombre d’exécutions recensées par Amnistie internationale en un an dans ce pays. Dans le même temps, le nombre d’exécutions recensées en Irak a doublé et l’Iran est resté le deuxième pays procédant au plus grand nombre d’exécutions après la Chine, où le nombre exact de personnes exécutées reste classé secret d’État. Toutefois, ces pays vont à contre-courant de la tendance générale, qui a vu une diminution du nombre d’exécutions recensées à l’échelle mondiale pour la quatrième année consécutive : au moins 657 exécutions ont été recensées en 2019 contre au moins 690 en 2018, soit le chiffre le plus bas enregistré ces dix dernières années. « La peine de mort est un châtiment atroce et inhumain et aucun élément crédible ne tend à prouver qu’elle ait un effet plus dissuasif sur la criminalité que des peines de prison. Une vaste majorité des pays le reconnaissent et il est encourageant de constater que le nombre d’exécutions dans le monde continue de diminuer », a déclaré Clare Algar, directrice générale de la recherche, du plaidoyer et des politiques à Amnistie internationale. « Cependant, un petit nombre de pays ont défié la tendance mondiale vers l’abandon de la peine capitale, en procédant à davantage d’exécutions. Le recours croissant de l’Arabie saoudite à la peine de mort, notamment comme arme contre la dissidence politique, est une évolution très inquiétante. La très forte augmentation des exécutions recensées en Irak, où elles ont presque doublé, est également choquante. » Les cinq pays ayant procédé au plus grand nombre d’exécutions en 2019 sont : la Chine (des milliers), l’Iran (au moins 251), l’Arabie saoudite (184), l’Irak (au moins 100) et l’Égypte (au moins 32). Les chiffres d’Amnesty ne comprennent pas les exécutions menées en Chine, qui se compteraient en milliers, les statistiques sur la peine capitale étant classées secret d’État dans le pays. D’autres pays parmi ceux procédant au plus grand nombre d’exécutions, comme l’Iran, la Corée du Nord et le Viêt-Nam, ont continué de dissimuler l’ampleur de leur recours à la peine de mort, en entravant l’accès aux informations à ce sujet. Pics d’exécutions dans une minorité de pays Tout juste 20 pays étaient responsables de toutes les exécutions recensées dans le monde. Parmi ces pays, l’Arabie saoudite, l’Irak, le Soudan du Sud et le Yémen ont exécuté considérablement plus de personnes en 2019 qu’en 2018. L’Arabie saoudite a exécuté 184 personnes en 2019 (six femmes et 178 hommes), dont tout juste plus de la moitié étaient des étrangers. En 2018 ce chiffre était de 149. La majorité des prisonniers exécutés l’ont été pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ou pour meurtre. Cependant, Amnistie internationale a également constaté une augmentation du recours à la peine de mort comme arme politique contre les dissidents de la minorité musulmane chiite en Arabie saoudite. Le 23 avril 2019, quelque 37 hommes, dont 32 chiites déclarés coupables de « terrorisme » à l’issue de procès fondés sur des « aveux » obtenus sous la torture, ont été mis à mort dans le cadre d’une exécution collective. L’une des personnes exécutées le 23 avril était Hussein al Mossalem. Il avait subi de multiples blessures, notamment des fractures du nez, de la clavicule et de la jambe, pendant qu’il était détenu à l’isolement et avait été frappé avec une matraque électrique et soumis à d’autres formes de torture. Hussein al Mossalem avait été jugé devant le Tribunal pénal spécial saoudien, créé en 2008 pour juger les personnes accusées d’infractions liées au terrorisme, mais de plus en plus utilisé pour museler la dissidence. En Irak, le nombre de personnes exécutées a presque doublé en un an, passant d’au moins 52 en 2018 à au moins 100 en 2019, ce qui est en grande partie le résultat du recours persistant à la peine de mort contre les personnes accusées d’être membres du groupe armé se désignant sous le nom d’État islamique. Au Soudan du Sud, les autorités ont exécuté au moins 11 personnes en 2019, soit le nombre le plus élevé d’exécutions recensées dans le pays depuis son indépendance, en 2011. Le Yémen a exécuté au moins sept personnes en 2019, contre au moins quatre en 2018. Bahreïn a également repris les exécutions, après une interruption d’un an, mettant trois personnes à mort au cours de l’année. Manque de transparence quant au recours à la peine de mort De nombreux pays n’ont pas publié ou fourni d’informations officielles sur leur recours à la peine de mort, ce qui souligne le manque de transparence de la part de nombreux gouvernements concernant cette pratique. L’Iran se place en deuxième position après la Chine en ce qui concerne le recours à la peine capitale. Le pays a exécuté au moins 251 personnes en 2019, contre au moins 253 en 2018. Parmi les personnes exécutées, quatre avaient moins de 18 ans au moment des faits qui leur étaient reprochés. Cependant, le manque de transparence rend difficile la confirmation du nombre réel d’exécutions, qui pourrait être plus élevé. Le 25 avril 2019, les autorités iraniennes ont notamment exécuté en secret deux garçons, Mehdi Sohrabifar et Amin Sedaghat, dans la prison d’Adelabad, à Chiraz, dans la province du Fars. Arrêtés alors qu’ils avaient 15 ans, tous deux avaient été déclarés coupables de multiples accusations de viol à l’issue d’un procès inique. Non seulement ils n’avaient pas été informés avant leur exécution de leur condamnation à mort mais en plus, leurs corps portaient des traces de coups de fouet, indiquant qu’ils avaient été fouettés avant leur mise à mort. « Même les pays défendant le plus ardemment la peine de mort ont des difficultés à justifier son utilisation et préfèrent tenir les informations à ce sujet secrètes. Nombre de ces pays déploient des efforts considérables pour dissimuler leur recours à la peine capitale, conscients qu’il ne saurait être justifié face à la surveillance internationale », a déclaré Clare Algar. « Des exécutions sont menées en secret dans de nombreux pays du monde. Dans des pays allant du Bélarus au Botswana, en passant par l’Iran et le Japon, des exécutions ont été menées sans que les familles des personnes condamnées, leurs avocats et parfois même les personnes condamnées n’aient été avertis. » L’abolition mondiale à portée de main Pour la première fois depuis 2011, la région Asie-Pacifique a enregistré une diminution du nombre de pays procédant à des exécutions, ce nombre s’élevant à sept pour l’année 2019. Le nombre de personnes exécutées au Japon et à Singapour a diminué considérablement par rapport à 2018, passant respectivement de 15 à trois, et de 13 à quatre. Pour la première fois depuis 2010, aucune exécution n’a été recensée en Afghanistan en 2019. Des interruptions ont été constatées à Taiwan et en Thaïlande, où des exécutions avaient été recensées en 2018, et le Kazakhstan, la Fédération de Russie, le Tadjikistan, la Malaisie et la Gambie ont continué d’observer des moratoires officiels sur les exécutions. À la fin de l’année 2019, 106 pays avaient aboli la peine de mort pour tous les crimes et 142 pays étaient abolitionnistes en droit ou en pratique. En outre, plusieurs pays ont pris des mesures positives en vue de mettre fin au recours à la peine capitale. Le président de la Guinée équatoriale a notamment annoncé en avril que son gouvernement présenterait une loi visant à abolir la peine de mort. Des avancées qui pourraient mener à l’abolition de la peine de mort ont également été constatées au Kenya, en Gambie, en République centrafricaine et au Zimbabwe. La Barbade a également supprimé l’imposition obligatoire de la peine de mort de sa Constitution. Aux États-Unis, le gouverneur de Californie, État où le nombre de prisonniers sous le coup d’une sentence capitale est le plus élevé, a instauré un moratoire officiel sur les exécutions, et le New Hampshire est devenu le 21e État à abolir la peine de mort pour tous les crimes. Cependant, la tentative des Philippines de rétablir la peine de mort pour les « crimes odieux liés aux stupéfiants et au pillage » et celle du Sri Lanka de reprendre les exécutions pour la première fois en plus de 40 ans ont entaché les progrès vers l’abolition mondiale de la peine capitale. Le gouvernement fédéral américain a également menacé de reprendre les exécutions après n’en avoir mené aucune pendant près de 20 ans. « Il faut maintenir la dynamique en faveur de l’abolition mondiale de la peine de mort », a déclaré Clare Algar. « Nous appelons tous les États à abolir la peine capitale. Les derniers pays procédant à des exécutions doivent être soumis à une pression mondiale en vue de mettre fin à cette pratique inhumaine une bonne fois pour toutes. »  Le monde entier lutte actuellement contre le COVID-19 et des pays de toute l’Afrique subsaharienne ont pris un certain nombre de mesures visant à enrayer la propagation de ce coronavirus mortel sur leur territoire. Bien que la pandémie de COVID-19 rappelle cruellement que le droit à la vie est important et doit être protégé, un nouveau rapport d’Amnistie internationale sur le recours à la peine de mort dans le monde en 2019 montre que certains États de la région ne s’efforcent pas systématiquement de protéger ce droit. En réalité, ils s’évertuent parfois à le bafouer en condamnant à mort ou en exécutant des personnes. En 2019, quatre pays de la région – le Botswana, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud – ont procédé à des exécutions, alors que le nombre d’exécutions connues à l’échelle mondiale a baissé de 5 %. Amnistie internationale a pu confirmer une exécution au Botswana, une au Soudan, 11 au Soudan du Sud et 12 en Somalie. Ces pays sont tristement célèbres pour être ceux qui persistent, en Afrique subsaharienne, à ôter la vie à des personnes condamnées et cette mauvaise réputation ne fait que croître ; ce sont eux aussi qui ont procédé à des exécutions en 2018, comme ils l’ont fait régulièrement ces 10 dernières années. Mokgweetsi Masisi, nouveau président du Botswana depuis octobre 2019, n’a pas ralenti le rythme des exécutions dans son pays, qui est le seul d’Afrique australe à maintenir cette pratique. Outre l’exécution qui s’est déroulée en décembre 2019, trois autres ont déjà eu lieu depuis le début de l’année 2020. La situation au Soudan du Sud est encore plus préoccupante. En effet, depuis qu’il est devenu indépendant du Soudan en 2011, ce pays a exécuté au moins 43 personnes. Le record absolu a été atteint en 2019, avec 11 exécutions enregistrées, ce qui représentait une hausse considérable du total annuel. Sept hommes, dont trois d’une même famille, ont été exécutés en février. Les autorités n’ont même pas prévenu leurs proches. Quatre personnes ont été exécutées par la suite : deux le 27 septembre et deux le 30, dont une qui était mineure au moment de l’infraction commise. Ce jeune homme avait environ 17 ans lorsqu’il a été déclaré coupable et condamné à mort, ce qui est contraire au droit international relatif aux droits humains et à la Constitution du Soudan du Sud. En effet, celle-ci interdit le recours à la peine de mort à l’encontre de personnes qui étaient mineures au moment des faits qui leur sont reprochés. Il est alarmant de constater que le nombre de condamnations à mort confirmées en Afrique subsaharienne a augmenté de 53 % entre 2018 et 2019, passant de 212 à 325. Cela s’explique par les hausses enregistrées dans 10 pays, à savoir le Kenya, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe. Au total, des condamnations à mort ont été confirmées dans 18 pays en 2019, soit un de plus qu’en 2018. L’accroissement du nombre de condamnations à mort enregistrées en Zambie est tout à fait saisissant. Selon les informations communiquées par les autorités, 101 personnes ont été condamnées à mort, ce qui représente une forte hausse par rapport à 2018, année pendant laquelle Amnistie internationale avait recensé 21 peines capitales prononcées. Par ailleurs, huit personnes initialement condamnées à mort ont finalement été innocentées par la justice zambienne. Elles auraient pu être exécutées pour une infraction qu’elles n’avaient en réalité pas commise. Cela montre que les tribunaux ne sont pas infaillibles et que le risque de punir et d’exécuter une personne innocente en cas de recours à la peine capitale ne peut jamais être éliminé. À la fin de l’année, au moins 5 731 personnes étaient sous le coup d’une condamnation à mort en Afrique subsaharienne ; le Kenya et le Nigeria représentaient 65 % de ce total. Ces personnes risquent davantage d’être exécutées une fois qu’elles ont épuisé leurs voies de recours et lorsqu’il n’existe pas de moratoire officiel sur les exécutions dans leur pays. Même quand elles peuvent encore interjeter appel, l’impossibilité de bénéficier d’une représentation juridique efficace, la lenteur de la procédure, le rejet des demandes de grâce et les conditions carcérales déplorables peuvent faire de leur vie un calvaire. Néanmoins, l’année 2019 n’a pas été totalement négative. Le soutien à la peine de mort semble s’amenuiser dans certains pays de la région, qui ont pris des mesures ou fait des annonces susceptibles d’aboutir à l’abolition de ce châtiment. En République centrafricaine, l’Assemblée nationale a pris la décision d’examiner une proposition de loi sur l’abolition de la peine capitale. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema a annoncé qu’il présenterait un projet de loi abolitionniste au Parlement. En Gambie, la Commission de révision de la Constitution a publié en novembre un projet de texte ne contenant plus aucune disposition relative à la peine capitale. Au Kenya, l’équipe spéciale chargée d’examiner la question de la peine de mort obligatoire a recommandé que le Parlement abolisse totalement ce châtiment, tandis que les autorités zimbabwéennes y réfléchissaient sérieusement. La peine de mort est une violation du droit à la vie et constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. L’opposition à la peine capitale n’est pas synonyme de tolérance à l’égard de la criminalité. En effet, toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale dûment reconnue par la loi à l’issue d’un procès équitable doit être tenue pour responsable, sans jamais encourir la peine de mort. Il faut évidemment que les États combattent les maladies mortelles, y compris le COVID-19, mais aussi qu’ils protègent le droit à la vie en abolissant la peine capitale. Cet article a initialement été publié par The Daily Maverick.  Un tribunal houthiste siégeant à Sanaa a condamné à mort quatre journalistes à l’issue d’un procès manifestement inique. Ces derniers sont détenus avec six autres confrères depuis 2015. Tous ont été soumis à une disparition forcée, détenus au secret et à l’isolement pendant certaines périodes, et privés de soins médicaux. Au moins trois d’entre eux ont été torturés et soumis à d’autres formes de mauvais traitements. PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS Représentant de l’Ansarullah aux négociations de paix Mohamed Abdelsalam Courriel : Twitter : @abdusalamsalah Monsieur Abdelsalam, Le 11 avril 2020, le Tribunal pénal spécial de Sanaa a condamné à mort quatre hommes parmi un groupe de 10 journalistes qui attendaient d’être jugés depuis 2015. Akram al Walidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid et Tawfiq al Mansouri ont été déclarés coupables sur la base d’éléments forgés de toutes pièces. Leur avocat va faire appel de ce jugement, mais la date de la prochaine audience du tribunal reste inconnue. En décembre 2018, après avoir été interrogés en présence de leurs avocats, les dix journalistes ont été officiellement inculpés d’une série de chefs d’accusation, dont un d’espionnage, passible de la peine de mort. Les charges retenues contre eux sont les suivantes : « espionnage pour le compte de l’Arabie saoudite » ; « création de plusieurs sites Web sur Internet et les réseaux sociaux » ; et « diffusion de rumeurs, de fausses nouvelles et de déclarations en faveur de l’ennemi saoudien et de ses alliés contre la République du Yémen ». La première audience a eu lieu le 9 décembre 2019. Les avocats ont été autorisés à y assister, mais l’accès leur a ensuite été refusé à toutes les autres audiences, y compris la dernière à l’issue de laquelle quatre condamnations à mort ont été prononcées. Depuis le début de leur détention en 2015, les 10 journalistes ont souffert de divers problèmes médicaux, notamment de douleurs au niveau de l’estomac et du côlon, de troubles auditifs, d’hémorroïdes, ainsi que de maux de tête dus à des problèmes de vision, pour lesquels ils n’ont pas bénéficié d’une prise en charge adaptée. Selon la famille d’Abdelkhaleq Amran, en novembre 2016, des personnes détenues au Bureau de la sécurité politique dans des cellules situées à proximité de la sienne l’ont entendu crier pendant qu’on le torturait. D’autres journalistes ont également été soumis à des actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements et se sont systématiquement vu refuser des soins médicaux urgents et des visites de leurs proches. Nous demandons aux autorités houthies d’annuler immédiatement ces condamnations à mort, d’abandonner toutes les poursuites engagées contre les 10 journalistes et de les libérer. Dans l’attente de leur libération, les autorités doivent leur permettre de bénéficier d’une assistance juridique, de contacter régulièrement leurs familles et de recevoir des soins médicaux adaptés. Enfin, elles doivent diligenter une enquête efficace, indépendante et impartiale sur les allégations de torture et d’autres mauvais traitements, afin que tous les responsables présumés soient amenés à rendre des comptes. Je vous prie d’agréer, Monsieur Abdelsalam, mes salutations distinguées. COMPLÉMENT D'INFORMATION Neuf des journalistes ont été arrêtés lors d’une même descente de police à l’hôtel Qasr al Ahlam, situé à Sanaa, le 9 juin 2015. Abdelkhaleq Amran, Hisham Tarmoom, Tawfiq al Mansouri, Hareth Humid, Hasan Annab, Akram al Walidi, Haytham al Shihab, Hisham al Yousefi et Essam Balgheeth travaillaient dans une chambre qu’ils avaient louée sur place car cet établissement était l’un des rares lieux de la ville disposant d’une connexion Internet et de l’électricité. Le 10e journaliste, Salah al Qaedi, a été arrêté par les Houthis à son domicile de Sanaa le 28 août 2015 selon un témoin. Cinq minutes après, ceux-ci sont revenus sur place et ont ordonné à ses proches de leur remettre son ordinateur et son matériel, en menaçant d’arrêter le reste de la famille. Quand ses proches ont répondu qu’ils n’avaient pas son matériel, les Houthis ont arrêté les sept hommes de la famille et les ont détenus pendant 48 heures. Le 16 mars 2016, neuf des journalistes concernés, à l’exception de Salah al Qaedi, ont été transférés du centre de détention provisoire d’Al Thawra à celui d’Al Habra. Salah al Qaedi, quant à lui, était détenu à Al Habra depuis la mi-octobre 2015. Le 23 mai 2016, les familles des 10 journalistes détenus se sont rendues à Al Habra pour leur rendre visite. À leur arrivée, des gardiens leur ont dit qu’ils n’étaient plus là mais ont refusé de révéler où ils se trouvaient. Ils ont été détenus sans être jugés ni même inculpés jusqu’en décembre 2018. Ils ont alors été officiellement inculpés après avoir été interrogés en présence de leurs avocats. La première audience de leur procès a eu lieu le 9 décembre 2019. Sans en informer leurs avocats ni leurs familles, le tribunal a condamné Tawfiq al Mansouri, Abdelkhaleq Omran, Akram al Walidi et Hareth Hamid à la peine de mort lors de leur dernière audience, le 11 avril 2020. Les avocats ont été empêchés de représenter ces hommes et d’assister à l’audience. Toutes les parties au conflit qui se déroule au Yémen, y compris les forces houthies, le gouvernement, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et les forces yéménites soutenues par les Émirats, se sont livrées à des pratiques de détention arbitraire. Dans les zones sous leur contrôle, les forces houthies ont arrêté et détenu arbitrairement des détracteurs et des opposants, ainsi que des journalistes, des défenseurs des droits humains et des membres de la communauté baha’i, dont beaucoup ont subi des procès iniques, une détention au secret ou encore une disparition forcée. La majorité des personnes visées étaient des membres ou des sympathisants du parti politique Al Islah. Le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale a harcelé, menacé et détenu arbitrairement des défenseur·e·s des droits humains et d’autres militant·e·s. Dans le sud du pays, les forces yéménites soutenues par les Émirats arabes unis ont mené une campagne de détentions arbitraires et de disparitions forcées. En mai 2018, Amnistie internationale a publié un rapport exposant de manière détaillée les cas de 51 hommes détenus dans un réseau de prisons secrètes par des forces émiriennes et yéménites opérant en dehors du contrôle du gouvernement yéménite, y compris des personnes détenues entre mars 2016 et mai 2018. LANGUES À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : arabe et anglais Vous pouvez également écrire dans votre propre langue. MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 2 juin 2020 NOMS : Tawfiq al Mansouri, Abdelkhaleq Omran, Akram al Walidi et Hareth Hamid  L’exécution de Shayan Saeed le 21 avril 2020 en Iran, pour un crime commis alors qu’il était mineur, démontre une nouvelle fois le mépris total des autorités iraniennes pour le droit à la vie. Le 21 avril au matin, les autorités iraniennes ont exécuté Shayan Saeedpour, 21 ans, à la prison centrale de Saqqez, dans la province du Kurdistan. Un tribunal pénal de la province du Kurdistan l’avait condamné à mort en octobre 2018 après l’avoir déclaré coupable de meurtre. Cette déclaration de culpabilité était liée au meurtre d’un homme poignardé lors d’une bagarre en août 2015. Shayan Saeedpour avait 17 ans à l’époque. « Le recours à la peine de mort contre Shayan Saeedpour, un jeune homme qui avait de lourds antécédents de troubles psychologiques, était illégal » « L’exécution de Shayan Saeedpour est un acte de vengeance cruel », a déclaré Diana Eltahawy, directrice adjointe d’Amnistie internationale pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. « Le recours à la peine de mort contre Shayan Saeedpour, un jeune homme qui avait de lourds antécédents de troubles psychologiques, était illégal. En procédant à cette exécution malgré l’opposition internationale, les autorités iraniennes ont une nouvelle fois bafoué la justice pour mineurs. » « La peine de mort est le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit et son utilisation contre des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des faits pour lesquels elles sont condamnées bafoue le droit international. Notre rapport annuel sur la peine de mort démontre que l’Iran fait partie d’une minorité de pays dans le monde qui continue d’avoir recours à ce châtiment contre des personnes entrant dans cette catégorie. Cette pratique est odieuse et doit cesser. » Amnistie internationale a publié le 21 avril 2020 son rapport annuel sur la peine de mort, qui démontre que, bien que le nombre total d’exécutions ait diminué, l’Iran reste le deuxième pays procédant au plus grand nombre d’exécutions, après la Chine. UNE FUITE DE PRISON ET UNE EXÉCUTION À TITRE DE REPRÉSAILLES Shayan Saeedpour faisait partie des dizaines détenus qui s’étaient échappés de la prison centrale de Saqqez à la fin du mois de mars lors de manifestations et d’émeutes liées à l’absence de réaction des autorités face à la crainte de la propagation du COVID-19 dans les prisons. Il avait été de nouveau arrêté le 3 avril. Amnistie internationale pense que son exécution pourrait avoir été menée à titre de représailles des autorités locales, afin de dissuader d’autres détenus d’essayer de s’enfuir également. D’après les informations dont dispose Amnistie internationale, le procureur général de Saqqez avait demandé son exécution à plusieurs reprises ces derniers jours et avait même demandé à la famille de la victime de ne pas pardonner Shayan Saeedpour. Au titre de la loi iranienne, les proches d’une victime de meurtre peuvent accorder un pardon à la personne condamnée, en échange du « prix du sang ». L’application des peines relève du ministère public. Complément d’information Shayan Saeedpour avait des antécédents de troubles mentaux et on lui avait diagnostiqué des troubles du contrôle des impulsions. Amnistie internationale croit savoir que, malgré le jeune âge de Shayan Saeedpour, l’Organisation iranienne de médecine légale avait déclaré dans un document remis au tribunal lors du procès qu’il avait atteint la « maturité psychologique » au moment du crime et qu’il « était capable de distinguer le bien du mal ». La famille de Shayan Saeedpour et son avocat avaient contesté cette évaluation, affirmant qu’il n’était pas psychologiquement mature au moment du crime. Son avocat avait également soulevé des inquiétudes quant au fait que le tribunal n’avait pas tenu compte du diagnostic de troubles du contrôle des impulsions. DES MINEURS DÉLINQUANTS DANS LE QUARTIER DES CONDAMNÉS À MORT L’Iran est l’un des derniers pays au monde à continuer d’avoir recours à la peine de mort contre des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des faits qui leur sont reprochés. En 2019, Amnistie internationale a recensé l’exécution de quatre personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des faits pour lesquels elles avaient été condamnées en Iran. Leurs noms étaient Amin Sedaghat, Mehdi Sohrabifar, Amir Ali Shadabi et Touraj Aziz (Azizdeh) Ghassemi. Amnistie internationale est préoccupée par le fait que 90 autres mineurs délinquants au moins se trouvent sous le coup d’une condamnation à mort en Iran. L’organisation s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, sans exception, car elle constitue une violation du droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. 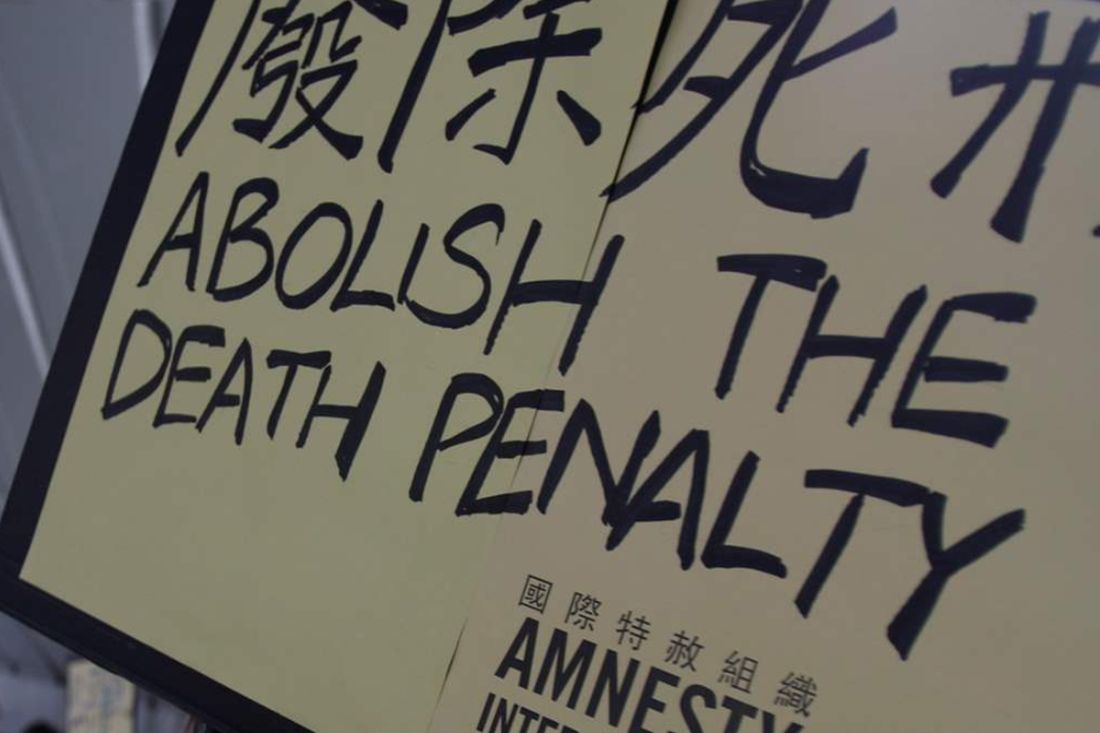 On ne connaît toujours le lieu de détention de l'éminent universitaire ouïghour Tashpolat Tiyip et le risque d'une exécution ne peut être écarté. Soumis à une disparition forcée en 2017, sa famille a reçu des informations en septembre 2019 qu'il aurait reçu une condamnation à mort avec sursis. Depuis, les autorités chinoises ont indiqué qu'il subi un procès sous des accusations de corruption, sa condition actuelle et son lieu de détention demeurent inconnus. Aucune information n’a été communiquée sur les faits qui lui sont reprochés ni sur la procédure intentée à son encontre, il y a de fortes craintes sur le sort réservé à Tashpolat Tiyip. PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS Procureur général Li Yongjun Xinjiang Uyghur Autonomous Regional People’s Procuratorate No 122, Jianguo lu,Urumqi 830002, Xinjiang Uyghur Autonomous Region Chine Télécopieur : +86 10 6238 1025 Courriel : Monsieur, Je vous demande de bien vouloir intervenir de toute urgence en faveur de Tashpolat Tiyip, ancien président de l’université du Xinjiang. Tashpolat Tiyip a été arrêté en 2017, alors qu’il se rendait à une conférence en Allemagne en compagnie d’un groupe d’étudiants. Il est maintenu en détention depuis lors, sans que l’on sache où il se trouve. Selon les informations reçues par Amnistie internationale, cet homme a été déclaré coupable de «séparatisme» à l’issue d’une procédure d’une iniquité flagrante et entourée de secret, puis condamné à la peine capitale assortie d’un «sursis», ce qui signifie que cette sentence devrait être commuée en réclusion à perpétuité après deux années sans autre infraction. C’est pourquoi je vous demande :
COMPLÉMENT D’INFORMATION Tashpolat Tiyip est un géographe connu pour ses travaux de recherche sur l’impact de la désertification sur l’environnement du Xinjiang. Il a été nommé au poste de président de l’université du Xinjiang en 2010. En mars 2017, il a été arrêté à l’aéroport international de Pékin alors qu’il se rendait en Allemagne en compagnie d’étudiants. Il aurait été condamné à mort pour séparatisme, la peine étant assortie d’un sursis de deux années. Le 27 décembre 2019, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a démenti ces informations, affirmant que Tashpolat Tiyip était soupçonné de corruption, et qu’il n’avait pas encore été jugé. Les Ouïghours sont une minorité ethnique principalement de confession musulmane. Ils vivent surtout dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, en Chine. Depuis les années 1980, ils sont la cible de violations graves et systématiques des droits humains: arrestations et incarcérations arbitraires, détention au secret, restrictions de la liberté de religion et de l’exercice des droits sociaux et culturels, notamment. Les autorités locales continuent de contrôler étroitement la pratique religieuse, y compris en interdisant à tous les fonctionnaires et aux mineurs de moins de 18 ans de fréquenter les mosquées. Les politiques gouvernementales chinoises limitent l’usage de la langue ouïghoure, imposent des restrictions sévères à la liberté religieuse et soutiennent l’arrivée en masse de migrants hans dans la région. En mai 2014, une campagne visant à «frapper fort» a été lancée pour un an au Xinjiang. Les autorités ont privilégié les arrestations expéditives, les procès rapides et les condamnations collectives d’Ouïghours. Le gouvernement a appelé à un renforcement de la «coopération» entre le parquet et les tribunaux, ce qui a avivé les craintes quant à l’équité des procès. La campagne visant à «frapper fort» a été prolongée dans les années qui ont suivi, et les autorités ont nettement augmenté les dépenses allouées à la police. De nombreux Ouïghours ont alors décidé de fuir le pays. Les autorités chinoises ont répliqué en harcelant leurs proches afin de faire pression sur eux pour qu’ils reviennent, et en s’efforçant de limiter les activités des militants politiques et des défenseurs des droits humains ouïghours à l’étranger. De nombreux Ouïghours vivant à l’étranger, et notamment les demandeurs d’asile et les réfugiés, craignent d’autant plus le renvoi forcé en Chine. Ces dernières années, des dizaines de demandeurs d’asile ouïghours ont été renvoyés de force vers la Chine depuis des pays d’Asie du Sud-Est et d’Asie centrale. Les médias ont fait état de l’ampleur et de la sévérité des nouvelles mesures en matière de sécurité qui ont été appliquées depuis l’arrivée au pouvoir, en 2016, de Chen Quanguo, le nouveau secrétaire du parti au Xinjiang ; plus de 90 000 postes liés à la sécurité ont ainsi été annoncés en l’espace d’un an. En octobre 2016, ils ont relayé de nombreuses informations faisant état de la confiscation de passeports ouïghours par les autorités de la région dans le but de limiter davantage encore le droit de circuler librement. En mars 2017, les autorités du Xinjiang ont adopté le «Règlement de lutte contre l’extrémisme», qui définit et interdit un large éventail de comportements qualifiés d’«extrémistes», tels que la «diffusion de pensées extrémistes», le fait de critiquer ou de refuser d’écouter ou de regarder des émissions de la radio et de la télévision publiques, le port de la burqa, le port d’une barbe «anormale», le fait de s’opposer aux politiques nationales, et la publication, le téléchargement, le stockage et la lecture d’articles, de publications ou de matériel audiovisuel présentant un «contenu extrémiste». Cette réglementation a en outre instauré un «système de responsabilisation» destiné aux cadres du gouvernement pour les activités de «lutte contre l’extrémisme», et mis en place une évaluation annuelle de leurs performances. Selon Radio Free Asia, les autorités chinoises ont commencé en mai 2017 à contraindre des Ouïghours étudiant dans des universités à l’étranger à rentrer en Chine. Début juillet 2017, quelque 200 Ouïghours ont été arrêtés en Égypte sur ordre des autorités chinoises, et l’on reste sans nouvelles de 16 d’entre eux qui ont été renvoyés de force dans leur pays. Amnistie internationale demeure également préoccupée par le secret qui entoure le recours à la peine de mort au Xinjiang, dans le contexte des mesures de sécurité renforcées appliquées dans le cadre des campagnes visant à «frapper fort». Ces campagnes impliquent généralement une augmentation du recours à la peine de mort, et des universitaires ont critiqué la procédure appliquée à cause de l’absence de garanties en matière d’équité des procès et du risque d’«exécutions injustifiées» qu’elle implique. Dans une enquête approfondie publiée en avril 2017 et intitulée China’s Deadly Secrets, Amnistie internationale montre que les autorités chinoises, qui prétendent pourtant améliorer la transparence du système judiciaire, ont instauré un dispositif complexe pour masquer l’ampleur réelle des exécutions. Au cours de cette enquête, l’organisation a découvert que plusieurs centaines d’exécutions rapportées par les médias publics ne figurent pas sur China Judgements Online, la base de données nationale de la justice accessible sur Internet, alors que ces cas devraient y être recensés au regard de la réglementation chinoise. Étaient tout particulièrement concernées les affaires portant sur la région du Xinjiang où l’accusé encourt la peine de mort. Amnistie internationale est opposée en toutes circonstances et de manière inconditionnelle à la peine de mort, qui constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit, ainsi qu’une violation du droit à la vie. Elle milite depuis plus de 40 ans en faveur de l’abolition de ce châtiment dans le monde entier. LANGUES À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : anglais, chinois ou dans votre propre langue. MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 31 mai 2020 NOM : Tashpolat Tiyip (il). |
Centre de presseLe centre de presse du Secrétariat international met à la disposition des professionnels et du grand public des nouvelles de dernière minute, des commentaires de spécialistes et des informations importantes sur la situation dans le monde relative à la peine de mort. Archives
Septembre 2022
Catégories
Tout
|
Amnistie internationale Canada francophone - Abolition de la peine de mort - Tél. : 819-944-5157
Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca
Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca

 Flux RSS
Flux RSS
