 Chrétienne pakistanaise et mère de cinq enfants, Asia Bibi avait été condamnée à mort pour blasphème. Elle vient d’être acquittée. Elle avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010 et avait été déboutée en appel par la haute cour de Lahore. Âgée de 45 ans et mère de cinq enfants, cette femme avait été déclarée coupable de blasphème le 8 novembre 2010 et condamnée à la peine capitale en vertu de la section 295C du Code pénal pakistanais car elle aurait outragé le prophète Mahomet lors d'une altercation avec une musulmane. Depuis sa première arrestation, en 2009, Asia Bibi a été maintenue dans un isolement presque total afin d'être protégée. Son état de santé mentale et physique se serait détérioré pendant sa détention, notamment dans le quartier des condamnés à mort, et sa famille et ses avocats continuent de craindre pour sa sécurité. En décembre 2010, un éminent religieux musulman a proposé une récompense d'un demi-million de roupies pakistanaises (environ 3 800 euros) à quiconque tuerait Asia Bibi. UN PROCÈS REMIS EN CAUSE L'équité de son procès était fortement mise en doute. Asia Bibi affirme que les éléments attestant prétendument le blasphème, qui ont été jugés recevables par différents tribunaux, ont été forgés de toutes pièces et qu'elle n'a pas pu consulter d'avocat pendant sa détention ni le dernier jour de son procès, en 2010. L'avocat d'Asia Bibi estime que l'affaire est fondée sur des ouï-dire. Des défenseurs des droits humains ont dénoncé, quant à eux, le fait que les juges de la haute cour de Lahore avaient peut-être débouté Asia Bibi de son appel par crainte pour leur sécurité. Des groupes religieux réclamant l'exécution de cette femme étaient présents au tribunal. DES LOIS SUR LE BLASPHÈME À L’ENCONTRE DU DROIT INTERNATIONAL Asia Bibi n'aurait jamais dû être emprisonnée car les lois relatives au blasphème vont à l'encontre des obligations internationales du Pakistan en matière de droits humains. En effet, cet État est tenu de garantir les droits à la liberté d'expression et aux libertés de pensée, de conscience et de religion. Ces lois servent fréquemment à régler des différends entre particuliers, et les personnes accusées de blasphème sont souvent la cible d'actes de violence. Le droit international n'autorise pourtant le recours à la peine de mort que pour les « crimes les plus graves », qui correspondent uniquement aux homicides volontaires. Personne n'a jamais été exécuté pour blasphème au Pakistan. Cependant, depuis que les lois relatives au blasphème sous leur forme actuelle sont entrées en vigueur dans les années 1980, des dizaines de personnes appartenant à différentes communautés religieuses, notamment des musulmans, ont été attaquées et tuées par des particuliers à la suite d'accusations de blasphème, y compris en détention.
0 Commentaires
Arabie saoudite. Le parquet demande l'exécution de militants et de responsables religieux.10/26/2018  Les autorités saoudiennes intensifient la répression contre les dissidents, comme le montrent les récents appels du parquet en faveur de l’exécution d’un certain nombre de responsables religieux et de militants qui doivent être jugés par le tribunal pénal spécial, la juridiction antiterroriste du pays. Six personnes doivent comparaître la semaine prochaine devant ce tribunal. Elles sont passibles de la peine de mort pour des faits relevant de l’exercice non violent de leurs droits à la liberté d'expression, d’association et de réunion. Parmi elles figurent un responsable religieux de premier plan, Sheikh Salman al-Awda, et le militant Israa al-Ghomgham. Les appels réitérés du parquet, ces trois derniers mois, à condamner à la peine capitale au moins huit personnes, suscitent une vive inquiétude quant au sort de dizaines de militants actuellement en détention sans inculpation ni jugement, ainsi que des personnes comparaissant actuellement devant le tribunal pénal spécial. Amnistie internationale demande aux autorités saoudiennes de libérer immédiatement toutes les personnes arrêtées pour avoir seulement voulu exercer sans violence leurs droits à la liberté d'expression, d’association et de réunion, d’abandonner les poursuites entamées contre elles et de renoncer à toutes velléités de soumettre à la peine de mort celles qui sont actuellement en cours de jugement. Les pouvoirs publics doivent immédiatement arrêter toutes les exécutions et commuer les peines capitales déjà prononcées. Ce serait un premier pas vers l’abolition du châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. DES RESPONSABLES RELIGIEUX PASSIBLES DE LA PEINE DE MORT Sheikh Salman al-Awda doit comparaître le 30 octobre en troisième audience devant le tribunal pénal spécial. Il risque la peine de mort, le ministère public ayant demandé qu’il soit exécuté. Sheikh Salman al-Awda a comparu devant le tribunal en août 2018, dans le cadre d’une audience secrète, au cours de laquelle 37 chefs d’accusation lui ont été signifiés. Il était notamment accusé d’appartenir à l’organisation des Frères musulmans et d’avoir appeler à des réformes au niveau de l’État, ainsi qu’à un changement de régime dans le monde arabe. Il a été maintenu en détention au secret et à l’isolement pendant les cinq premiers mois ayant suivi son arrestation, sans contact avec sa famille ni avec un avocat, excepté un bref appel téléphonique un mois après son interpellation. Sa famille a appris en janvier qu’il avait été hospitalisé, car son état de santé s’était dégradé en détention. Il n’a été autorisé à appeler ses proches qu’un mois plus tard. Les membres de la famille proche de Salman al-Awda sont tous interdits de déplacement à l'étranger. Salman al-Awda a été interpellé chez lui le 7 septembre 2017 par des agents des services de sécurité, sans mandat, quelques heures après avoir posté un tweet en réaction à un article sur la possible réconciliation entre l'Arabie saoudite et le Qatar dans un contexte de crise diplomatique. Il avait écrit : « Que Dieu mette leurs coeurs en harmonie pour le bien des peuples ». D'après sa famille, les autorités avaient demandé à Salman al-Awda et à d'autres personnalités de poster des tweets en soutien au gouvernement saoudien durant la crise avec le Qatar, l’an dernier, ce qu’il avait refusé de faire. Selon des informations parvenues à Amnistie internationale, des hommes en civil et cagoulés appartenant vraisemblablement à la Direction de la sûreté de l’État auraient perquisitionné son domicile en novembre 2017, sans mandat, et auraient saisi du matériel électronique et des livres. Âgé de 61 ans, Sheikh Salman al-Awda est une personnalité religieuse en vue, qui appelle de ses voeux depuis le début des années 1990 des réformes politiques et démocratiques en Arabie saoudite et dans d’autres pays arabes. Il s’était prononcé en faveur de la mise en place d’un Conseil consultatif, qui a finalement été créé officiellement et étendu en Arabie saoudite. Il a déjà été arrêté en 1994 et a passé cinq ans en détention, jusqu’en 1999, sans inculpation ni procès, pour avoir maintenu ses appels à la réforme et avoir publié des déclarations sur la coexistence, les droits et les libertés dans un cadre islamique. Au moment des soulèvements qui ont secoué le monde arabe, en 2011, Sheikh Salman al-Awda avait fait paraître un ouvrage intitulé « Questions de révolution », invitant les États de la région a se pencher sur lescauses profondes du mécontentement. Avant son arrestation, l’année dernière, il avait en outre été interdit à plusieurs reprises de déplacement, de prise de parole et d’expression dans la presse. Ali al-Omari et Sheikh Awad al-Qarni, ont également été interpelés dans le cadre de la vague d’arrestations qui a frappé en septembre 2017diverses personnalités religieuses, des écrivains, des journalistes, des universitaires et des défenseurs des droits humains. Ces deux responsables religieux risquent aujourd’hui la peine de mort, le paquet ayant publiquement demandé qu’ils soient exécutés. Ali al-Omari est une personnalité médiatique en vue. Il est le fondateur de la chaîne de télévision par satellite « 4Shabab », qui fait la promotion des valeurs religieuses et traite de la place dans la société de diverses questions historiques, sociales et politiques. Sheikh Awad al-Qarni est un important responsable religieux, auteur d’essais sur des questions spirituelles et sociétales. Selon des informations parvenues à Amnistie internationale, Ali al-Omari a été autorisé à parler brièvement au téléphone avec sa famille cinq mois après son arrestation. Depuis, il est détenu au secret et n’a eu aucun contact ni avec sa famille ni avec un avocat en plus de sept mois. Selon des sources d’information proches du gouvernement, son procès a débuté dans le plus grand secret le 5 septembre. Il faisait l’objet d’une trentaine de chefs d’accusation, dont « adhésion à une entité terroriste dans le Royaume (les Frères musulmans) qui oeuvre dans le secret total et cherche à semer la discorde, à déstabiliser le sécurité et à désobéir au souverain », « la mise en place d’antennes des Frères musulmans visant les jeunes dans les pays arabes » et « la création d’un chaîne de télévision par satellite dans deux pays arabes afin de diffuser la pensée des Frères musulmans ». Les dates des prochaines comparutions d’Ali al-Omari et de Sheikh Awad al- Qarni ne sont pas connues. La réquisition à plusieurs reprises de la peine de mort par le parquet contre des personnes arrêtées pour avoir voulu exercer pacifiquement leurs droits à la liberté d'expression, d’association et de réunion est un événement sans précédent, du moins dans un passé récent. C’est également un motif de grave préoccupation pour le sort d’autres personnes détenues sans inculpation ni jugement depuis septembre 2017, parmi lesquelles des écrivains, des journalistes et des défenseurs des droits humains. DES MANIFESTANTS CHIITES PASSIBLES DE LA PEINE DE MORT Israa al-Ghomgham a elle aussi été traduite devant le tribunal pénal spécial. La date de sa prochaine comparution est fixée au 28 octobre 2018. Cette militante est la première femme saoudienne susceptible d’être condamnée à mort pour avoir participé à des manifestations en faveur d’un renforcement des droits et de réformes dans la province orientale d’Arabie saoudite, à majorité chiite. Elle a été traduite devant le tribunal pénal spécial en compagnie de cinq autres personnes : Ahmed al-Matrood, Ali Ouwaisher, Mousa al-Hashim, Khalid al-Ghanim et Mujtaba al-Muzain. Selon le dossier judiciaire, le parquet a requis la mise à mort de cinq des accusés (Israa al-Ghomgham, Ahmed al-Matrood, Ali Ouwaisher, Mousa al-Hashim et Khalid al-Ghanim) pour avoir notamment pris part à des manifestations, infraction réprimée aux termes du Décret royal 44/A, émis en application de la Loi de 2014 sur les crimes relatifs au terrorisme et à son financement, et s’être rendus en Iran pour y suivre une formation théorique sur la manière d’organiser et de fomenter des émeutes. Il était également reproché à plusieurs des accusés d’avoir apporté un soutien moral aux émeutiers en participant aux funérailles des personnes tuées lors d’affrontements avec les forces de sécurité dans la province orientale. Ahmed al-Matrood, Ali Ouwaisher, Mousa al-Hashim et Khalid al-Ghanim étaient en outre inculpés d’atteinte à la Loi de 2014 sur les crimes relatifs au terrorisme et à son financement, pour avoir reçu de l’argent afin de se rendre en Iran et en Turquie. Le parquet a requis contre le sixième accusé, Mujtaba al-Muzain, la peine maximum prévue par le Décret royal 44/A, soit 20 ans d’emprisonnement. Les six prévenus ont passé plus de trois ans en détention provisoire avant le début de leur procès. Amnistie internationale a recueilli des informations sur au moins 34 hommes de religion chiite condamnés à mort pour avoir participé à des manifestations et pour des infractions relatives à la sûreté de l’État à l’issue de procès totalement inéquitables, où l’accusation était très largement fondée sur des « aveux » apparemment obtenus sous la torture ou par d’autres mauvais traitements. Yousuf al-Mushaikhass et trois autres hommes ont été exécutés l’an dernier après avoir été reconnus coupables par le tribunal pénal spécial d’infractions en rapport avec des manifestations commises dans le cadre du mouvement de contestation qui s'était développé dans la province orientale. À partir de février 2011, des milliers de Saoudiens appartenant à la minorité chiite du pays sont descendus dans la rue, un peu partout dans la province orientale, pour dénoncer leur marginalisation économique et politique et exiger des réformes religieuses, politiques et sociales. Ils demandaient notamment la libération de personnes détenues depuis longtemps sans inculpation ni procès et exigeaient le respect de leur droit à la liberté d'expression. Les pouvoirs publics répliquent depuis par des mesures de répression contre les personnes soupçonnées d’apporter leur soutien ou de participer aux manifestations, et contre les personnes qui critiquent les autorités. Les autorités saoudiennes ne montrent aucun signe de remise en question du recours à la peine capitale. Celle-ci est non seulement appliquée pour toute une série d’infractions, allant de l’homicide volontaire au trafic de drogue, mais elle sert également d’arme politique pour punir les membres de la minorité chiite saoudienne qui osent protester contre la manière dont ils sont traités et pour réduire les autres au silence. DEBUT DES PROCES DE MILITANTS DEVANT LE TRIBUNAL PENAL SPECIAL Selon des informations parvenues à Amnesty International, Essam al-Zamil, chef d’entreprise de premier plan et auteur d’essais sur l’économie, a été traduit ce mois-ci devant le tribunal pénal spécial. Il lui était reproché, entre autres, d’avoir déstabilisé le tissu social et la cohésion nationale ; semé la discorde par ses messages sur Twitter ; critiqué la politique étrangère des dirigeants du pays ; eu des contacts avec les autorités du Qatar après la crise diplomatique avec ce pays ; et rencontré des diplomates étrangers, en leur faisant part de renseignements et d’analyses concernant les politiques publiques du Royaume sans en informer les autorités saoudiennes. Essam al-Zamel a été arrêté en septembre 2017, en même temps qu’une vingtaine de religieux, d’écrivains, d’intellectuels et de militants. Il a passé plus d’un an en détention provisoire avant que son procès ne s’ouvre. La date de sa prochaine comparution n’est pas connue. Amnistie internationale demande aux autorités saoudiennes d'abandonner toutes les charges retenues contre Essam al-Zamel et de le libérer immédiatement et sans conditions. Essam al-Zamel publie des essais et des commentaires sur des questions économiques et sur les réformes nécessaires selon lui en Arabie saoudite. Avant son arrestation, en 2017, il avait critiqué l’introduction en bourse de la société Aramco, mesure clé du programme stratégique dit « Vision 2030 » de l’Arabie saoudite. Il est également le fondateur de la société Rimal Ventures, spécialisée dans les technologies de l'information. AUCUNE NOUVELLE DES MILITANTS ET PROCHES DE MILITANTS EN DETENTION SANS INCULPATION NI PROCES DEPUIS MAI 2018 Au moins 12 militants sont toujours détenus sans inculpation ni avocat depuis la dernière vague d’arrestations, qui a eu lieu en mai 2018. Parmi eux figurent notamment Loujain al-Hathloul, Iman al-Najfan et Aziza al-Yousef, trois défenseures des droits fondamentaux des femmes, arrêtées un mois avant la levée de l’interdiction faite aux femmes de conduire. Ces trois militantes sont à la pointe du combat pour les droits des femmes en Arabie saoudite, et notamment de la mobilisation pour mettre fin au système de la tutelle masculine. Elles sont toutes les trois, de même que deux autres militants arrêtés en même temps qu’elles, Ibrahim al-Modeimigh,qui est avocat, et Mohammad al-Rabea, un jeune activiste, accusées par la presse favorable au régime d’avoir enfreint le Décret royal 44/A, en constituant une « cellule » et en menaçant la sûreté de l’État par leurs « contacts avec des entités étrangères, avec la volonté de compromettre la stabilité et le tissu social du pays ». Amnistie internationale craint que ces cinq personnes ne soient traduites devant le tribunal pénal spécial. Selon des informations parvenues à Amnistie internationale, le Décret royal 44/A de février 2014 a été invoqué pour la première fois dans le procès de deux défenseurs des droits humains, Essam Koshak et Issa al-Nukheifi, condamnés il y a quelques mois à quatre et six ans d’emprisonnement, respectivement, en raison de leur engagement militant et de leur action en faveur des droits fondamentaux. Deux militantes de premier plan de la cause des droits humains des femmes, Samar Badawi et Nassima al-Sada ont également été arrêtées en août. Elles sont toujours détenues sans avoir été inculpées. Parmi les personnes arrêtées récemment figurent également des militantes des droits des femmes comme Nouf Abdulaziz et Mayaa al-Zahrani, et des défenseurs des droits humains qui avaient déjà été pris pour cible en raison de leur action, comme Mohammad al-Bajadi, membre fondateur de l’Association saoudienne des droits civils et politiques (ACPRA), et Khalid al-Omeir. L’universitaire Hatoon al-Fassi, militante très active des droits des femmes, aurait elle aussi été arrêtée quelques jours après la levée de l’interdiction de conduire pour les femmes, en juin. Elle est toujours en détention, sans avoir été inculpée. Depuis le début de la vague d’arrestations en mai 2018, les autorités saoudiennes s’en prennent également aux membres des familles des militants et des défenseurs des droits humains. Amal al-Harbi, mère de deux enfants et épouse du défenseur des droits humains Fawzan al-Harbi,, membre fondateur de l’ACPRA, a été arrêtée le 31 juillet. Elle est toujours en détention, sans avoir été inculpée et sans pouvoir bénéficier des services d’un avocat. Ahmad al-Zahrani et Abdelmajeed al-Zahrani, les frères du militant saoudien Omar Abdulaziz, qui vit au Canada, ont également été arrêtés début août. Ils auraient été interpelés en raison des activités de leur frère sur Internet et de son attitude ouvertement critique vis-à-vis des autorités saoudiennes. Omar Abdulaziz anime sur YouTube un programme satirique, dans lequel il s’en prend aux autorités de son pays d’origine. Les autorités singapouriennes doivent empêcher l'exécution imminente de Prabu N Pathmanathan, un Malaisien de 31 ans, et d'un autre homme dont le nom n'a pas été révélé, a déclaré Amnistie internationale le 24 octobre. Les deux prisonniers ont été condamnés à la peine de mort dans deux affaires distinctes pour des infractions liées aux stupéfiants.
Les proches de Prabu Pathmanathan ont été informés la semaine dernière du fait que son exécution a été fixée au 26 octobre. Il a été condamné automatiquement à la peine de mort pour avoir été trouvé en possession de diamorphine. Selon les informations reçues, un autre homme doit être exécuté ce vendredi, également pour des infractions liées aux stupéfiants. Les informations concernant ces deux exécutions prévues pour vendredi ont été reçues à la suite d'autres informations signalant qu'un autre homme a été exécuté le 24 octobre, et trois autres encore le 5 octobre, également pour des infractions liées aux stupéfiants. Le recours à la peine de mort et l'application de cette peine pour des infractions à la législation sur les stupéfiants bafouent le droit international et les normes internationales. « Les autorités singapouriennes doivent immédiatement faire le nécessaire pour empêcher la mise à mort de ces hommes, et mettre fin à cette impitoyable vague d'exécutions, a déclaré Rachel Chhoa-Howard, chargée de recherches sur Singapour à Amnistie internationale. « Il est grand temps que Singapour rétablisse un moratoire sur la peine de mort et suive l'exemple du gouvernement malaisien, qui a suspendu toutes les exécutions et annoncé son intention d'abolir le recours à ce châtiment cruel pour tous les crimes. « Le fait que la famille de Prabu Pathmanathan, en Malaisie, ait été informée de son exécution imminente alors même que leur gouvernement vient de décider de mettre un terme à cette ignoble pratique rend cette affaire encore plus désolante, a-t-elle ajouté. Ce châtiment cruel et irréversible n’a sa place dans aucune société, comme l’ont reconnu plus des deux tiers des pays du monde. » À la connaissance d'Amnistie internationale, six exécutions ont eu lieu à Singapour cette année, toutes pour des infractions liées aux stupéfiants. Les autorités singapouriennes ont procédé à huit exécutions en 2017, toujours pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, mais elles n'ont pas systématiquement rendu publiques les informations relatives à ces exécutions. Complément d’information Amnistie internationale s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances et sans aucune exception, indépendamment de la nature et des circonstances de l'infraction commise, de la situation du condamné, de sa culpabilité ou de son innocence, ou encore de la méthode utilisée pour procéder à l’exécution. La peine capitale bafoue le droit à la vie et constitue le châtiment le plus cruel, le plus inhumain et le plus dégradant qui soit. À l'heure actuelle, 106 pays ont aboli la peine capitale pour toutes les infractions, et 142 sont abolitionnistes en droit ou en pratique. En 2017, la peine de mort a été prononcée ou appliquée pour des infractions liées aux stupéfiants dans 15 pays, mais Amnistie internationale n'a enregistré de cas d'exécution de personnes condamnées pour de telles infractions que dans quatre pays : la Chine (où les chiffres relatifs à ce châtiment sont classés secret d'État), l'Iran, l'Arabie saoudite et Singapour.  Les violents coups portés à Asim Omar Hassan, militant étudiant de 24 ans, par des gardiens de la prison de Kober, doivent faire l’objet d’investigations indépendantes et approfondies en vue de traduire en justice les responsables présumés. D’après ses avocats, le 3 octobre, quelques jours seulement avant sa comparution au tribunal pour la première audience de son affaire qui fait l’objet d’un nouveau procès, Asim Omar Hassan a été frappé à maintes reprises avec des instruments contondants et fouetté sur la poitrine jusqu’à perdre connaissance. Il n’a pas été en mesure de se présenter au tribunal en raison de ses blessures, ce qui a conduit le juge à ordonner son hospitalisation. « Ce jeune homme a déjà beaucoup souffert entre les mains du système judiciaire soudanais soumis à l’influence du pouvoir politique. Il a été détenu depuis plus de deux ans, dans au moins trois centres différents, où il a été roué de coups et soumis à des actes de torture lors des interrogatoires », a déclaré Joan Nyanyuki, directrice du programme Afrique de l’Est, Corne de l’Afrique et Grands Lacs à Amnistie internationale. Asim Omar a été arrêté le 2 mai 2016 et accusé d’avoir tué un policier durant les manifestations organisées à l’Université de Khartoum le mois précédent. Il a plaidé non coupable mais a été déclaré coupable et condamné à mort le 24 septembre 2017. Asim Omar Hassan a été frappé à maintes reprises avec des instruments contondants et fouetté sur la poitrine jusqu’à perdre connaissance. Il n’a pas été en mesure de se présenter au tribunal en raison de ses blessures, ce qui a conduit le juge à ordonner son hospitalisation. Cependant, la Cour suprême du Soudan a infirmé la condamnation en appel, annulé la condamnation à mort et ordonné un nouveau procès pour divers motifs, notamment le fait que des témoins clés n’ont pas été autorisés à témoigner et que l’accusation a été vue lors d’une audience publique en train de souffler des réponses à ses témoins. « Les autorités soudanaises doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité d’Asim Omar et faire en sorte qu’il bénéficie d’un procès équitable, après l’annulation de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation à mort il y a quelques mois seulement. Il ne doit pas être soumis à d’autres actes de torture ni à d’autres mauvais traitements, actes de harcèlement ou d’intimidation, a déclaré Joan Nyanyuki. « Enfin, sa famille et ses avocats doivent être autorisés à communiquer avec lui sans restrictions afin de garantir que le second procès sera libre et équitable. » Action urgente - États-Unis (Tennessee). Un homme risque d'être exécuté sous peu, Edmund Zagorski.10/12/2018 Edmund Zagorski est incarcéré dans le couloir de la mort du Tennessee depuis plus de 30 ans alors que sa défense lors de son procès a, semble-t-il, été insuffisante. Il devait être exécuté le 11 octobre selon un nouveau protocole d’injection létale par administration de trois substances. Après des recours formés par ses avocats, le gouverneur de l’État a prononcé un sursis de 10 jours pour permettre la préparation de l’exécution.
Edmund Zagorski devait être exécuté le 11 octobre, selon le nouveau protocole d’injection létale par administration de trois substances adopté par les autorités du Tennessee, mais le gouverneur de cet État lui a accordé un sursis temporaire jusqu’au 21 octobre. Après cette date, Edmund Zagorski risque d’être exécuté dans un délai très court. Edmund Zagorski a été condamné en 1984 pour deux meurtres avec circonstances aggravantes. Lors de son premier procès, le parquet du Tennessee a présenté des éléments indiquant qu’il avait promis aux deux victimes de leur vendre de la marijuana, puis les avait abattues. Pendant la phase consacrée à la détermination de la peine, Edmund Zagorski a indiqué qu’il préférait être condamné à la peine de mort que de passer le reste de sa vie en prison. Il a affirmé que ses déclarations à la police avaient été obtenues sous la contrainte, les policiers l’ayant maintenu à l’isolement, privé de lumière du jour et exposé à des températures extrêmes pendant sa détention. Il a fait appel de sa condamnation, en faisant valoir que la police l’avait forcé à s’accuser des meurtres, qu’elle avait dissimulé des éléments de preuve et qu’il n’avait pas bénéficié d’une défense efficace. Ses avocats ont en outre souligné qu’Edmund Zagorski s’était vu refuser un examen de la proportionnalité, procédure prévue par la législation du Tennessee dans les affaires où l’accusé encourt la peine capitale, visant à déterminer si la peine est proportionnée par rapport à celles prononcées dans des affaires concernant des faits similaires. La cour suprême du Tennessee a estimé que sa condamnation à mort était proportionnée, mais dans chacune des trois affaires citées dans sa décision, les condamnations à mort ont été annulées et des peines de réclusion à perpétuité ont été prononcées. Les prisonniers concernés ont en outre ultérieurement bénéficié d’une libération conditionnelle dans les trois cas. DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais ou dans votre propre langue : - appelez les autorités à empêcher l’exécution d’Edmund Zagorski et à commuer sa condamnation à mort en peine de réclusion à perpétuité. ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 23 NOVEMBRE 2018 À : Gouverneur du Tennessee Governor Bill Haslam 600 Charlotte Avenue First Floor Nashville, Tennessee 37243 États-Unis Téléphone : +1 615-741-2001 Twitter : @BillHaslam Facebook : @TeamHaslam Formule d’appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur, Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays. Ambassadrice des États-Unis Ambassadrice Kelly Knight Craft Ambassade des États-Unis 490, chemin Sussex Ottawa, Ontario K1N 1G8, Canada Télécopieur : 613-688-3082 Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. COMPLÉMENT D’INFORMATION Edmund Zagorski a été reconnu coupable en 1984 des meurtres de John Dale Dotson et Jimmy Porter. Le parquet du Tennessee a présenté des éléments indiquant qu’il avait promis aux deux victimes de leur vendre de la marijuana, puis les avait abattues. En 1998, Edmund Zagorski a fait appel de sa condamnation devant la cour suprême du Tennessee, en affirmant que sa défense avait été inefficace car ses avocats n’avaient pas étudié ni présenté les circonstances atténuantes que constituaient ses traumatismes d’enfance et ses lésions cérébrales lors de la phase de détermination de la peine. En 2009, il a formé un nouveau recours arguant que l’accusation avait indûment dissimulé lors de son procès des éléments laissant penser qu’une autre personne avait tué John Dale Dotson et Jimmy Porter, et qu’elle avait admis à tort comme preuves des déclarations qu’il avait faites à la police. À l’issue de ces deux procédures, la juridiction d’appel a confirmé le verdict de culpabilité et la condamnation à mort d’Edmund Zagorski. Le maintien de prisonniers à l’isolement de manière prolongée constitue une violation de l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En juin 1983, Edmund Zagorski a été placé à l’isolement pendant sept semaines à la prison du comté de Robertson, dans une cellule entièrement en métal non climatisée, sans aération et à peine ventilée, où la température pouvait atteindre 38 °C en juillet. Ces conditions de détention semblent avoir contribué à une détérioration de sa santé mentale et physique comprenant une importante perte de poids et de multiples tentatives de suicide. Depuis le début de l’année 2018, 18 exécutions ont eu lieu aux États-Unis, ce qui porte à 1 483 le nombre de personnes exécutées dans ce pays depuis 1977. Amnistie internationale est opposée à la peine de mort en toutes circonstances. À l’heure actuelle, 142 pays sont abolitionnistes en droit ou en pratique.  17 personnes accusées d’avoir perpétré trois attentats à la bombe meurtriers contre des églises ainsi que des attaques contre les forces de sécurité en 2017 ont été condamnées à mort par un tribunal militaire d’Alexandrie le 11 octobre 2017. « Rien ne peut justifier les attentats, condamnables au plus haut point, qui ont visé les fidèles dans des églises coptes d’Égypte en 2017. Il ne fait aucun doute que les auteurs de ces actes doivent rendre des comptes. Mais prononcer une condamnation collective à la peine capitale à l’issue d’un procès militaire inique, ce n’est pas rendre justice, et cela ne permettra pas de prévenir d’autres attaques motivées par l’intolérance religieuse, a déclaré Najia Bounaim, directrice régionale adjointe du travail de campagne pour l’Afrique du Nord au sein d’Amnistie internationale. « L’Égypte a un lourd passif en ce qui concerne les procès illégaux de civils devant ses tribunaux militaires, tristement célèbres, et les condamnations prononcées contre des dizaines de personnes à l’issue de procès collectifs manifestement iniques, condamnations qui s’appuient souvent sur des “aveux” obtenus sous la torture. Les personnes accusées d’avoir pris part à ces crimes motivés par la haine doivent être rejugées par un tribunal civil, dans le cadre de procédures respectant le droit international relatif aux droits humains et les normes en matière d’équité des procès. » COMPLÉMENT D’INFORMATION Les procès militaires sont iniques parce que tout le personnel des tribunaux, des juges aux procureurs, sont des militaires en service actif, qui travaillent sous l’autorité du ministère de la Défense et n’ont pas la formation nécessaire concernant l’état de droit et les normes d’équité des procès. La peine de mort est le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Amnistie internationale y est opposée en toutes circonstances, sans exception, indépendamment des questions relatives à la culpabilité ou à l’innocence et quels que soient l’accusé, le crime commis et la méthode d’exécution.  Les personnes sous le coup d'une condamnation à mort doivent être traitées avec dignité et détenues dans des conditions conformes aux dispositions du droit international relatif aux droits humains et aux normes internationales en la matière, a déclaré Amnesty International à l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort (10 octobre). L'organisation lance une nouvelle campagne destinée à faire pression sur cinq pays (le Bélarus, le Ghana, l'Iran, le Japon et la Malaisie) pour qu'ils mettent fin aux conditions inhumaines de détention des prisonniers et prisonnières sous le coup d'une condamnation à mort et qu'ils prennent des mesures en vue de l'abolition totale de la peine de mort. « Quel que soit le crime commis, personne ne devrait subir des conditions de détention inhumaines. Pourtant, bien souvent, les condamnés à mort sont détenus à l'isolement strict, n'ont pas suffisamment accès aux médicaments dont ils ont besoin et vivent dans l’angoisse constante en raison de la menace de l'exécution », a déclaré Stephen Cockburn, directeur adjoint du programme Questions mondiales à Amnistie internationale. « Le fait que, dans certains cas, les détenus et leurs proches ne soient prévenus que quelques jours, voire quelques instants, avant l'exécution est cruel. « Tous les gouvernements qui appliquent toujours la peine de mort doivent l'abolir immédiatement et mettre fin aux conditions de détention effroyables auxquelles trop de personnes sous le coup d'une condamnation à mort sont soumises. » Bien qu'Amnistie internationale ait recueilli des informations sur les atteintes les plus épouvantables dans le monde entier, sa nouvelle campagne met en lumière les cas de personnes au Bélarus, au Ghana, en Iran, au Japon et en Malaisie, où la cruauté liée à la peine de mort est monnaie courante. Au Ghana, des détenus condamnés à mort ont déclaré que souvent, ils n'avaient pas accès aux médicaments nécessaires pour traiter des maladies et des pathologies de longue durée. Mohammad Reza Haddadi est dans le quartier des condamnés à mort en Iran depuis l'âge de 15 ans. Il a été soumis à la torture psychologique de voir son exécution programmée puis repoussée au moins six fois ces 14 dernières années. Matsumoto Kenji, emprisonné au Japon, a développé un trouble délirant qui est très probablement le résultat de sa détention à l'isolement prolongée dans l'attente de son exécution. Hoo Yew Wah, détenu en Malaisie, a déposé un recours en grâce en 2014, mais attend toujours une réponse. Au Bélarus, la peine de mort fait l'objet d'un secret strict : les conditions d’exécution ne sont pas révélées au public et les exécutions sont menées sans que les détenus, leur famille ou leurs avocats n’en soient préalablement informés. Amnistie internationale s’oppose en toutes circonstances et sans aucune exception à la peine de mort, indépendamment de la nature et des circonstances du crime commis, de la situation du condamné, de sa culpabilité ou de son innocence, ou encore de la méthode utilisée pour procéder à l’exécution. La peine capitale viole le droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il s’agit du châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Amnistie internationale a recensé 993 exécutions dans 23 pays en 2017, soit une diminution de 4 % par rapport à 2016 et de 39 % par rapport à 2015. La plupart des exécutions ont eu lieu en Iran, en Arabie saoudite, en Irak et au Pakistan. Ces totaux ne comprennent pas les milliers d’exécutions qui ont eu lieu en Chine, où les données relatives à la peine de mort sont toujours classées secret d’État.  Le gouvernement malaisien a annoncé le 10 octobre qu’il prévoit d’abolir la peine de mort pour tous les crimes. « Cette annonce est une avancée majeure pour tous ceux qui militent en faveur de l’abolition de la peine capitale en Malaisie. La Malaisie doit maintenant rejoindre les 106 pays qui ont tourné le dos définitivement à ce châtiment des plus cruels, inhumains et dégradants – le monde la regarde, a déclaré Kumi Naidoo, secrétaire général d’Amnistie internationale. « Le recours de la Malaisie à la peine de mort a pendant des années entaché son bilan en termes de droits humains. Les condamnés à mort sont bien souvent maintenus dans une cruelle incertitude quant à l’issue de leurs demandes de grâce et informés de leur exécution quelques jours voire quelques heures avant qu’elle n’ait lieu. « Le nouveau gouvernement a promis de respecter les droits humains et l’annonce de ce jour est un signe encourageant. Toutefois, il reste beaucoup à faire. Un projet de loi sur l’abolition doit être débattu la semaine prochaine et nous demandons au Parlement de Malaisie d’abolir totalement la peine de mort pour tous les crimes, sans aucune exception. Il n’y a pas de temps à perdre – la peine de mort aurait dû être reléguée dans les livres d’histoire depuis bien longtemps. » COMPLÉMENT D’INFORMATION Le 10 octobre, le ministre du Droit au sein du bureau du Premier ministre, Datuk Liew Vui Keong, a annoncé que le conseil des ministres a décidé d’abolir la peine capitale pour tous les crimes. Un projet de loi en ce sens devrait être débattu lors de la prochaine session parlementaire, qui débute le 15 octobre. En juillet 2018, la Malaisie avait annoncé un moratoire sur les exécutions. Amnistie internationale exprime son opposition inconditionnelle à la peine de mort et milite en faveur de son abolition depuis plus de 40 ans. À ce jour, 142 pays ont aboli la peine capitale en droit ou dans la pratique. Le 10 octobre est la Journée mondiale contre la peine de mort. Amnistie internationale met en lumière le cas emblématique de Hoo Yew Wah, ressortissant malaisien. Condamné à mort à un jeune âge pour trafic de stupéfiants, il demande à avoir une deuxième chance. Bien que les autorités aient suspendu l’application des exécutions, Hoo Yew Wah ne sait toujours pas si sa demande de grâce déposée en 2014 a été acceptée. Il a été automatiquement condamné à mort en mai 2011, après avoir été contraint de signer une déclaration où il s’accusait lui-même.  Partout dans le monde, des personnes sous le coup d’une condamnation à mort sont soumises aux conditions de détention les plus cruelles qui soient. Bien souvent, ces personnes sont détenues à l'isolement strict, n'ont pas suffisamment accès aux médicaments nécessaires et vivent dans l’angoisse constante en raison de la menace de l'exécution. Certains gouvernements n’informent les détenus et leurs proches que quelques jours, voire même quelques instants, avant l’exécution. Amnistie internationale a recueilli des informations sur des atteintes épouvantables dans le monde entier. À l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, l’organisation lance une campagne pour mettre en lumière des cas au Bélarus, au Ghana, en Iran, au Japon et en Malaisie, où la cruauté de la peine de mort est monnaie courante. La détention à l'isolement, avec ou sans moyens de contrainte, est une pratique commune pour les personnes condamnées à mort. Dans le cas de Kenji Matsumoto, un détenu condamné à mort au Japon, c’est probablement ce châtiment particulièrement inhumain qui a déclenché le trouble délirant à cause duquel il serait devenu paranoïaque et incohérent. Kenji Matsumoto est dans le quartier des condamnés à mort depuis 1993. Il souffre depuis longtemps d’un handicap mental dû à un empoisonnement au mercure et d’un faible QI situé entre 60 et 70, d’après le diagnostic d’un psychiatre. Pourtant, les autorités judiciaires ont jugé qu’il avait les facultés mentales nécessaires pour être condamné à mort et que ses « aveux » étaient fiables, bien que son avocat ait affirmé que Kenji Matsumoto avait été soumis à des pressions par la police. Mohammad Reza Haddadi, un Iranien, a passé toute sa vie de jeune adulte dans le quartier des condamnés à mort, après avoir été déclaré coupable d’homicide à l’issue d’un procès d’une iniquité flagrante et condamné à mort à l’âge de 15 ans. Il est l’une des 84 autres personnes condamnées à mort en Iran pour des crimes commis alors qu’elles avaient moins de 18 ans. Non seulement sa condamnation constitue une violation du droit international relatif aux droits humains, mais en plus, Mohammad Reza a été soumis à la torture psychologique de voir son exécution programmée et repoussée six fois ces 14 dernières années. La dernière fois que son exécution a été programmée, le 31 mai 2016, Mohammad Rezaavait bénéficié d’un sursis de dernière minute grâce au tollé général provoqué par l’annonce de son exécution imminente. En raison du manque de transparence en ce qui concerne le recours à la peine de mort en Malaisie, les détenus condamnés à mort tels que Hoo Yew Wah ne sont pas informés des possibilités de déposer un recours en grâce. Hoo Yew Wah a été condamné automatiquement à la peine de mort en mai 2011, à l’issue de procédures judiciaires iniques. En mars 2005, alors qu'il avait 20 ans, il a été trouvé en possession de 188,35 g de méthamphétamine. Il a été automatiquement soupçonné de trafic de stupéfiants, puis déclaré coupable et condamné à la pendaison. Il attend toujours une réponse à son recours grâce déposé en avril 2014 auprès du sultan de l'État de Johor. Hoo Yew Wah aura 33 ans en décembre et a déclaré : « si j’en ai l’occasion, je veux prouver que j’ai changé. » Au Bélarus, le recours à la peine de mort est entouré de secret. Les exécutions sont cachées au public et sont menées sans que les condamnés à mort, leurs proches ou leurs avocats n’en soient prévenus à l’avance. Un ancien directeur du Centre de détention provisoire N° 1 de Minsk (la prison où sont détenus tous les condamnés à mort au Bélarus) a déclaré à Amnistie internationale que le prisonnier est, dans un premier temps, conduit dans une pièce où on lui annonce en présence de représentants de l’État que sa demande de grâce a été rejetée et que sa peine va être appliquée. Il est ensuite mené dans une pièce adjacente où on lui met un bandeau sur les yeux et des menottes aux poignets. On le contraint à s’agenouiller avant de lui tirer une balle dans l’arrière de la tête. Conformément à la législation en vigueur, les autorités bélarussiennes refusent de remettre le corps des personnes exécutées à leurs proches, ou de dévoiler où elles sont enterrées. Il s’agit là d’un héritage de l’époque soviétique. Les conditions de détention des prisonniers condamnés à mort sont également rudes au Ghana. Lorsqu’Amnistie internationale s’est rendue à la prison de Nsawam en 2016, les détenus sous le coup d’une condamnation à mort ne pouvaient pas participer à des activités éducatives et récréatives, ce qui entraînait un sentiment d’isolation provoquant des souffrances et de l’anxiété. Des détenus condamnés à mort ont déclaré à Amnistie internationale que les soins médicaux étaient limités. Ils ont indiqué qu’ils avaient des difficultés à obtenir les médicaments nécessaires pour soigner les maladies ou pathologies de longue durée, car ils n’étaient parfois pas disponibles ou bien étaient trop chers pour les détenus. Un prisonnier condamné à mort a fait part de la peur qu’il a ressentie lorsqu’il est tombé malade : « Lorsqu’on est malade la nuit et que le gardien ne vient pas nous aider, on peut mourir. » Que ce soit au Bélarus, au Ghana, en Iran, au Japon ou en Malaisie, les gouvernements des pays où des personnes sont condamnées à mort doivent veiller à ce qu’elles soient traitées avec humanité et dignité et à ce qu’elles soient détenues dans des conditions conformes aux dispositions du droit international relatif aux droits humains et aux normes en la matière. Il est temps que les États qui appliquent toujours la peine de mort l'abolissent et mettent fin aux conditions de détention lamentables auxquelles trop de personnes sous le coup d'une condamnation à mort sont soumises. La peine capitale viole le droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il s’agit du châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. *Du 5 octobre au mois de novembre, des militant-e-s du monde entier feront campagne en faveur de Hoo Yew Wah, de Kenji Matsumoto, de Mohammad Reza Haddadi et des personnes sous le coup d’une condamnation à mort au Bélarus et au Ghana. 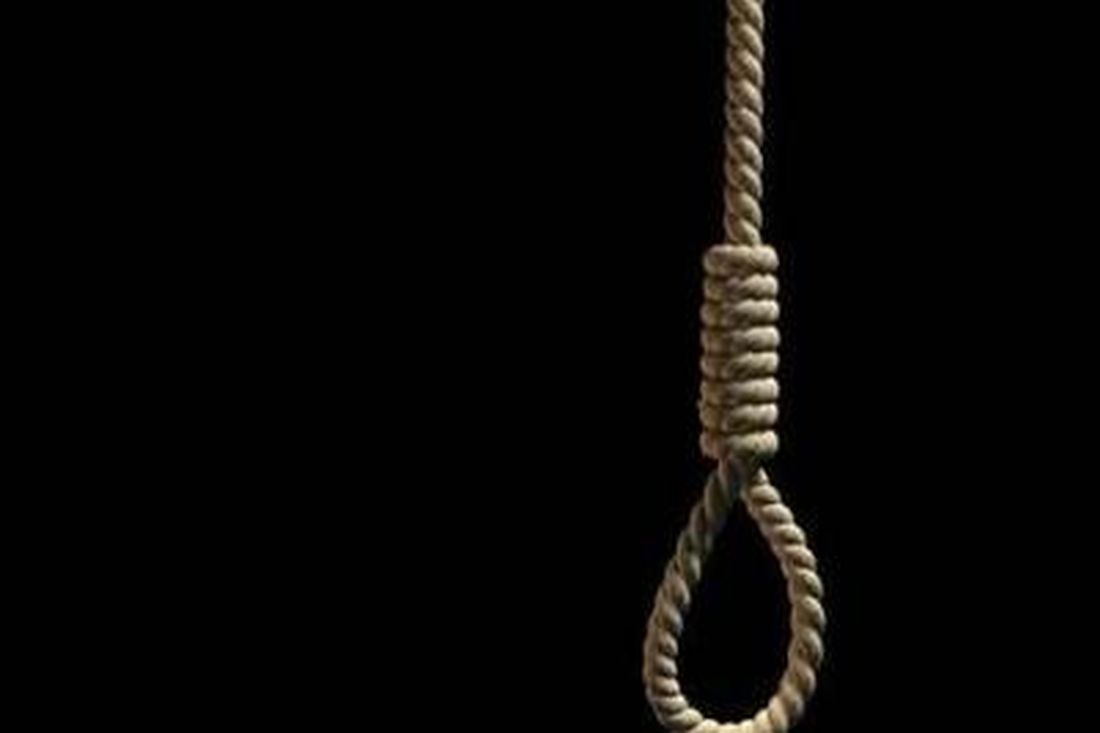 « Enfant mariée. » « Criminelle. » « Mineure Délinquante. » Voilà quelques-unes des nombreuses manières de décrire Zeinab Sekaanvand au cours de sa vie trop brève. Zeinab Sekaanvand, qui a été exécutée mardi 2 octobre à la prison d’Orumiyeh, dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan occidental, a rarement été considérée comme la personne qu’elle était réellement : une jeune femme vulnérable prise au piège d’un cycle de violence et d’abus sexuels dès son enfance. La jeune femme, qui avait 24 ans quand elle a été pendue, avait passé près d’un tiers de sa vie en détention. En février 2012, elle a été arrêtée et jugée pour le meurtre de son mari, qui avait eu lieu quand elle avait 17 ans. Elle a signalé avoir été violée par son beau-frère et torturée par des policiers après son arrestation. Le plus dérangeant dans le cas de Zeinab Sekaanvand est le nombre de fois où les autorités iraniennes auraient pu intervenir pour l’aider. Zeinab Sekaanvand a parlé des abus qu’elle subissait. Elle s’est exprimée, et les autorités ont fait la sourde oreille. Ce scénario est bien trop familier pour de nombreuses femmes et filles. Mais parce que Zeinab Sekaanvand vivait en Iran, son histoire a pris un tour particulièrement sombre. Elle est loin d’être la seule en Iran, l’un des derniers pays du monde à continuer de procéder à l’exécution de « mineurs délinquants ». Au moins 88 personnes qui étaient mineures au moment des faits qu’on leur reproche se trouvent actuellement dans le quartier des condamnés à mort ; certaines y languissent depuis plus de 10 ans. Le cas de Zeinab rappelle en particulier celui de Fatemeh Salbehi, exécutée en 2015 à l’âge de 23 ans pour le meurtre de son mari, qu’elle avait été forcée à épouser quand elle avait 16 ans. En regardant de près, l’affaire Sekaanvand illustre à quel point tout joue contre les femmes quand elles ont affaire à la justice iranienne Née dans le nord-ouest du pays dans une famille kurde d’Iran pauvre et conservatrice, Zeinab Sekaanvand avait 15 ans lorsqu'elle a fui son foyer pour épouser un homme nommé Hossein Sarmadi. Elle a déclaré qu'elle considérait ce mariage comme sa seule chance d'avoir une vie meilleure. Son mari était toutefois un homme violent et leur relation a vite été marquée par les agressions physiques et verbales. Zeinab Sekaanvand a demandé le divorce plus d’une fois mais son mari a refusé. En Iran, les discriminations profondément enracinées au sein du système de justice vis-à-vis des femmes et des filles empêchent souvent celles-ci d’obtenir un divorce, même si elles sont victimes de violence domestique. Si Zeinab Sekaanvand a porté plainte à plusieurs reprises auprès de la police en raison du comportement violent de son mari, les fonctionnaires ont ignoré de manière répétée ses appels à l’aide et se sont abstenus d’ouvrir une enquête sur cet homme. Aux abois, la jeune femme a essayé de retourner chez ses parents, mais ils l’avaient reniée après qu’elle se fut enfuie. Elle a déclaré que le frère d’Hossein la violait régulièrement pendant tout ce temps. Encore mineure, elle se trouvait sous le contrôle de deux hommes violents et abusifs, sans personne pour l’aider. En février 2012, Zeinab Sekaanvand a été arrêtée pour le meurtre de son mari. Elle n’a pas pu bénéficier des services d’un avocat et a déclaré qu’elle avait été torturée et frappée par des policiers durant son interrogatoire. C’est dans ces circonstances qu’elle a « avoué » avoir poignardé son époux. C’est seulement lors de sa dernière audience, trois ans après son arrestation, que les autorités lui ont fourni un avocat. Elle est alors revenue sur ses « aveux », en déclarant au juge que c'était le frère de son époux, un homme qui l'aurait violée, qui avait commis le meurtre. Zeinab Sekaanvand a déclaré durant son procès que son beau-frère lui avait dit que si elle assumait la responsabilité de ce crime, il lui offrirait son pardon. En vertu du droit iranien, les parents d'une victime de meurtre ont le pouvoir de pardonner le/la coupable et d'accepter une indemnisation financière à la place. Mais au lieu de demander un complément d’enquête, les autorités n’ont pas retenu la déclaration de Zeinab Sekaanvand, la déclarant coupable et la condamnant à mort par pendaison. Ce n’était pas la fin des difficultés de Zeinab Sekaanvand. En 2015, à la prison d’d’Orumiyeh, elle est tombée enceinte après avoir épousé un prisonnier. Son enfant est mort-né en septembre 2015. Les médecins ont déclaré que son bébé était mort in-utero deux jours plus tôt à cause d'un choc, ce qui correspond environ à la date de l'exécution de sa codétenue et amie la plus proche. Les autorités ont forcé Zeinab Sekaanvand à retourner en prison le lendemain de son accouchement et ne lui ont proposé aucun soin postnatal ni soutien psychosocial. Avant son exécution, les autorités ont soumis la jeune femme à un test de grossesse. Le test étant négatif, elles n’ont pas hésité à l’exécuter. La vie de Zeinab Sekaanvand a été définie par un système juridique qui défavorise les femmes de manière éhontée. Un système qui fixe l’âge minimum de responsabilité pénale à neuf ans pour les filles et 15 ans pour les garçons - et l’âge minimum pour se marier à 13 ans pour les filles. Il n’érige pas en infraction le viol d’une femme par son époux. Il impose avec violence la pratique abusive, discriminatoire et dégradante du port forcé du hijab aux femmes et jeunes filles, et envoie en prison les personnes qui se mobilisent contre cela. Il s’agit d’un système où le témoignage d’une femme compte moins que celui d’un homme. C’est pourquoi pas une seule personne d’importance n’a écouté l’histoire de Zeinab Sekaanvand. Les personnes qui comptent ont plutôt choisi d’y mettre un terme. Cet article a été initialement publié par TIME |
Centre de presseLe centre de presse du Secrétariat international met à la disposition des professionnels et du grand public des nouvelles de dernière minute, des commentaires de spécialistes et des informations importantes sur la situation dans le monde relative à la peine de mort. Archives
Janvier 2023
Catégories
Tous
|
Amnistie internationale Canada francophone - Abolition de la peine de mort - Tél. : 819-944-5157
Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca
Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca

 Flux RSS
Flux RSS
