 Le géant pétrolier Shell est accusé de complicité dans l’arrestation, la détention et l’exécution illégales de neuf hommes, pendus par le régime militaire nigérian dans les années 1990, est en mesure de révéler Amnistie internationale ce jeudi 29 juin 2017, la multinationale se retrouvant, aux Pays-Bas, au cœur d’une nouvelle affaire explosive concernant quatre de ces exécutions. Esther Kiobel, veuve de Barinem Kiobel, et trois autres femmes se sont portées parties civiles. Cela fait 20 ans qu’Esther Kiobel livre bataille contre Shell au sujet de la mort de son mari. Celui-ci a été pendu en 1995, aux côtés de l’écrivain et défenseur des droits humains Ken Saro-Wiwa et de sept autres hommes ; ils ont été surnommés les « neuf Ogonis ». À l’époque, ces exécutions ont déclenché un tollé au sein de la communauté internationale. Esther Kiobel accuse Shell de complicité dans l’arrestation et la détention illégales de son mari et de violation de l’intégrité physique, du droit à un procès équitable et du droit à la vie de cet homme, ainsi que de son propre droit à une vie de famille. Amnistie internationale a aidé l’équipe juridique d’Esther à porter l’affaire devant la justice néerlandaise et a publié un nouveau document de synthèse (en anglais) intitulé In The Dock, qui décrit en détail le rôle de Shell dans les exécutions. « Les exécutions des neuf Ogonis ont choqué le monde entier. Shell a fui ses responsabilités dans cette affaire pendant plus de 20 ans mais désormais, grâce à la détermination et au courage d’Esther Kiobel face à ce géant, l’entreprise est enfin rattrapée par son passé, a déclaré Audrey Gaughran, directrice générale chargée des recherches à Amnistie internationale. « Cette journée marque un tournant dans le dur combat d’Esther Kiobel pour la justice. Shell a marqué tout le pays ogoni d’une empreinte sanglante et doit répondre de ses actes. » Une campagne brutale Les exécutions ont été le point culminant d’une campagne brutale menée par l’armée nigériane en vue d’étouffer les protestations du Mouvement pour la survie du peuple ogoni (MOSOP), dirigé par Ken Saro-Wiwa. Le MOSOP affirmait que des tiers s’étaient enrichis grâce au pétrole extrait sur les terres des Ogonis et que la pollution due aux déversements et aux torchères avait provoqué une dégradation complète de l’environnement, à l’origine d’une catastrophe écologique. En janvier 1993, il a déclaré que l’entreprise Shell n’était plus la bienvenue en pays ogoni. Les autorités militaires ont réagi avec force aux actions du MOSOP et ont commis, dans ce contexte, beaucoup de graves violations des droits humains, notamment des homicides, des actes de torture et des viols. La préoccupation principale de Shell et de l’État nigérian, qui exploitaient les puits du delta du Niger dans le cadre d’un partenariat, était de faire cesser les manifestations. Au moment des exécutions, Shell était de loin la plus grande entreprise implantée au Nigeria. Elle extrayait près d’un million de barils de pétrole brut par jour, soit environ la moitié de la production nationale. Les exportations d’hydrocarbures représentaient jusqu’à 96 % des recettes de source étrangère enregistrées par le pays. « Shell a encouragé l’État à stopper Ken Saro-Wiwa et le MOSOP, sachant qu’ils seraient, de ce fait, très probablement victimes de violations des droits humains. L’entreprise disposait de nombreux éléments indiquant que l’armée nigériane réprimait avec violence les manifestations organisées en pays ogoni », a déclaré Audrey Gaughran. Quelques semaines seulement avant les arrestations, le président de Shell Nigeria avait rencontré le président de l’époque, le général Sani Abacha, et soulevé ce qu’il appelait le « problème des Ogonis et de Ken Saro-Wiwa ». Ce n’était pas la première fois que l’entreprise exhortait l’armée et les forces de sécurité à endiguer les manifestations des Ogonis, qu’il considérait comme un problème. En outre, elle n’a cessé de rappeler aux autorités les répercussions économiques des rassemblements du MOSOP. « Shell a fait preuve d’irresponsabilité en soutenant que Ken Saro-Wiwa et le MOSOP constituaient un problème car cela n’a fait qu’accroître les risques encourus par cet homme et les autres personnes liées au mouvement. L’entreprise savait pertinemment que l’État bafouait régulièrement les droits de ces personnes et qu’il avait pris pour cible Ken Saro-Wiwa. « Même lorsque les [neuf Ogonis] ont été emprisonnés, soumis à des mauvais traitements et à un procès inique, et confrontés à la perspective d’une exécution, Shell a continué à discuter de la résolution du “problème ogoni” avec les autorités plutôt que de faire part de ses inquiétudes quant au sort des détenus. Une telle conduite ne peut être perçue que comme une approbation et un encouragement à l’égard des agissements du régime militaire. » Une injustice lourde de conséquences Esther Kiobel, Victoria Bera, Blessing Eawo et Charity Levula, dont les maris ont tous été exécutés dans le cadre de la même affaire, intentent un procès au civil. Elles réclament des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes illégaux de Shell et des excuses publiques au sujet du rôle de l’entreprise dans les événements ayant conduit à la mort de leurs maris. En mai 1994, quatre chefs ogonis connus pour être des opposants au MOSOP ont été tués. Sans produire aucun élément, les autorités ont imputé ces homicides au MOSOP et arrêté des dizaines de personnes, dont Ken Saro-Wiwa et Barinem Kiobel. Ce dernier n’était pas membre du MOSOP mais occupait un poste de haut fonctionnaire et critiquait les agissements de l’armée en pays ogoni. Il a affirmé avoir tenté d’empêcher les meurtres – une version des faits étayée par les éléments présentés au procès. Amnistie internationale considérait Ken Saro-Wiwa et Barinem Kiobel comme des prisonniers d’opinion, détenus puis tués en raison de leurs opinions pourtant pacifiques. Après les arrestations, au moins deux témoins de l’accusation ont affirmé d’eux-mêmes que l’État les avait soudoyés pour incriminer les accusés, leur proposant notamment des emplois chez Shell, en présence de l’avocat de l’entreprise. La compagnie pétrolière a toujours nié ces allégations. Nombre des hommes ogonis arrêtés en raison de leur implication présumée dans le meurtre des quatre chefs ont été régulièrement victimes d’actes de torture et d’autres mauvais traitements en détention. Même après le début du procès, l’officier responsable de l’incarcération n’a autorisé les accusés à consulter leurs avocats qu’avec son accord préalable et généralement en sa présence. Des proches ont affirmé avoir été agressés par des militaires au moment des visites. Ainsi, Esther Kiobel a déclaré qu’elle avait été agressée par un officier à l’une de ces occasions et avait passé deux semaines en détention, privée d’eau et de nourriture. Les 30 et 31 octobre 1995, les neuf Ogonis ont été déclarés coupables et condamnés à mort. À l’époque, Amnistie internationale et d’autres organisations ont émis de sérieux doutes quant au procès, qu’elles estimaient biaisé et sous-tendu par des considérations politiques. Selon un avocat pénaliste britannique, présent en tant qu’observateur, le tribunal avait déjà pris sa décision avant même de chercher des arguments,ne reculant devant rien pour se justifier a posteriori. En outre, les éléments factuels corroboraient les allégations selon lesquelles Barinem Kiobel avait tenté de stopper les violences. Le 10 novembre, les condamnés ont été pendus et leurs corps, jetés dans une fosse commune. « Esther Kiobel vit avec cette injustice depuis plus de 20 ans mais elle refuse de laisser Shell la réduire au silence. Aujourd’hui, elle fait entendre sa voix pour toutes les personnes dont la vie a été détruite par l’industrie pétrolière au Nigeria, a déclaré Channa Samkalden, son avocate. « L’enjeu est on ne peut plus important : il s’agit de mettre un terme aux décennies d’impunité de Shell, dont le nom évoque la puissance des grands groupes, qui peuvent fouler aux pieds les droits humains sans craindre de sanction. » Une relation dangereuse Selon des documents internes de Shell qu’Amnistie internationale a pu se procurer, l’entreprise savait que le procès des neuf Ogonis était inique et avait été informée à l’avance que Ken Saro-Wiwa serait très probablement déclaré coupable. Malgré cela, elle a maintenu des liens étroits avec l’État nigérian et a même proposé d’aider l’écrivain s’il revoyait sa position à son égard. Shell a contacté le frère de Ken Saro-Wiwa en août 1995, pendant que ce dernier était détenu par l’armée. Selon lui, la compagnie pétrolière a proposé de faciliter la libération de son frère mais elle affirme, quant à elle, n’avoir offert qu’une aide humanitaire ou médicale. « La version de Shell suggère que l’entreprise pensait que Ken Saro-Wiwa – arrêté, battu, contraint à répondre de charges controuvées et soumis à un procès inique organisé en vue de sa condamnation à mort – serait disposé à coopérer en échange d’un peu d’aide humanitaire, a déclaré Audrey Gaughran. « Elle est franchement improbable. Si toutefois elle est véridique, elle révèle que Shell défendait ses intérêts à un point qui dépasse l’entendement. » Ken Saro-Wiwa a rejeté la proposition. Après la mort de son mari, Esther Kiobel, craignant pour sa vie, s’est réfugiée au Bénin et, en 1998, elle a obtenu l’asile aux États-Unis, où elle réside toujours. « Les liaisons dangereuses entre Shell et l’État nigérian n’ont jamais fait l’objet d’une enquête digne de ce nom. Plusieurs décennies après les terribles événements qui ont conduit à la pendaison des neuf Ogonis, des questions importantes concernant Shell demeurent sans réponse, a déclaré Audrey Gaughran. « Il est temps de faire la lumière sur ces zones d’ombre. Rien ne ramènera ceux qui ont perdu la vie mais il reste la possibilité de transmettre un message, à savoir qu’aucune entreprise, aussi grande et puissante soit-elle, ne peut échapper définitivement à la justice. » Amnistie internationale a fait part des allégations susmentionnées à Shell. Le siège mondial n’a pas répondu sur le fond et Shell Nigeria a déclaré : « Les allégations contre [Shell] qui sont citées dans votre lettre sont fausses et sans fondement.[L’entreprise Shell Nigeria] ne s’est pas entendue avec les autorités militaires pour réprimer des troubles communautaires et n’a aucunement encouragé ni prôné un quelconque acte de violence au Nigeria [...]. Nous avons toujours nié ces allégations avec la plus grande fermeté. » Complément d’information Esther Kiobel a intenté un premier procès à Shell en 2002 à New York mais, en 2013, la Cour suprême a statué que les États-Unis n’étaient pas compétents en l’espèce, sans examiner l’affaire sur le fond. Dans les années 1990, Shell Nigeria était une filiale appartenant en propre à Royal Dutch/Shell (les deux entreprises ont fusionné par la suite) et dirigée par un conseil d’administration basé en Europe. Pour en savoir plus :
0 Commentaires
 Depuis son arrivée à la présidence des Philippines il y a un an, Rodrigo Duterte et son administration ont présidé à toute une série de violations des droits humains, intimidé et emprisonné des personnes critiques à leur égard et créé un climat de non-respect des lois, a déclaré Amnistie internationale le jeudi 29 juin. Tirant parti de sa position au plus haut niveau de l’État, Rodrigo Duterte a explicitement approuvé la violence qui, dans le cadre de la campagne gouvernementale de lutte contre la drogue, a conduit à des milliers d'exécutions extrajudiciaires, soit davantage que le nombre de personnes tuées sous le régime meurtrier de Ferdinand Marcos, de 1972 à 1981. « Rodrigo Duterte est arrivé au pouvoir en promettant de débarrasser les Philippines de la criminalité. Au lieu de cela, des gens ont été tués par milliers par des policiers– ou à l’instigation de policiers – qui agissent en dehors du cadre de la loi, sur les ordres d'un président qui n'a montré que mépris pour les droits humains et pour les personnes qui les défendent, a déclaré James Gomez, directeur d'Amnistie internationale pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. « La campagne violente de Rodrigo Duterte n'a pas mis fin à la criminalité, ni résolu les problèmes liés aux drogues. En revanche, elle a fait du pays un lieu plus dangereux encore, porté un nouveau coup à l’état de droit et valu à Rodrigo Duterte une triste notoriété de dirigeant responsable de la mort de milliers de ses propres citoyens ». En février, Amnistie internationale a publié une enquête accablante, qui montrait comment la police en est venue à ressembler à une organisation criminelle, tuant – ou payant d'autres personnes pour tuer – principalement des personnes pauvres soupçonnées de consommation et de vente de drogue, tout en volant les biens des victimes, plaçant de fausses preuves et échappant à toute obligation de rendre des comptes. L'organisation de défense des droits humains a relevé avec inquiétude qu’il n'y avait pas eu d'enquête en bonne et due forme sur ces exécutions extrajudiciaires généralisées, qui peuvent s’apparenter à des crimes contre l'humanité. En réponse au rapport d'Amnistie internationale, le ministre de la Justice des Philippines a affirmé froidement que les personnes tuées ne faisaient pas partie de l'humanité. En mai, lorsque le bilan des Philippines en matière de droits humains a été examiné dans le cadre de l'Examen périodique universel (EPU) sous les auspices du Conseil des droits de l'homme [ONU], plus de 40 États ont exprimé des inquiétudes au sujet de la vague d'exécutions extrajudiciaires et du projet gouvernemental de rétablissement de la peine de mort pour les infractions liées à la drogue – qui constituerait une violation des obligations incombant aux Philippines en vertu du droit international. Amnistie internationale appelle le gouvernement à inviter le Rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires à effectuer une visite officielle dans le pays, et engage le Conseil des droits de l'homme à diligenter une enquête des Nations unies sur la « guerre contre la drogue ». Une guerre contre les pauvres La « guerre contre la drogue » de Rodrigo Duterte a affecté en très grande majorité les habitants des quartiers les plus pauvres. Dans les bidonvilles des agglomérations philippines, les cadavres ensanglantés sont purement et simplement abandonnés dans la rue, parfois avec une pancarte infamante portant la mention « pusher »(« trafiquant »), comme si leurs actes avaient rendu leur destin inévitable. La police perçoit des dessous-de-table pour commettre les meurtres, opérant à partir de listes de noms établies par les autorités locales. Elle recrute également des tueurs à gages pour exécuter ses basses œuvres. Au lieu de soumettre la police à l’obligation de rendre compte de ses actes, Rodrigo Duterte a promis de la protéger, affirmant récemment qu'il ne permettrait qu’aucun soldat ou policier soit envoyé en prison pour avoir « détruit l'industrie de la drogue ». Dans une affaire très médiatisée concernant Rolando Espinosa Sr., maire de la ville d'Albuera, et son compagnon de cellule, abattus en garde à vue, les charges de meurtre pesant sur la police ont été requalifiées en homicide – ne reflétant plus la gravité des faits. « Le gouvernement Duterte s’est opposé à l’obligation de rendre des comptes à toutes les étapes. Les autorités n’ont pas mené d’enquête en bonne et due forme et il n'y a pas eu de coopération avec le Rapporteur spécial des Nations unies. Le procureur de la Cour pénale internationale peut ordonner une enquête préliminaire sur ces exécutions de masse. Compte tenu de l'impunité généralisée, c'est peut-être la meilleure option », a déclaré James Gomez. Peine de mort Le mépris du gouvernement Duterte pour le droit international relatif aux droits humains est particulièrement manifeste au vu de sa tentative de rétablir la peine de mort pour les infractions liées à la drogue. Ce serait une décision illégale, les Philippines étant parties au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Exécuter des personnes pour des infractions liées à la drogue constitue également une violation du droit international. « Au cours d'une année où les Philippines président l'ASEAN et devraient encourager d'autres États membres à se débarrasser de ce châtiment cruel et irréversible, Rodrigo Duterte entraîne la région dans la mauvaise direction, avec de graves conséquences pour des vies humaines. Le Sénat philippin doit rejeter cette initiative, qui constitue une régression pour le pays, et abandonner une fois pour toutes le projet de loi sur la peine de mort », a déclaré James Gomez. Menaces visant les défenseurs des droits humains Le président Duterte a également menacé, l’année dernière, de « tuer » les militants des droits humains et, dans une déclaration faite au Palais présidentiel en mai 2017, de « décapiter » les défenseurs des droits humains qui critiquaient le bilan du pays. Sa principale opposante, la sénatrice Leila de Lima, est derrière les barreaux, sous la garde de la police. « Il est à craindre que le non-respect des lois ne se répande dans le pays. Lorsque les droits humains et l’état de droit sont mis de côté, la police devient corrompue et s’enhardit, et les gens ordinaires en pâtissent. Les forces de sécurité sont tenues de respecter le droit international et les normes internationales. Quand elles s’en abstiennent, rien ne les différencie des personnes qu’elles sont censées affronter », a déclaré James Gomez. Loi martiale La campagne meurtrière de lutte contre la drogue menée par le gouvernement l'a également détourné d'autres problèmes dans le pays. Le 23 mai 2017, Rodrigo Duterte a déclaré la loi martiale sur l'île méridionale de Mindanao pour une période de 60 jours, les forces de sécurité ayant été surprises par des groupes armés qui se sont emparés de la ville de Marawi. En vertu du droit international, les mesures d'urgence doivent avoir une portée et une durée limitées, et ne peuvent servir de prétexte pour négliger les droits humains. Action urgente - Arabie saoudite. Said Mabhoukt al Saiari, un homme risque d'être exécuté sous peu.6/29/2017 Le saoudien Said Mabkhout al Saiari risque d’être exécuté sous peu. Condamné à mort à l’issue d’un procès inique, il a épuisé toutes ses voies de recours et pourrait être exécuté à tout moment dès le 2 juillet.
Said Mabkhout al Saiari (29 ans), a été condamné à mort le 25 décembre 2013 par le tribunal général de Najran (sud-ouest de l’Arabie saoudite) pour l’homicide d’un autre Saoudien lors d’une bagarre entre des membres de deux tribus, qui a éclaté le 2 juillet 2009. Amnistie internationale a appris qu’il pourrait être exécuté à tout moment dès le 2 juillet, soit peu après le Ramadan et la fête de l’Aïd el Fitr qui en marque la fin. Said al Saiari a toujours clamé son innocence et, selon le jugement de 86 pages, le tribunal général de Najran, bien qu’estimant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments à charge, l’a condamné à mort. Le tribunal s’est fié aux 50 déclarations sous serment du père de la victime, qui était persuadé que l’accusé était responsable de l’homicide de son fils. Cette pratique consiste à exprimer 50 fois la conviction que l’accusé est l’auteur et les déclarations qui en découlent sont considérées comme des éléments recevables, bien que dans le cas présent le père de la victime n’ait pas assisté au crime. Said al Saiari n’a pas pu consulter d’avocat pendant toute la durée de l’enquête. Après son placement en détention, le 2 juillet 2009, il a été maintenu à l’isolement au moins un mois et n’a été autorisé à entrer en contact avec sa famille que quatre mois plus tard. Après un aller-retour entre le tribunal général de Najran et la Cour d’appel, la peine de mort a finalement été confirmée par la Cour suprême le 20 mars 2016. Le 5 avril, l’affaire a été transmise au roi pour ratification. Selon les informations recueillies par Amnistie internationale, la famille de Said al Saiari n’a appris que le souverain avait ratifié la sentence qu’en août. À la mi-novembre, le ministère de l’Intérieur a adressé le dossier au gouvernorat de la province de Najran en vue de l’application de la peine. L’exécution de Said Saiari a été repoussée de six mois, ses proches ayant fait pression sur les autorités pour obtenir un sursis. Cependant, la famille a été informée qu’elle pourrait avoir lieu à tout moment à partir du 2 juillet 2017. DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue : - exhortez le roi Salman bin Abdul Aziz Al Saud à empêcher l’exécution de Said Mabkhout al Saiari et à commuer la peine prononcée à l’encontre de cet homme et de toutes les autres personnes sous le coup d’une condamnation à mort, en vue de l’abolition de la peine capitale ; - rappelez aux autorités que le droit international relatif aux droits humains exige que les procès concernant des crimes passibles de la peine de mort respectent les normes internationales les plus rigoureuses en matière d’équité ; - priez-les instamment d’annuler la déclaration de culpabilité de Said al Saiari et de le faire rejuger dans le cadre d’une procédure conforme aux normes internationales d’équité des procès, sans recourir à la peine de mort. VEUILLEZ ENVOYER VOS APPELS AVANT LE 10 AOÛT 2017 : Roi d’Arabie saoudite et Premier ministre King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud The Custodian of the two Holy Mosques Office of His Majesty the King Royal Court, Riyadh Arabie saoudite Télécopieur : (via le ministère de l’Intérieur) +966 1 403 3125 (merci de vous montrer persévérant) Formule d’appel : Your Majesty, / Sire, (Votre Majesté, dans le corps du texte) Gouverneur de la province de Najran His Royal Highness Prince Jalawi Bin Abdulaziz Bin Musaed Najran Province Arabie saoudite Télécopieur : +966 1 75221733 Formule d’appel : Your Royal Highness, / Monseigneur (Votre Altesse Royale, dans le corps du texte) Copies à : Ministre de l’Intérieur Prince Abdulaziz bin Saud bin Nayef Ministry of the Interior P.O. Box 2933, Airport Road Riyadh 11134 Arabie saoudite Télécopieur : +966 11 403 3125 Twitter : @MOISaudiArabia Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l’Arabie saoudite dans votre pays. Ambassadeur d'Arabie Saoudite au Canada Naif Bin Bandir Alsudairy Ambassade d'Arabie Saoudite au Canada 201 Sussex Drive Ottawa, ON K1N 1K6 Télécopieur : (613) 237-0567 Courriel : Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. COMPLÉMENT D’INFORMATION Le procès de Said al Saiari s’est ouvert le 23 novembre 2011 devant le tribunal général de Najran ; cet homme était accusé d’avoir tué un autre Saoudien. Le 25 décembre 2013, il a été déclaré coupable de l’homicide de Faraj Mubarak en vertu du principe de qisas (« réparation ») inscrit dans le droit islamique, bien que le tribunal ait estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments à charge. Dans son jugement, le tribunal s’est reposé sur une disposition de la charia en vertu de laquelle, si l’accusé est soupçonné d’avoir tué la victime et qu’une animosité entre les deux parties est démontrée, les proches de la victime (seulement les hommes) peuvent faire une déclaration sous serment, dans laquelle ils affirment au moins 50 fois penser que le prévenu est l’auteur du crime. Ces déclarations sont admises comme éléments de preuve devant un tribunal. Dans le cas présent, le père de la victime, dont ce dernier était le seul héritier masculin, a juré 50 fois que l’accusé était responsable du crime, auquel il n’avait pourtant pas assisté. Said al Saiari a été condamné à mort. Le 15 janvier 2014, la Cour d’appel a renvoyé l’affaire devant le tribunal général en demandant au juge d’examiner les conclusions communiquées par l’appelant. Said al Saiari a toujours clamé son innocence et nié être responsable de la mort de la victime, accusant un homme et demandant que d’autres personnes présentes lors de la bagarre soient appelées à témoigner. Il a aussi sollicité un réexamen de l’affaire sur la base des nouveaux éléments. Le juge a refusé, au motif que les conclusions de la défense n’avaient pas modifié son opinion. Le 4 novembre 2014, l’affaire a été renvoyée une fois de plus devant la Cour d’appel. Le 11 février 2015, celle-ci l’a renvoyée devant le tribunal général, auquel elle a adressé un autre ensemble de recommandations relatives à la procédure. Le 25 avril 2015, le tribunal général a donné suite aux observations de la Cour d’appel. Enfin, le 20 mars 2016, la Cour suprême a confirmé la décision, lui conférant un caractère définitif. Le 5 avril 2016, la condamnation a été communiquée au roi afin qu’il la ratifie, ce qu’il a fait en août 2016. À la mi-novembre 2016, le ministère de l’Intérieur a transmis le dossier au gouvernorat de la province de Najran en vue de l’exécution de la peine. La famille de Said al Saiari est parvenue à obtenir un sursis de six mois mais on lui a indiqué que l’exécution pourrait avoir lieu à tout moment à partir du 2 juillet. L’Arabie saoudite fait partie des pays qui comptabilisent le plus d’exécutions ; ce pays a exécuté plus de 400 personnes depuis le début de 2014, dans la plupart des cas pour meurtre et pour des infractions liées aux stupéfiants ou au terrorisme. Elle a recours à la peine capitale pour un large éventail d’infractions qui ne font pas partie des « crimes les plus graves », définis par le droit international relatif aux droits humains, c’est-à-dire des homicides avec préméditation. Dans ce pays, sont passibles de ce châtiment l’adultère, le vol à main armée, l’apostasie, le trafic de drogue, le viol et la sorcellerie. L’adultère et l’apostasie, notamment, ne devraient même pas être incriminés étant donné qu’ils ne sont pas des infractions reconnues par le droit international. Les autorités saoudiennes ne respectent généralement pas les normes internationales en matière d’équité des procès et les garanties protégeant les accusés dans des affaires où ceux-ci risquent la peine de mort. Bien souvent, les affaires de ce genre sont jugées en secret au cours de procédures sommaires, sans que le prévenu puisse bénéficier d’une assistance ou d’un représentant juridique au cours des différentes phases de sa détention et de son procès. Les accusés peuvent être déclarés coupables sur la simple base d’« aveux » obtenus au moyen d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements, sous la contrainte ou par la ruse. Dans certains cas, les familles ne sont pas informées à l’avance de l’exécution d’un de leurs proches. 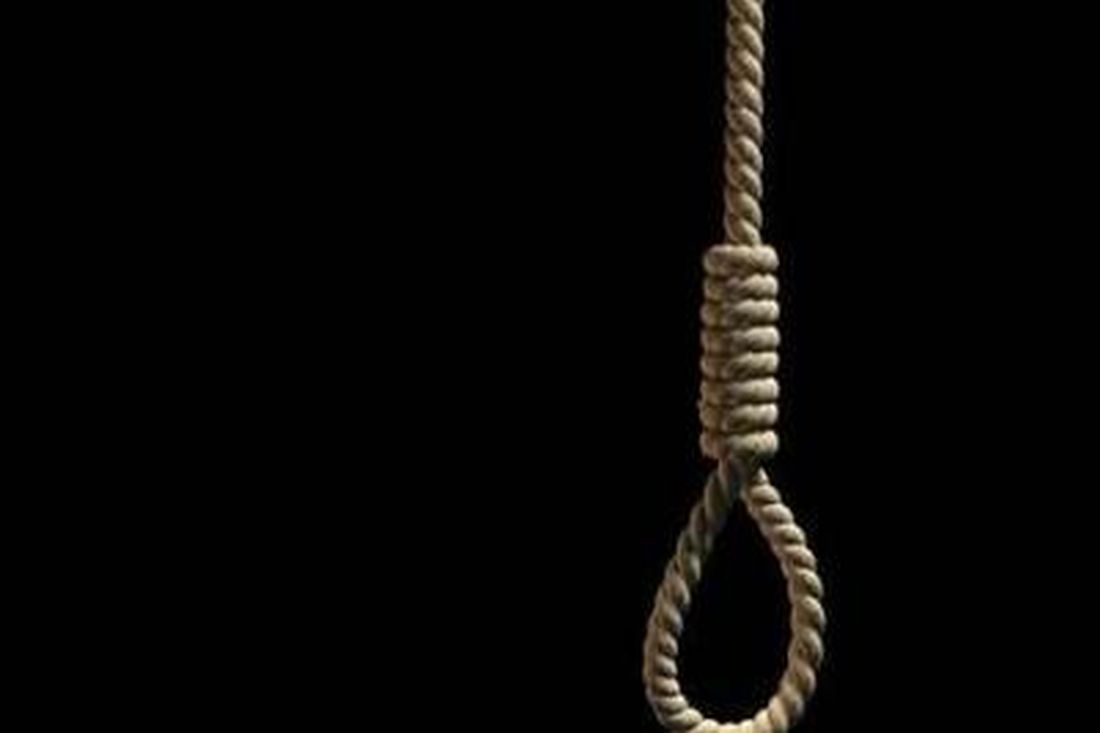 Le président égyptien doit immédiatement suspendre l’exécution de sept hommes dont la condamnation à mort a été confirmée lundi 19 juin par la Haute Cour militaire à l’issue d’un procès manifestement inique. Il doit ordonner qu’ils soient rejugés par un tribunal ordinaire sans que la peine de mort puisse être prononcée, a déclaré Amnistie internationale vendredi 23 juin. Les sentences prononcées contre ces sept hommes sont définitives. Quatre d’entre eux sont détenus et risquent donc d’être exécutés à tout moment une fois que leur condamnation aura été ratifiée par le président ou le ministre de la Défense. Les trois autres, qui n’ont jamais été arrêtés, se trouvent actuellement à l’étranger. Des avocats de la défense ont déclaré à Amnistie internationale que le parquet militaire les avait empêchés d’interjeter le dernier appel à leur disposition. Les condamnations en première instance et en appel étaient fondées sur des aveux recueillis durant une période allant de quatre à 93 jours pendant laquelle les quatre détenus ont été soumis à une disparition forcée. Ils ont affirmé avoir été torturés et maltraités par des agents de l’Agence nationale de sécurité (ANS) dépendant du ministère de l’Intérieur. Les déclarations de culpabilité reposaient également sur des investigations menées par l'ANS et qui comportaient de graves lacunes. La Haute Cour militaire et la Cour de cassation confirment de plus en plus depuis le mois d’avril dernier des condamnations à mort fondées le plus souvent sur des aveux obtenus sous la torture et au cours de périodes de disparition forcée. Amnistie internationale estime que ces hommes risquent particulièrement d’être exécutés très prochainement car au moins six hommes ont été exécutés en mai 2015 dans l’affaire d’Arab Sharkas tout juste deux mois après la confirmation, en mars 2015, par la Haute Cour militaire de leurs condamnations à mort prononcées à l’issue d’un procès manifestement inique. Un tribunal militaire d’Alexandrie avait, dans un premier temps, condamné à mort les sept hommes le 2 avril 2016 après les avoir déclarés coupables d’appartenance à l’organisation interdite des Frères musulmans et d’avoir planifié et perpétré un attentat à l’explosif dans le stade de la ville de Kafr el Sheikh qui avait coûté la vie à trois étudiants d’un collège militaire. Le 19 juin 2017, la Haute Cour militaire a confirmé les condamnations à mort de Lotfy Khalil, de Sameh Abdalla, d’Ahmed al Sehemy et d’Ahmed Salama, qui avaient comparu à l’audience. La cour a également confirmé les sentences capitales prononcées par contumace contre Ahmed Mansour, Fakih Agamy et Sameh Abu Sheir. Aux termes des articles 111 à 114 du Code de justice militaire, les condamnés peuvent interjeter appel dans un délai de 15 jours devant le Bureau des appels militaires, s’ils sont en mesure de faire valoir des violations graves des droits de la défense ou des erreurs de procédure. Toutefois, des avocats ont déclaré à Amnistie internationale que le parquet militaire avait refusé de leur remettre une copie officielle des verdicts prononcés tant en première instance que par la Haute Cour militaire afin qu’ils puissent interjeter appel comme l’exigent les lois égyptiennes. Les avocats ont également affirmé qu’ils avaient introduit une requête devant le Conseil d’État invitant le président à ne pas ratifier les condamnations, et qu’ils s’étaient adressés à lui directement pour solliciter la grâce des condamnés ou une réduction de peine. Selon des familles et des avocats avec lesquels des représentants d’Amnistie internationale se sont entretenus, les quatre hommes détenus ont été maintenus au secret pendant des périodes allant de quatre à 93 jours dans des conditions équivalant à une disparition forcée. De plus, selon les avocats, l'ANS a falsifié les dates d’arrestation dans les investigations officielles de manière à dissimuler la période de disparition forcée en dehors de tout contrôle d’une autorité judiciaire. Ceci constitue une violation grave de la législation égyptienne qui aurait dû entraîner le classement de l’affaire. L’ANS a maintenu ces hommes au secret dans des lieux de détention de Kafr al Sheikh qu'elle gère ainsi qu’au siège de l’organisme au Caire. Leurs familles ont envoyé des télégrammes au parquet militaire et civil et elles se sont enquises de leur sort auprès de responsables de l'ANS ainsi que de différents postes de police de Kafr el Sheikh qui ont tous nié détenir ces hommes. Trois d’entre eux ont déclaré à leurs proches que, durant leur période de disparition forcée, les agents de l’ANS leur avaient bandé les yeux, les avaient battus et leur avaient administré des décharges électriques, particulièrement sur la tête et les organes génitaux, et les avaient suspendus pendant plusieurs heures dans des positions douloureuses. Ils ont affirmé que des agents de l’ANS les avaient torturés pour leur arracher des aveux. Bien que les accusés et leurs avocats aient réclamé à plusieurs reprises un examen médical effectué par le Service de médecine légale, le parquet militaire et le tribunal militaire ont refusé d’ordonner leur transfert dans ce service ou d’ouvrir une enquête sur leurs allégations de torture. Au contraire, le tribunal s’est fondé pour les condamner à mort sur des aveux qui auraient été obtenus sous la torture pendant leur période de disparition forcée. Les procès de civils qui se déroulent en Égypte devant des tribunaux militaires sont inéquitables en soi car l’ensemble du personnel de ces juridictions, tant les juges que les procureurs, est constitué de militaires en service actif qui dépendent du ministère de la Défense et n’ont pas reçu la formation nécessaire dans le domaine des principes du droit ou des normes d’équité des procès. Amnistie internationale a mis en garde contre l’augmentation du nombre de condamnations à mort définitives prononcées par les tribunaux depuis le début de l’année qui ouvre la voie à de nouvelles exécutions. Le droit international relatif aux droits humains dispose que les pays qui maintiennent la peine de mort doivent veiller à ce que les procès pour des crimes passibles de ce châtiment respectent les normes internationales les plus strictes en matière d’équité. Amnistie internationale est opposée à la peine de mort en toutes circonstances sans exception. La peine de mort est une violation du droit à la vie et elle constitue le châtiment le plus cruel, inhumain ou dégradant qui soit. Aucun individu ne doit être privé du droit à la vie quelle que soit l’horreur du crime dont il a été déclaré coupable. Les sentences capitales prononcées contre ces quatre hommes doivent être annulées immédiatement, et ils doivent être rejugés par un tribunal ordinaire selon une procédure conforme aux normes nationales et internationales d’équité et ne pouvant déboucher sur une condamnation à mort. Amnesty International appelle également les autorités égyptiennes à proclamer sans délai un moratoire sur les exécutions en vue de l’abolition de la peine capitale pour tous les crimes. 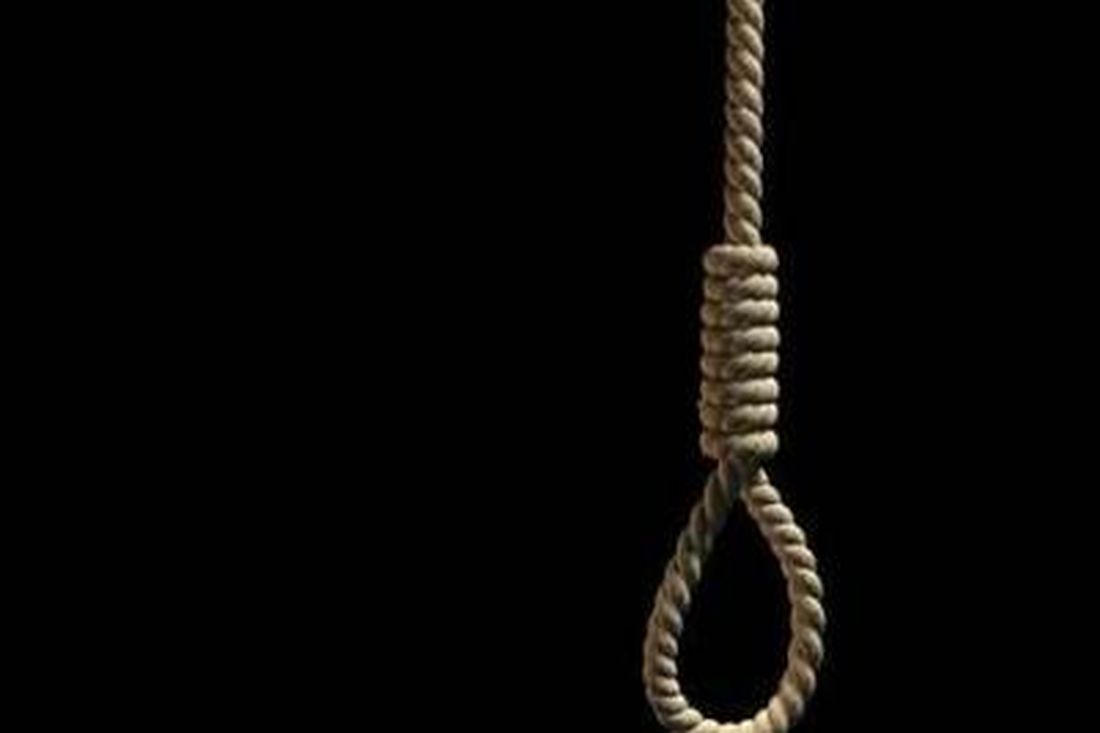 Les autorités égyptiennes doivent immédiatement stopper l'exécution imminente de sept hommes condamnés à mort à l'issue de deux procès manifestement iniques, a déclaré Amnistie internationale, qui leur demande de soumettre cette affaire aux juges les plus confirmés de la plus haute juridiction d'appel du pays, la Cour de cassation. L'organisation avait récemment mis en garde contre le fait que des modifications de la loi adoptées par le président Abdel Fattah al Sisi, restreignant les possibilités d'appel, risquaient de contribuer à une brusque hausse du nombre de condamnations à mort et d'exécutions dans le pays. Au moins six de ces hommes ont été soumis à une disparition forcée et à la torture afin qu'ils fassent des « aveux » utilisés par la suite par un tribunal pénal de Mansoura pour les déclarer coupables du meurtre d'un policier et de la création d'une organisation « terroriste ». Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation la semaine dernière. Dans une autre affaire, un homme risque également d'être exécuté de manière imminente à la suite du rejet de son ultime recours présenté devant cette même Cour. Il a été déclaré coupable, à l'issue d'un procès manifestement inique, d'avoir tué un homme lors d'une manifestation à Alexandrie. « Quels que soient les agissements dans lesquels ces hommes pourraient être impliqués, le fait de soumettre des suspects à une disparition forcée et à la torture n'a rien à voir avec la justice. La peine de mort est le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Nul ne doit être privé de son droit à la vie, quelle que soit la gravité des crimes qui lui sont reprochés, a déclaré Najia Bounaim, directrice du travail de campagne pour l'Afrique du Nord à Amnistie internationale. « Nous ne disposons plus de beaucoup de temps pour sauver la vie de ces hommes, qui peuvent être exécutés à tout moment. Les autorités égyptiennes doivent immédiatement stopper ces exécutions et ordonner que ces sept hommes soient rejugés dans le cadre de procès équitables et sans recours à la peine de mort ni à des éléments de preuve entachés par l'utilisation de la torture. » Le 7 juin, la Cour de cassation égyptienne a confirmé la condamnation à mort de Bassem el Khereby, Ahmed Meshaly, Ibrahim Azab, Mahmoud Wahba, Khaled Askar, et Abd el Rahman Atteia, à l'issue d'un procès entaché par de graves irrégularités. L'homme qu'ils sont accusés d'avoir tué était un policier assigné à la protection de l'un des membres du panel de juges chargés du procès du président Mohamed Morsi. Le président dispose d'une période de 14 jours pour réduire cette peine, avant qu'une date définitive ne soit fixée pour les exécutions. Les juges des hommes ont soumis un ultime recours au parquet le 15 juin pour demander qu'ils soient rejugés, en raison des erreurs de procédure ayant entaché leur procès. Si cette demande est acceptée, cette affaire sera examinée par les juges les plus confirmés de la Cour de cassation. Selon leurs proches et leurs avocats, ils ont été arrêtés par l'Agence nationale de sécurité (ANS) en mars 2014 et soumis à une disparition forcée pour une période allant de trois jours à trois mois, durant laquelle ils ont été privés de contacts avec leurs proches, leurs avocats et le monde extérieur, et torturés pour qu'ils fassent des « aveux », filmés. Ils ont été détenus dans plusieurs lieux à travers le pays, notamment au siège de l'ANS au Caire. Au moins trois des familles ont dit à Amnistie internationale qu'elles avaient appris l'arrestation de leurs proches quand elles les avaient vus à la télévision faire des « aveux », le visage meurtri. Quand les familles ont finalement été autorisées à venir rendre visite à ces hommes en prison, ils leur ont dit qu'ils avaient été torturés, violés avec un bâton en bois à plusieurs reprises, soumis à des décharges électriques appliquées sur les parties génitales et sur d'autres parties du corps et suspendus dans une position douloureuse pendant des périodes allant jusqu'à quatre jours. Ils ont aussi dit que les agents de l'ANS les avaient brûlés dans le cou avec des mégots, et avaient menacé de violer leur mère et leurs sœurs afin de les forcer à faire des aveux. Ces hommes sont par la suite revenus sur leurs « aveux » devant un procureur de la sûreté de l'État au Caire, en expliquant qu'ils avaient été torturés. Mais ils ont alors été renvoyés à l'ANS, où on les a de nouveau torturés pour les punir d'être revenus sur leurs aveux ; ils ont été conduits devant le procureur une seconde fois, et ont cette fois « avoué » par crainte de nouvelles représailles. Les avocats de ces hommes ont aussi dit à Amnistie internationale qu'ils avaient été privés d'une assistance juridique pendant les interrogatoires, et que les verdicts rendus contre eux reposaient uniquement sur les éléments qui leur avaient été extorqués par l'ANS au moyen de la torture et d'enquêtes entachées d'irrégularités. De plus, les juges n'ont tenu aucun compte des preuves médicolégales indiquant qu'au moins deux de ces hommes avaient des contusions et des brûlures sur le corps infligées pendant leur détention, et ont refusé à plusieurs reprises d'envoyer les accusés à l'Autorité médicolégale pour qu'elle enquête sur leurs allégations de torture. Bien que la Cour de cassation ait accepté d'examiner le recours et réexaminé ces affaires, elle n'a pas fixé de date pour une audience qui aurait permis aux avocats de présenter leur défense devant les juges. Elle a en outre appliqué une récente modification draconienne des dispositions de la loi en matière d'appel, qui abolit le droit d'un accusé à un nouveau procès et réduit le nombre de degrés de recours à un seul au lieu de deux, ce qui ouvre la voie à une augmentation du nombre de condamnations à mort et d'exécutions. L'affaire d'Alexandrie La Cour de cassation a également confirmé la condamnation à mort prononcée contre Fadl Abdel Mawla en avril 2017 dans une autre affaire. Cet homme a été déclaré coupable, à l'issue d'un procès inique, du meurtre d'un copte commis lors d'une manifestation à Alexandrie le 15 août 2013 ; il risque lui aussi à tout moment d'être exécuté. Son avocat a dit qu'il avait été soumis à des mauvais traitements par des agents de l'ANS à la direction de la sécurité d'Alexandrie, qui avaient sans succès cherché à le forcer à faire des « aveux ». Les avocats ont dit à Amnistie internationale que la Cour s'était basée, pour le déclarer coupable, uniquement sur le témoignage d'un seul témoin qui, selon les avocats et des associations locales de défense des droits, a été forcé à témoigner au moyen de pressions exercées par un agent de l'ANS. Ses avocats ont également présenté à la cour des documents officiels montrant que Fadl Abdel Mawla Abdel Mawla était au travail au moment de la manifestation. Ils ont soumis un recours au procureur, demandant un nouveau procès. Si cette demande est acceptée, cette affaire sera examinée par les juges les plus confirmés de la Cour de cassation. Complément d’information Le recours à la peine de mort est en nette augmentation en Égypte depuis 2013, année durant laquelle aucune exécution n'a eu lieu et 109 personnes ont été condamnées à mort. Le nombre d'exécutions est passé de 15 en 2014 à 22 en 2015, et il a ensuite doublé avec 44 exécutions recensées en 2016. Le nombre de condamnations à mort a augmenté pour atteindre les chiffres de 509 en 2014 et de 538 en 2015, puis il a chuté, passant à 237 en 2016.  Il faut que les autorités soudanaises libèrent sans délai l’éminent défenseur des droits humains Mudawi Ibrahim Adam et son collègue Hafiz Idris Eldoma et cessent de s’en prendre à tort aux dissidents, a déclaré Amnistie internationale mercredi 14 juin 2017, alors que le procès de ces deux hommes s’ouvre à Khartoum, la capitale. Mudawi Ibrahim Adam et Hafiz Idris Eldoma doivent répondre de six charges controuvées, notamment d’atteinte au système constitutionnel et de guerre contre l’État – deux infractions passibles de la réclusion à perpétuité, voire de la peine de mort. « Depuis plus de 10 ans, Mudawi Ibrahim Adam est constamment harcelé par les autorités soudanaises en raison de ses activités en faveur des droits humains au Darfour et dans le reste du pays. Malheureusement, le harcèlement a pris récemment un tour plus tragique : cet homme et son collègue Hafiz Idris Eldoma encourent la peine capitale, a déclaré Muthoni Wanyeki, directrice du programme Afrique de l’Est, Corne de l’Afrique et Grands Lacs à Amnesty International. « Il faut que Mudawi Ibrahim Adam et Hafiz Idris Eldoma soient libérés immédiatement et sans condition car défendre les droits humains ne constitue pas une infraction. Leur arrestation et leur incarcération prolongée sont purement et simplement un déni de justice. » Mudawi Ibrahim Adam, professeur d’ingénierie à l’université de Khartoum, a été arrêté par des agents des services de renseignement le 7 décembre 2016. Il est l’ancien directeur de l’Organisation pour le développement social du Soudan (SUDO), qu’il a fondée, et s’est vu décerner plusieurs prix en lien avec les droits humains. Hafiz Edris Eldoma, une personne déplacée du Darfour, a été arrêté le 24 novembre 2016 au domicile de Mudawi Ibrahim Adam. Amnistie internationale œuvre à la libération de ce dernier dans le cadre de sa campagne Osons le courage. 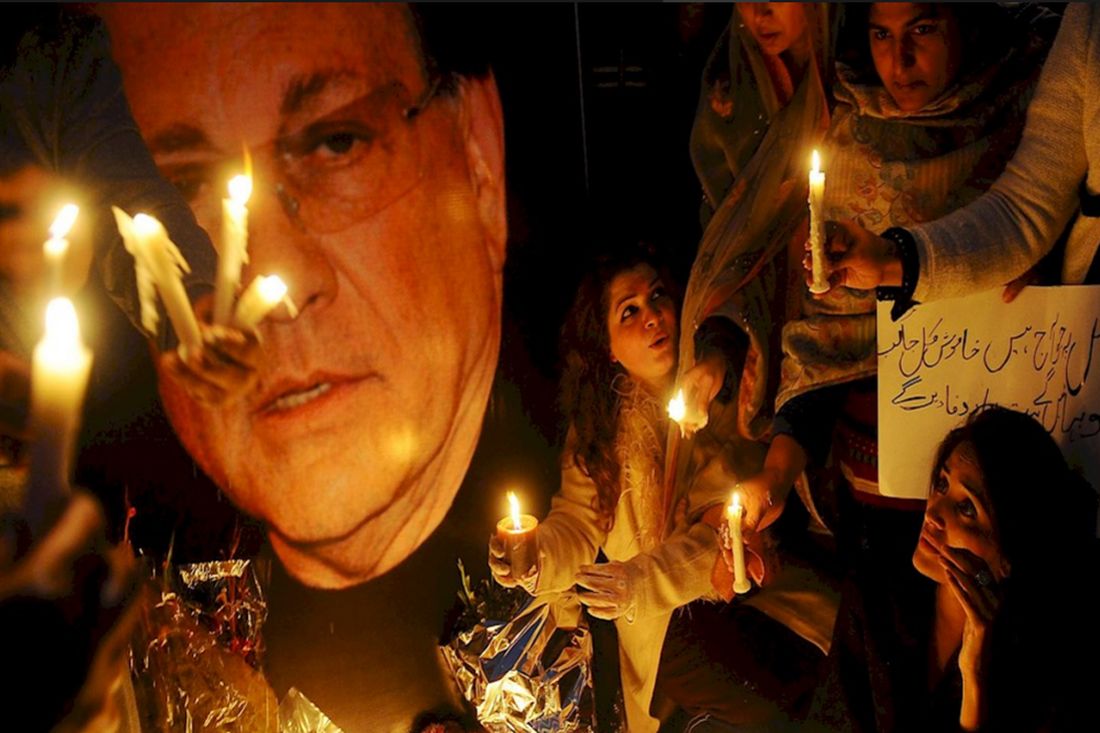 En réaction à la décision du tribunal antiterroriste de déclarer coupable et de condamner à mort un homme qui aurait posté du contenu sur Facebook considéré comme « blasphématoire », Nadia Rahman, chargée de campagne sur le Pakistan chez Amnistie internationale, a déclaré : « Le fait de déclarer une personne coupable d’avoir posté du contenu blasphématoire sur Internet et de la condamner à mort pour ce motif est une violation du droit international relatif aux droits humains et créerait un dangereux précédent. Les autorités utilisent des lois aux termes vagues et à la portée très large pour ériger en infraction la liberté d'expression. Cette personne, ainsi que toutes les autres qui ont été accusées de “blasphème”, doit être libérée immédiatement. « Au lieu d’amener à rendre des comptes les responsables des violences collectives qui ont tué au moins trois personnes et qui en ont blessé de nombreuses autres ces derniers mois, les autorités participent désormais au problème en appliquant des lois qui ne comportent pas de mesures de protection et peuvent donner lieu à des atteintes aux droits humains. « Personne ne doit être traîné devant un tribunal antiterroriste, ni aucun autre tribunal, pour avoir simplement exercé son droit à la liberté d'expression et à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou d’opinion sur Internet. En outre, il est terrifiant de constater que les autorités sont prêtes à appliquer la peine de mort dans ce type d’affaires, un châtiment cruel et irréversible que la majorité des pays du monde a eu le bon sens d’abandonner. » Complément d’information La déclaration de culpabilité et la condamnation ont été imposées par un tribunal antiterroriste après qu’un utilisateur de Facebook a été accusé au titre de la section 295-C du Code pénal pakistanais (remarques désobligeantes à l’encontre du prophète) et des sections IX et XI(w) de la Loi antiterroriste, qui érigent en infraction l’incitation à la haine religieuse. La condamnation est la plus dure jamais imposée pour une infraction liée à la cybercriminalité. Le Pakistan n'a encore jamais exécuté quelqu'un reconnu coupable de blasphème. En décembre 2016, Amnistie internationale a publié un rapport qui rassemble des informations sur la manière dont les lois pakistanaises sur le blasphème sont souvent utilisées contre les membres de minorités religieuses ou autres qui sont la cible de fausses accusations, et qu’elles encouragent des milices qui sont prêtes à menacer ou à tuer ces dernières. Intitulé “As good as dead”: The impact of blasphemy laws in Pakistan, le rapport montre que quand une personne fait l'objet d'accusations, elle se retrouve piégée dans un système qui lui offre peu de protection, où elle est présumée coupable et qui ne la met pas à l'abri de ceux qui veulent utiliser la violence. Le rapport met en évidence le fait que les personnes accusées de blasphème doivent livrer un très dur combat pour établir leur innocence. Les personnes acquittées des charges qui pesaient sur elles et remises en libertés, généralement après une longue période, risquent toujours de faire l'objet de menaces de mort. Amnistie internationale est catégoriquement opposée à la peine de mort en toutes circonstances, indépendamment des questions relatives à la culpabilité ou à l’innocence, quels que soient l’accusé, le crime commis ou la méthode d’exécution. William Morva, ressortissant hongrois âgé de 35 ans, doit être exécuté le 6 juillet en Virginie. Un psychiatre a établi un diagnostic de trouble délirant, et conclu que ce trouble avait contribué à la commission des crimes pour lesquels il a été condamné à mort. Le jury n'a pas été informé du fait qu'il souffre de ce grave trouble mental.
En août 2006, William Morva, alors âgé de 24 ans, était détenu depuis un an dans la prison de Montgomery, en Virginie, pour tentative de vol et pour d'autres infractions. À l'époque, la prison était surpeuplée, avec deux à trois fois plus de détenus par rapport à sa capacité d'accueil maximale, et les soins médicaux et psychologiques fournis n'étaient pas suffisants. L'état de santé psychologique de William Morva s'est dégradé, et il pensait que son état de santé physique se dégradait gravement et que sa vie était en danger. Au cours de l'année, il avait signalé ses inquiétudes à plusieurs personnes dans un certain nombre de lettres envoyées depuis la prison. Le 20 août, des employés de la prison ont transporté William Morva à l'hôpital car il disait avoir besoin de soins médicaux. Là, il a attaqué l'agent chargé de l'accompagner, lui a pris son arme, et pendant sa fuite il a tiré sur un gardien non armé de l'hôpital, Derrick McFarland. Le 21 août, Eric Sutphin, adjoint du shérif, a été tué par balle après avoir répondu à un signalement visuel de William Morva. Plus tard le même jour, la police a trouvé William Morva allongé dans un fossé. Il a été arrêté, inculpé de meurtre passible de la peine capitale, et déclaré coupable en 2008. Lors de la phase de détermination de la peine, la défense a fait comparaître un psychiatre et un neurologue qui ont déclaré que cet homme présentait des troubles de la personnalité qui n'atteignaient pas le niveau de graves troubles mentaux. Ils ont dit aux jurés que William Morva avait d'étranges croyances mais qu'il ne souffrait pas d'hallucinations. Le jury a voté en faveur de la peine de mort. En 2012, un psychologue a réexaminé tous les éléments disponibles, y compris l'historique familial de William Morva, qui présente des cas de « maladie mentale grave et fréquente » incluant des cas de trouble délirant, de schizophrénie, et de trouble obsessionnel compulsif. Le psychologue a critiqué les évaluations présentées par des experts durant le procès, en concluant qu'aucun d'eux n'avait identifié ou décrit à titre de circonstances atténuantes les « délire somatique, délire mégalomaniaque et hallucinations paranoïaques” persistants de William Morva », entre autres, ainsi que « l'aggravation manifeste de ses problèmes psychiatriques » avant le crime. Il est parvenu à la conclusion que le délire somatique de William Morva « est peut-être lié aux crimes qu'il a commis car il croyait apparemment qu'il était en train de mourir à cause de ses "maladies", ce qui semble avoir motivé sa tentative d'évasion ». En 2014, une psychiatre nommée par la cour a examiné son cas et diagnostiqué chez William Morva un trouble délirant, du type délire de persécution. Elle a considéré qu'il avait commis ces crimes à cause des délires dont il souffrait. Elle a recommandé qu'il reçoive un traitement avec des médicaments, et conclu qu'il « n'était pas en mesure d'aider ses avocats ». Alors que ces éléments ont été présentés en appel, les règles de procédure ont empêché la cour de décider si William Morva présentait ce trouble mental et si les crimes qu'il avait commis en résultaient. Son exécution a été fixée au 6 juillet. DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais ou dans votre propre langue : - demandez que la peine de mort prononcée contre William Morva soit commuée et qu'il reçoive des soins médicaux pour ses troubles mentaux ; - soulignez qu'un diagnostic de trouble délirant a été rendu, mais que les jurés ont eu comme information qu'il souffrait d'un trouble mental moins grave et n'avait pas d'hallucinations, ce qui les a empêchés d'obtenir un tableau complet de la personne qu'on leur demandait de condamner ; - expliquez que vous ne cherchez aucunement à minimiser la gravité des crimes violents qui ont été commis, ni leurs conséquences. ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 6 JUILLET 2017 (d'ici le 22 juin si possible, en cas de décision rapide) À : Gouverneur de Virginie Terry McAuliffe Common Ground for Virginia P.O. Box 1475 Richmond, VA 23218, États-Unis Télécopieur : +1 804-371-6531 Courriel (via le site Internet) : https://governor.virginia.gov/constituent-services/communicating-with-the-governors-office/ (Pour ceux à l'extérieur des États-Unis, veuillez utiliser l'adresse du bureau d'Amnistie internationale États-Unis à New York : 5 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001) Twitter : @TerryMcAuliffe Formule d’appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur, Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays. Insérez les adresses ci-dessous : Ambassadeur des États-Unis Ambassade des États-Unis 490, chemin Sussex Ottawa, Ontario K1N 1G8, Canada Télécopieur : 613-688-3082 Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. COMPLÉMENT D’INFORMATION Aucun membre de la famille de William Morva n'est venu témoigner pendant le procès, ce qui a davantage encore privé les jurés d'un tableau complet de la personne qu'on leur demandait de condamner. Depuis le procès, sa mère a déclaré : « William vit dans une autre réalité. Je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas été expliqué devant la cour pendant son procès. La version de la réalité de William est tellement différente de celle des autres gens qu'il fonctionne avec compréhension différente du monde qui l'entoure […] Il a une maladie mentale. » En Virginie, pour pouvoir prononcer une peine de mort le jury doit arriver à la conclusion que l'État a prouvé au-delà de tout doute raisonnable l'existence d'au moins une circonstance aggravante sur deux. La première est que l'accusé a « lors de la commission de l'infraction agi d'une façon gratuite ou particulièrement ignoble, horrible ou inhumaine, incluant la torture, la dépravation morale ou des coups et blessures aggravés à l'égard de la victime ». Dans le cas de William Morva, l'État a retenu la « dépravation morale ». Comme il a été prouvé que son délire somatique a contribué à la commission des crimes, il est surprenant de voir que l'État considère que ces crimes sont « le reflet d'une conscience nettement plus "dépravée" que celle de toute autre personne coupable de meurtre », condition prévue par la Constitution pour réserver la peine de mort aux « pires » des crimes et des criminels. Toutefois, les jurés qui ont décidé de prononcer cette peine n'avaient pas été informés de ce délire somatique. L'autre circonstance aggravante est que l'accusé représentera un danger pour la société si on le laisse vivre. Sachant que l'accusation allait se baser fortement sur ce point, les avocats de William Morva ont demandé la nomination d'un psychologue médicolégal spécialisé dans l'évaluation des risques en prison afin qu'il réfute ce point. Le juge a refusé cette demande, et l'État a alors insisté sur le danger que William Morva représenterait en prison pour les gardiens s'il était condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Le procureur a dit aux jurés qu'il était « impossible de conclure que cet accusé ne s'évadera[it] jamais [car] il est plus malin que les autres, et il est constamment en train de réfléchir […] Il s'agit d'un prisonnier qui fait du mal aux gardiens, qui les frappe. Il s'agit d'un prisonnier qui tire sur des agents en uniforme [L]a perspective d'une réclusion à perpétuité est effrayante [car si au bout d'une année en prison] il tue des gens [alors] qu'est-ce que la perspective d'une réclusion à perpétuité va amener cette personne à faire aux gardiens de prison ? » William Morva a dû porter une ceinture électrifiée incapacitante pendant le procès. Le juge n'a pas tenu d'audience pour déterminer si cette mesure était nécessaire, alors même que l'accusé n'avait causé aucun problème en matière de discipline durant la procédure préliminaire au procès ni au cours des 18 mois de détention provisoire à la prison régionale de New River Valley. En 2015, un juge fédéral a noté que « Morva portait une ceinture électrifiée incapacitante sous ses vêtements, et certains jurés ont observé le renflement causé par cette ceinture », mais a confirmé la peine de mort. Dans une affaire remontant à 1998, une cour d'appel de l'État de Washington a estimé que le juge de première instance aurait dû tenir une telle audience, et a ordonné un nouveau procès : « Le dossier montre que les jurés étaient au courant pour la ceinture électrique et qu'ils spéculaient sur ce point. Son utilisation a peut-être amené les jurés à penser que [l'accusé] était une personne dangereuse à qui on ne pouvait pas faire confiance et qui était incontrôlable, même en présence d'un agent armé. L'utilisation de la ceinture électrique peut être encore plus préjudiciable que les menottes ou les chaînes aux chevilles car elle implique qu'il est nécessaire d'utiliser des moyens tout particuliers pour contrôler l'accusé. » Dans un procès où la peine capitale est susceptible d'être prononcée, cette impression peut faire pencher la balance en faveur de ce châtiment. L'un des jurés du procès de William Morva s'est souvenu que deux policiers se tenaient constamment derrière lui, et que l'un d'eux avait « un Tazer ou une télécommande pouvant servir à contrôler M. Morva », et un autre qu'il y avait « un gros renflement autour de la taille de M. Morva sous ses vêtements » et qu'un policier lui avait dit que « M. Morva portait une ceinture électrifiée incapacitante contrôlée par les policiers qui se tenaient derrière lui pour le surveiller ». Amnistie internationale considère que l’utilisation des ceintures incapacitantes viole l’interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir https://www.amnesty.org/fr/documents/amr51/054/1999/fr/). Treize exécutions ont eu lieu aux États-Unis depuis le début de l’année, ce qui porte à 1 455 le nombre de personnes auxquelles les autorités de ce pays ont ôté la vie depuis 1976, quand la Cour suprême fédérale a approuvé une nouvelle législation relative à la peine capitale. La Virginie est responsable de 112 de ces exécutions. Amnistie internationale est opposée à la peine de mort en toutes circonstances. À l’heure actuelle, 141 pays sont abolitionnistes en droit ou en pratique. Le droit international et les normes internationales sur le recours à la peine capitale énoncent que ce châtiment ne peut pas être imposé ou appliqué à des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un handicap mental. Cela est valable si l'accusé présentait un tel trouble au moment du crime, et aussi si ce trouble est apparu après que l'accusé a été déclaré coupable. Deux garçons ont reçu une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre. Ils disent qu’ils ont été forcés à « avouer » le meurtre.
Muhamed Yasin Abdi et Daud Saied Sahal ont vu leurs condamnations à mort commuées en réclusion à perpétuité par le tribunal militaire suprême du Puntland. Les deux garçons faisaient partie d’un groupe de sept adolescents arrêtés par la police le 28 décembre 2016 à Bossaso, dans le Puntland, après l’homicide de trois hauts responsables travaillant pour l’administration régionale du Puntland. Les cinq autres adolescents arrêtés en même temps qu’eux ont été exécutés le 8 avril. L’âge de ces sept garçons est actuellement contesté. D’après les membres de leurs familles, ils étaient tous âgés de moins de 18 ans au moment où ils auraient commis le crime. Mais les autorités du Puntland soutiennent qu’ils étaient majeurs. D’après le père d’Ayub Yassin et l’oncle d’Ali Ismaeil (Ayub et Ali faisaient partie de ceux qui ont été exécutés), les sept garçons ont été soumis à diverses formes de mauvais traitement et ont été maintenus en détention dans des conteneurs de transport pendant environ deux semaines avant d’être transférés dans un poste de police. Les sept jeunes gens ont ensuite comparu le 13 février devant un tribunal militaire, qui les a déclarés coupables de meurtre et condamnés à la peine capitale. Ils n’ont pas pu bénéficier des services d’un avocat au cours du premier procès. Un mois après la décision, les prévenus ont fait appel de leur déclaration de culpabilité et de leur condamnation à mort, mais le jugement initial a été maintenu par une juridiction militaire supérieure. Pour poursuivre vos pressions, veuillez consulter la nouvelle Action urgente ( Agir ) Robert Melson a été exécuté en Alabama dans la nuit du 8 juin, après que la Cour suprême des États-Unis a levé le sursis temporaire qu’elle lui avait accordé quelques heures plus tôt. C’est la seconde exécution en Alabama en deux semaines.
Robert Melson a été condamné à mort en 1996 pour un triple meurtre commis en 1994 au cours d’un vol à main armée dans un restaurant Popeye’s situé à Gadsden, en Alabama. Il a toujours clamé son innocence. Son co-accusé, dont les premières déclarations accusaient également Robert Melson, a plus tard affirmé que ce dernier n’était pas impliqué. Le 2 juin 2017, la Cour d’appel du onzième circuit a prononcé un sursis en attendant de trouver une solution au recours formé par plusieurs condamnés à mort en Alabama contre l’utilisation du midazolam comme sédatif dans le protocole d’injection létale. L’État a fait appel et, le 6 juin, sans aucune explication, la Cour suprême des États-Unis a levé le sursis. Trois des juges ont protesté contre l’annulation du report de l’exécution. À l’approche de l’exécution, les avocats de Robert Melson ont introduit une requête d’urgence portant une nouvelle fois sur l’utilisation du midazolam, afin d’obtenir un nouveau sursis. La Cour d’appel a levé le sursis le 8 juin. Peu avant l’heure prévue de l’exécution, la Cour suprême a prononcé un sursis temporaire pour donner le temps de prendre la requête en considération, mais elle l’a levé environ trois heures plus tard. Personne ne s’est prononcé contre cette décision. L’exécution a débuté peu avant 22 heures, et Robert Melson a été déclaré mort à 22 heures 37, heure locale. Il n’a pas fait de déclaration finale. Steve Marshall, le procureur général de l’État d’Alabama, a dit dans une déclaration qu’il a faite après l’exécution : « Après des décennies, Robert Melson a cessé de glisser entre les doigts de la justice. Pendant 33 ans, les familles des trois jeunes gens dont il a pris la vie, ainsi que du survivant, ont attendu de pouvoir tourner la page et guérir. Elles peuvent enfin commencer ce soir. » Cette exécution est la treizième aux États-Unis cette année, ce qui porte à 1 455 le nombre de personnes auxquelles les autorités de ce pays ont ôté la vie depuis la reprise de cette pratique en 1977, après l’approbation de la nouvelle législation relative à la peine capitale par la Cour suprême fédérale en 1976. Soixante de ces exécutions ont eu lieu en Alabama, la dernière le 25 mai 2017. Amnistie internationale est opposée à la peine de mort en toutes circonstances. À l’heure actuelle, quelque 141 pays sont abolitionnistes en droit ou dans la pratique. Aucune action complémentaire n’est requise de la part des membres. Un grand merci à toutes les personnes qui ont envoyé des appels. Ceci est la première mise à jour de l’AU 127/17. Pour plus d’informations : www.amnesty.org/fr/documents/amr51/6407/2017/fr/. |
Centre de presseLe centre de presse du Secrétariat international met à la disposition des professionnels et du grand public des nouvelles de dernière minute, des commentaires de spécialistes et des informations importantes sur la situation dans le monde relative à la peine de mort. Archives
Septembre 2022
Catégories
Tout
|
Amnistie internationale Canada francophone - Abolition de la peine de mort - Tél. : 819-944-5157
Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca
Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca


 Flux RSS
Flux RSS
