Afrique. Un arrêt positif relatif à la peine de mort est terni par la poursuite des exécutions.10/10/2020  Au cours de l’année qui s’est écoulée depuis que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a donné un nouvel élan à la campagne mondiale en faveur de l’abolition de la peine de mort en qualifiant l’imposition obligatoire de ce châtiment d’« inique » et d’échec au niveau de la procédure judiciaire, au moins quatre pays – le Botswana, l’Égypte, la Somalie et le Soudan du Sud – ont procédé à des exécutions, a déclaré Amnistie internationale le 9 octobre 2020. Le 28 novembre 2019, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a statué dans un arrêt historique que l’application de la peine de mort à titre de châtiment obligatoire était manifestement inique, car elle prive la personne inculpée du droit d’être entendue et de présenter des circonstances atténuantes. En examinant l’affaire intentée par le condamné à mort tanzanien Ally Rajabu contre le gouvernement de Tanzanie, la Cour a également statué que l’imposition obligatoire de la peine de mort ne respecte pas les garanties d’une procédure régulière et viole les normes d’équité des procès, en empêchant les cours de justice de fixer une sanction proportionnelle au crime commis. « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a fait œuvre de pionnière en soulignant l’iniquité inhérente au fait de condamner à mort des personnes sans leur accorder les garanties les plus élémentaires d’un procès équitable, a déclaré Netsanet Belay, directeur de la recherche et du plaidoyer au sein d'Amnistie internationale. « Toutefois, près d’un an plus tard, la Tanzanie doit encore mettre en œuvre cet arrêt. Encore plus inquiétant, le Botswana, l’Égypte, la Somalie et le Soudan du Sud ont depuis procédé à des exécutions. Alors que le mouvement abolitionniste célèbre la Journée mondiale contre la peine de mort, nous invitons tous les États membres de l’Union africaine qui maintiennent ce châtiment dans leurs législations à le supprimer et, dans l’attente de l’abolition, à instaurer immédiatement un moratoire officiel sur les exécutions et à commuer sans délai toutes les sentences capitales en peines d’emprisonnement. » En outre, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a conclu que la pendaison comme méthode d’exécution s’apparente à de la torture et à un traitement cruel, inhumain et dégradant, du fait de la souffrance inhérente à cette méthode. Amnistie internationale s’oppose en toutes circonstances et sans aucune exception à la peine de mort, quelles que soient la nature et les circonstances du crime commis, la culpabilité ou l’innocence ou toute autre situation du condamné, ou la méthode utilisée pour procéder à l’exécution. Elle bafoue le droit à la vie, tel que proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Il s’agit du châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Depuis une quarantaine d’années, des progrès considérables ont été accomplis dans la lutte contre la peine de mort en Afrique. Si aucun pays africain ne l’avait abolie pour tous les crimes il y a 40 ans, c’est le cas de 20 d’entre eux à ce jour. Sur les pays qui maintiennent encore ce châtiment dans leur législation, 17 sont abolitionnistes dans la pratique : ils n’ont procédé à aucune exécution au cours des 10 dernières années et semblent avoir pour politique ou pour pratique établie de s'abstenir de toute exécution. « Tous les pays dont la législation prévoit encore la peine de mort doivent respecter le droit à une assistance juridique efficace, dans l’attente de l’abolition totale de la peine de mort. C’est une garantie essentielle contre la peine de mort et un moyen de protéger les droits humains des personnes encourant ce châtiment, particulièrement leur droit à un procès équitable et leur droit à la vie », a déclaré Netsanet Belay. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a adopté en 2015 le projet de protocole sur l’abolition de la peine de mort en Afrique, mais son examen par les États membres de l’Union africaine n’a pas progressé depuis.
0 Commentaires
 Le monde entier lutte actuellement contre le COVID-19 et des pays de toute l’Afrique subsaharienne ont pris un certain nombre de mesures visant à enrayer la propagation de ce coronavirus mortel sur leur territoire. Bien que la pandémie de COVID-19 rappelle cruellement que le droit à la vie est important et doit être protégé, un nouveau rapport d’Amnistie internationale sur le recours à la peine de mort dans le monde en 2019 montre que certains États de la région ne s’efforcent pas systématiquement de protéger ce droit. En réalité, ils s’évertuent parfois à le bafouer en condamnant à mort ou en exécutant des personnes. En 2019, quatre pays de la région – le Botswana, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud – ont procédé à des exécutions, alors que le nombre d’exécutions connues à l’échelle mondiale a baissé de 5 %. Amnistie internationale a pu confirmer une exécution au Botswana, une au Soudan, 11 au Soudan du Sud et 12 en Somalie. Ces pays sont tristement célèbres pour être ceux qui persistent, en Afrique subsaharienne, à ôter la vie à des personnes condamnées et cette mauvaise réputation ne fait que croître ; ce sont eux aussi qui ont procédé à des exécutions en 2018, comme ils l’ont fait régulièrement ces 10 dernières années. Mokgweetsi Masisi, nouveau président du Botswana depuis octobre 2019, n’a pas ralenti le rythme des exécutions dans son pays, qui est le seul d’Afrique australe à maintenir cette pratique. Outre l’exécution qui s’est déroulée en décembre 2019, trois autres ont déjà eu lieu depuis le début de l’année 2020. La situation au Soudan du Sud est encore plus préoccupante. En effet, depuis qu’il est devenu indépendant du Soudan en 2011, ce pays a exécuté au moins 43 personnes. Le record absolu a été atteint en 2019, avec 11 exécutions enregistrées, ce qui représentait une hausse considérable du total annuel. Sept hommes, dont trois d’une même famille, ont été exécutés en février. Les autorités n’ont même pas prévenu leurs proches. Quatre personnes ont été exécutées par la suite : deux le 27 septembre et deux le 30, dont une qui était mineure au moment de l’infraction commise. Ce jeune homme avait environ 17 ans lorsqu’il a été déclaré coupable et condamné à mort, ce qui est contraire au droit international relatif aux droits humains et à la Constitution du Soudan du Sud. En effet, celle-ci interdit le recours à la peine de mort à l’encontre de personnes qui étaient mineures au moment des faits qui leur sont reprochés. Il est alarmant de constater que le nombre de condamnations à mort confirmées en Afrique subsaharienne a augmenté de 53 % entre 2018 et 2019, passant de 212 à 325. Cela s’explique par les hausses enregistrées dans 10 pays, à savoir le Kenya, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe. Au total, des condamnations à mort ont été confirmées dans 18 pays en 2019, soit un de plus qu’en 2018. L’accroissement du nombre de condamnations à mort enregistrées en Zambie est tout à fait saisissant. Selon les informations communiquées par les autorités, 101 personnes ont été condamnées à mort, ce qui représente une forte hausse par rapport à 2018, année pendant laquelle Amnistie internationale avait recensé 21 peines capitales prononcées. Par ailleurs, huit personnes initialement condamnées à mort ont finalement été innocentées par la justice zambienne. Elles auraient pu être exécutées pour une infraction qu’elles n’avaient en réalité pas commise. Cela montre que les tribunaux ne sont pas infaillibles et que le risque de punir et d’exécuter une personne innocente en cas de recours à la peine capitale ne peut jamais être éliminé. À la fin de l’année, au moins 5 731 personnes étaient sous le coup d’une condamnation à mort en Afrique subsaharienne ; le Kenya et le Nigeria représentaient 65 % de ce total. Ces personnes risquent davantage d’être exécutées une fois qu’elles ont épuisé leurs voies de recours et lorsqu’il n’existe pas de moratoire officiel sur les exécutions dans leur pays. Même quand elles peuvent encore interjeter appel, l’impossibilité de bénéficier d’une représentation juridique efficace, la lenteur de la procédure, le rejet des demandes de grâce et les conditions carcérales déplorables peuvent faire de leur vie un calvaire. Néanmoins, l’année 2019 n’a pas été totalement négative. Le soutien à la peine de mort semble s’amenuiser dans certains pays de la région, qui ont pris des mesures ou fait des annonces susceptibles d’aboutir à l’abolition de ce châtiment. En République centrafricaine, l’Assemblée nationale a pris la décision d’examiner une proposition de loi sur l’abolition de la peine capitale. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema a annoncé qu’il présenterait un projet de loi abolitionniste au Parlement. En Gambie, la Commission de révision de la Constitution a publié en novembre un projet de texte ne contenant plus aucune disposition relative à la peine capitale. Au Kenya, l’équipe spéciale chargée d’examiner la question de la peine de mort obligatoire a recommandé que le Parlement abolisse totalement ce châtiment, tandis que les autorités zimbabwéennes y réfléchissaient sérieusement. La peine de mort est une violation du droit à la vie et constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. L’opposition à la peine capitale n’est pas synonyme de tolérance à l’égard de la criminalité. En effet, toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale dûment reconnue par la loi à l’issue d’un procès équitable doit être tenue pour responsable, sans jamais encourir la peine de mort. Il faut évidemment que les États combattent les maladies mortelles, y compris le COVID-19, mais aussi qu’ils protègent le droit à la vie en abolissant la peine capitale. Cet article a initialement été publié par The Daily Maverick.  Par Oluwatosin Popoola, Amnistie internationale - Conseiller relatif à la peine de mort 11 avril 2019, 17:11 UTC D’après un récent rapport d’Amnistie internationale, le recours à la peine de mort diminue en Afrique subsaharienne. Cette bonne nouvelle confirme que la région continue de se détourner de ce châtiment, le plus cruel qui soit. Sur les 29 pays d’Afrique subsaharienne qui maintiennent ce châtiment dans leur législation, seuls quatre, le Botswana, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud, ont procédé à des exécutions en 2018. Alors que le Botswana et le Soudan, qui n’avaient exécuté aucun condamné en 2017, ont repris les exécutions l’an dernier, le nombre total d’exécutions recensées dans la région est passé de 28 en 2017 à 24 en 2018. Cette baisse s’explique surtout par la situation en Somalie, habituellement au premier rang des pays procédant à des exécutions en Afrique subsaharienne, où l’on a constaté une diminution en 2018 par rapport à 2017. La présence de ces quatre États sur la liste des pays de la région ayant procédé à des exécutions n’est guère surprenante, car ils sont connus pour leur attachement à la peine de mort et ont appliqué régulièrement des sentences capitales au cours de la dernière décennie. En revanche, la forte hausse des exécutions au Soudan du Sud est très inquiétante : l’an dernier, le pays a exécuté sept personnes, le chiffre le plus élevé depuis qu’il a accédé à l’indépendance en 2011, et il a déjà dépassé ce triste record en exécutant huit condamnés au cours du premier trimestre 2019. Bien que 17 pays en Afrique subsaharienne aient prononcé des peines de mort en 2018, huit d’entre eux sont abolitionnistes en pratique, car ils n'ont procédé à aucune exécution au cours des 10 dernières années et semblent avoir pour politique ou pour pratique établie de s'abstenir de toute exécution. Fin 2018, au moins 4 241 personnes se trouvaient sous le coup d’une condamnation à mort en Afrique subsaharienne. Chacune avec sa propre histoire, rappelant que des milliers de personnes risquent de manière imminente de se voir ôter la vie par l’État. C’est notamment le cas de Magai Matiop Ngong, âgé de 17 ans ; en 2017, il a été condamné pour meurtre au Soudan du Sud, à l’issue d’un procès au cours duquel il n’a pas bénéficié des services d’un avocat et alors qu’il affirme qu’il s’agissait d’un accident. Durant ce procès, Magai a déclaré au juge qu’il n’avait que 15 ans, mais son âge n’a pas été pris en compte. Lors même qu’il est strictement interdit d’appliquer la peine capitale à des mineurs au titre du droit sud-soudanais et de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, Magai a été condamné à mort. Enfermé à la prison centrale de Djouba en attendant le résultat de sa procédure d’appel, Magai a déclaré : « Je ne me sens pas bien du tout car personne ne veut mourir. Savoir que je vais mourir, ça me rend malheureux. J’espère que je pourrai sortir et continuer l’école. » Si l’usage croissant de la peine de mort au Soudan du Sud fait planer le risque d’une exécution sur des dizaines de personnes comme Magai, d’autres pays tels que le Burkina Faso et la Gambie choisissent d’emprunter un autre chemin. Au Burkina Faso, la peine de mort a été supprimée du nouveau Code pénal, entré en vigueur au mois de juin. Ce châtiment est maintenu pour les crimes exceptionnels qui relèvent de la législation militaire, mais il est désormais aboli pour les crimes de droit commun. En outre, une disposition interdisant expressément la peine capitale a été intégrée aux propositions de révision de la Constitution qui pourraient être adoptées cette année. En Gambie, le président Adama Barrow continue de traduire en actes son engagement à débarrasser son pays de la peine de mort. En février 2018, il a annoncé la mise en place d’un moratoire officiel sur les exécutions. En septembre, le pays a ratifié le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), visant à abolir la peine de mort, devenant ainsi le 86e État partie à ce traité international, qui engage la Gambie à ne pas procéder à des exécutions et à prendre les mesures nécessaires en vue d’abolir la peine capitale. Il y a 40 ans, aucun pays en Afrique subsaharienne n’avait aboli ce châtiment cruel pour tous les crimes. Aujourd’hui, ils sont 20 dans la région à l’avoir fait. Il est permis d’espérer qu’avant longtemps, le Burkina Faso et la Gambie les rejoindront et que d’autres suivront. Bien qu’une minorité d’États freine la région, l’Afrique subsaharienne est en chemin vers l’abolition totale de la peine de mort ; si la trajectoire est lente, elle a le mérite d’être constante. Cet article a initialement été publié par La Libre Afrique.  Par Oluwatosin Popoola, Conseiller relatif à la peine de mort 10 avril 2019, 01:01 UTC « Je souhaite à AI de progresser et de rencontrer le succès dans son travail. La visite que vous nous avez rendue nous a fait plaisir et montre qu’AI est fiable et qu’on peut compter sur elle pour le combat pour les droits des personnes. » -- Jules Hohoutou Zinsou, ancien prisonnier condamné à mort En 2014, le sort tragique de 14 prisonniers condamnés à mort dans le petit État du Bénin, en Afrique de l’Ouest, a attiré mon attention. D’après les informations dont disposait Amnistie internationale, 14 hommes – 10 Béninois, deux Nigérians, un Togolais et un Ivoirien – se trouvaient encore dans le quartier des condamnés à mort au Bénin. On savait toutefois peu de choses au sujet de ces hommes maintenus dans le quartier des condamnés à mort, alors que le Bénin était partie à un traité international interdisant les exécutions judiciaires dans le pays et l’engageant à abolir la peine capitale. Cela faisait plus de vingt ans que ces hommes avaient été condamnés à mort et qu’ils étaient détenus dans des conditions lamentables. Ils se trouvaient dans une situation totalement incertaine : ils ne pouvaient pas être exécutés en raison des obligations du Bénin découlant de ce traité, mais ils étaient tout de même maintenus dans le quartier des condamnés à mort, où ils subissaient toutes les éprouvantes conséquences de ce statut. En mai 2016, j’ai fait partie d’une délégation d’Amnesty International qui est allée au Bénin et qui a rendu visite à ces hommes, rencontré les autorités et plaidé pour la commutation de leurs peines capitales. À la suite de cette visite, en janvier 2017, Amnistie a publié un rapport attirant l’attention sur la situation très difficile de ces hommes et appelant les autorités à commuer leurs sentences capitales. Quelques mois plus tard, en juillet 2017, une pétition a été lancée, renouvelant notre appel en faveur d’une commutation et intensifiant la pression exercée sur les autorités pour qu’elles y procèdent. Plus de 3 000 militants d’Amnistie ont signé cette pétition. En février de l’an dernier, notre travail de plaidoyer a porté ses fruits : le président béninois a commué les peines de mort de ces hommes en peines d’emprisonnement à perpétuité. À la fin du mois de juillet, pour la deuxième fois, je suis allé rendre visite, avec des collègues d’AI Bénin, aux 14 hommes emprisonnés. Cette fois, les peines de mort et l’incertitude qui planaient au-dessus de ces hommes au cours de ma précédente visite avaient disparu. Bien qu’ils soient toujours en prison, ils ont été libérés des entraves de la peine capitale et leur droit à la vie a été rétabli. Quand ils sont entrés, l’un après l’autre, dans la salle des visites de la prison d’Akpro-Missérété, certains d’entre eux ont souri en voyant la délégation d’Amnesty. Ils ont remercié Amnistie pour son travail de plaidoyer en faveur de la commutation de leurs peines de mort. Saibou Latifou a déclaré : « Nous remercions Amnistie internationale, sans vous nous serions toujours sous le coup d’une condamnation à mort. Nous sommes heureux de ne plus être des condamnés à mort. Un autre homme, Christophe Yaovi Azonhito, nous a dit : « Vous dire merci, ce n’est pas assez par rapport à tout ce qu’Amnistie internationale a fait pour nous. Nous vous demandons de faire part de notre gratitude aux membres d’AI dans le monde entier. » Le quartier de la prison réservé aux condamnés à mort, où ces hommes étaient enfermés depuis des années, a été transformé en dortoir pour la population carcérale générale. Après de nombreuses années d’isolement et de souffrance dans le quartier des condamnés à mort, les 14 hommes vivent à présent avec les autres prisonniers, ils peuvent participer aux activités récréatives et trois d’entre eux ont été nommés chefs de chambrée par les autorités de la prison. Quand j’ai dit au revoir aux 14 hommes et suis sorti de la prison, j’ai ressenti un fort sentiment du devoir accompli. Cela m’a encouragé de voir que le travail d’Amnistie débouche sur des résultats positifs, et j’espère que la peine de mort sera dans peu de temps de l’histoire ancienne partout dans le monde. 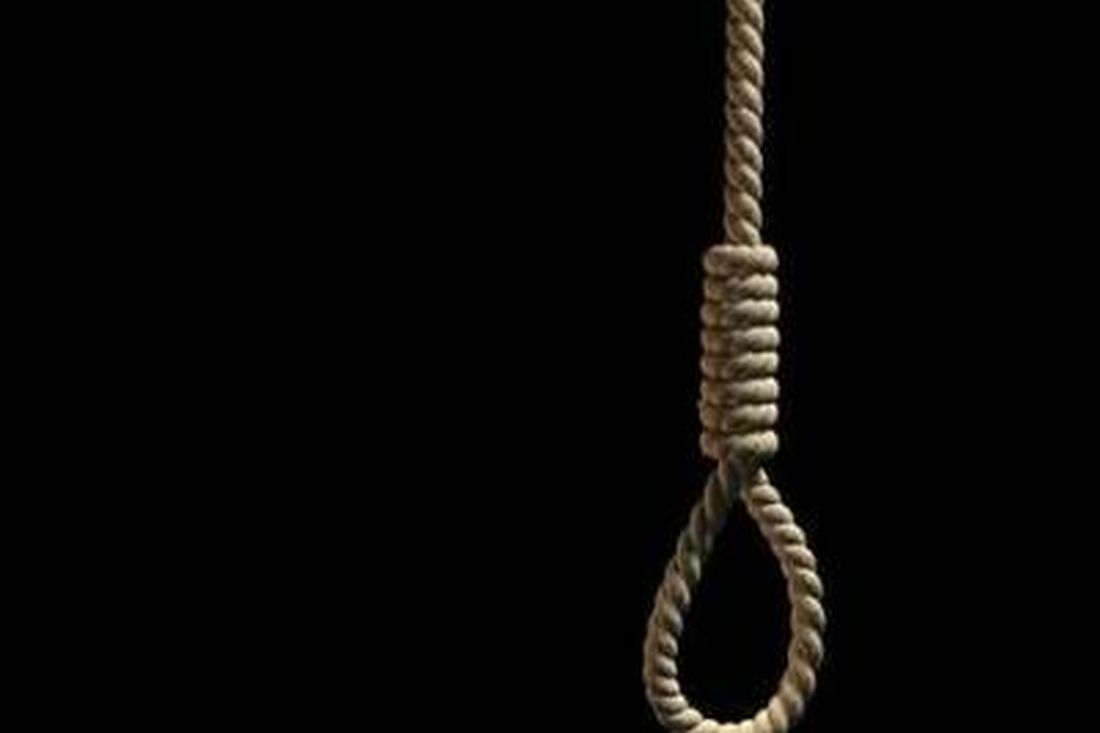 En Afrique du Nord, seule l’Égypte a procédé à des exécutions en 2017. La Tunisie, l’Algérie, et le Maroc et le Sahara occidental n’ont pas mis de prisonnier à mort depuis le début des années 90. Aucun de ces pays ne s’est cependant engagé à abolir la peine capitale en droit. Diverses dispositions juridiques dans chacun de ces États continuent à prévoir la peine de mort, ce qui va à l’encontre de la tendance internationale vers l’abolition de ce châtiment et vers le respect du droit à la vie. Si aucune exécution n’a eu lieu en Tunisie depuis 1991, Amnistie internationale a cependant recensé 25 condamnations à mort prononcées par les tribunaux à l’issue de procès en relation avec la sécurité nationale, contre 44 en 2016, ce qui semble indiquer une tendance à la baisse. À la fin de l’année 2017, au moins 77 personnes se trouvaient sous le coup d’une sentence capitale en Tunisie. En 2017, l’organisation a répertorié 27 condamnations à mort en Algérie, moins que les 50 recensées en 2016. Mais l’ampleur véritable de l’imposition de ce châtiment en Algérie n’est pas connue, les données officielles n’étant pas divulguées par les autorités. Quant au Maroc et au Sahara occidental, les tribunaux ont, selon des informations fournies par le gouvernement, prononcé au moins 15 condamnations à mort en 2017, contre au moins six en 2016. Quelque 95 personnes étaient sous le coup d’une sentence capitale à la fin de l’année 2017. « Les États de la région continuent de prendre des mesures en vue de limiter le recours à la peine capitale ou d’abolir ce châtiment alors que l’année 2018 est déjà bien entamée, et les derniers pays du monde qui procèdent encore à des exécutions se trouvent d’autant plus isolés », a déclaré Salil Shetty, secrétaire général d’Amnistie internationale. « Maintenant que 20 pays d’Afrique sub-saharienne ont aboli la peine de mort pour toutes les infractions, il est grand temps que le reste du monde suive leur exemple et renonce à ce châtiment abject et d’un autre âge. » Ailleurs sur le continent, une baisse du nombre de pays procédant à des exécutions a été constatée en Afrique sub-saharienne (deux en 2017 contre cinq en 2016) : seuls le Soudan du Sud et la Somalie ont semble-t-il ôté la vie à des condamnés l’an dernier. Le Botswana et le Soudan ont selon certaines informations repris les exécutions en 2018, mais Amnistie internationale souligne que cela ne doit pas éclipser les mesures positives prises par d’autres pays de la région. Des progrès considérables partout Si Amnistie internationale a fait état d’une baisse du recours à la peine de mort au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2017 par rapport à 2016, l’Égypte a prononcé la plupart des condamnations à ce châtiment dans cette région. Au moins 402 personnes ont été condamnées à mort par des tribunaux de droit commun et des tribunaux militaires à l'issue de procès collectifs d'une iniquité flagrante, contre 237 en 2016. En Égypte, les condamnations à mort enregistrées ont augmenté d’environ 70 % par rapport à 2016. Par ailleurs, certains pays, qui sont pourtant d’ardents défenseurs de la peine de mort, ont pris des mesures visant à limiter son imposition. En Iran, les exécutions recensées ont baissé de 11 % et la proportion d’exécutions consécutives à des infractions liées aux stupéfiants a été ramenée à 40 %. Des démarches ont également été entreprises pour relever le seuil à partir duquel la possession de stupéfiants entraînait obligatoirement une condamnation à mort. En Malaisie, la législation relative aux stupéfiants a été modifiée de sorte que le choix de la peine soit laissé à la discrétion des juges dans les affaires de ce type. Ces changements contribueront probablement à réduire le nombre de condamnations à mort prononcées dans ces deux pays. « Le fait que des pays continuent d’avoir recours à la peine de mort pour des infractions liées aux stupéfiants demeure inquiétant. Néanmoins, les mesures prises par l’Iran et la Malaisie pour modifier leur législation relative aux stupéfiants sont le signe que des failles apparaissent, même dans la minorité de pays qui continuent de procéder à des exécutions », a déclaré Salil Shetty. « En dépit des grandes avancées vers l’abolition de ce châtiment abject, quelques dirigeants continuent de recourir à la peine de mort comme solution de fortune plutôt que de traiter les problèmes à la racine grâce à des politiques humaines, efficaces et fondées sur des éléments concrets. Un dirigeant fort promeut la justice et non la peine capitale », a déclaré Salil Shetty. Le nombre de pays procédant à des exécutions n’a pas changé. Cependant, Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Jordanie et le Koweït ont repris les exécutions après une période d’interruption. L’avenir Sachant qu’au moins 21 919 personnes dans le monde sont sous le coup d’une condamnation à mort, ce n’est pas le moment de relâcher la pression. Des mesures positives ont été prises en 2017 et leurs effets ne se feront pleinement sentir que dans les mois et les années à venir. Toutefois, certains pays font marche arrière – ou menacent de le faire – et il est donc toujours aussi essentiel de faire campagne contre la peine de mort. Amnistie internationale demande aux autorités en Algérie, au Maroc/Sahara occidental, et en la Tunisie de commuer toutes les condamnations à mort, dans l’objectif d’abolir la peine capitale. « Depuis 40 ans, nous assistons à un changement important et encourageant des perspectives mondiales relatives à la peine de mort, mais il est nécessaire de prendre des mesures plus immédiates pour mettre un terme à la pratique terrifiante des homicides d’État », a déclaré Salil Shetty. « La peine capitale s’inscrit dans une culture marquée par la violence, sans apporter de remède à ce fléau. Nous savons qu’en mobilisant des personnes des quatre coins de la planète, nous pouvons lutter contre la peine de mort et mettre fin à ce châtiment cruel partout dans le monde. »  Téléchargez la version PDF ( Lire ) Le 11 décembre 1977, Amnistie internationale et les participants à la Conférence internationale sur l'abolition de la peine de mort ont adopté la Déclaration de Stockholm – le premier manifeste international abolitionniste − qui appelle tous les gouvernements à abolir immédiatement et totalement la peine de mort. À l'époque, seuls 16 pays avaient aboli la peine capitale pour tous les crimes. Quarante ans plus tard, ils sont 105 à l'avoir fait. Il ne faut pas que 40 autres années s'écoulent avant que ce châtiment disparaisse complètement. AFRIQUE SUBSAHARIENNE Quand Amnistie internationale a commencé à faire campagne pour l’abolition de la peine de mort dans le monde entier, en décembre 1977, aucun pays d’Afrique subsaharienne n’avait totalement aboli ce châtiment. Quatre décennies plus tard, des avancées encourageantes ont été réalisées en direction de cet objectif dans la région. En 1987, un seul pays seulement, le petit archipel du Cap-Vert, avait adopté cette mesure. Toutefois, les choses se sont ensuite accélérées : au cours de la décennie qui a suivi, neuf pays ont abandonné ce châtiment cruel. La Côte d'Ivoire illustre bien le parcours suivi par de nombreux pays africains abolitionnistes. Cet État a été abolitionniste en pratique pendant plusieurs décennies, ce châtiment restant prévu par sa législation. Le premier président du pays, Félix Houphouët-Boigny, qui a dirigé le pays à partir de l'indépendance dupays, en 1960, et jusqu'en 1993, était opposé à la peine de mort et il n'a jamais autorisé son application. Des condamnations à mort ont été prononcées pendant des années, mais aucune exécution n'a eu lieu. Le gouvernement a rejeté une tentative d'élargissement du champ d'application de ce châtiment en 1995. Les groupes d'Amnistie internationale en Côte d'Ivoire ont fait campagne pendant des années pour l'abolition, et quand le gouvernement du général Robert Guéï est arrivé au pouvoir et a décidé de rédiger une nouvelle constitution, ils ont saisi cette occasion. Ces groupes ont fait pression en faveur de l'abolition au cours de la phase de rédaction de la nouvelle constitution. Et leurs efforts ont payé : en 2000, une nouvelle constitution a été adoptée par référendum, dont l'article 2 abolit expressément la peine de mort. Des tribunaux ont joué un rôle essentiel sur le chemin de l'abolition. En 1995, la Cour constitutionnelle sud-africaine a déclaré que le fait de prononcer une condamnation à mort pour meurtre était incompatible avec l’interdiction des « traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants » inscrite dans la Constitution. Huit des 11 juges ont par ailleurs estimé que la peine de mort constitue une violation du droit à la vie. Cet arrêt a de fait aboli le recours à la peine de mort pour meurtre. Ensuite, en 1998, le Parlement sud-africain a totalement supprimé la peine capitale dans la législation du pays. Plus récemment, en 2016, un arrêt de la Cour constitutionnelle béninoise a de fait aboli la peine de mort pour tous les crimes au Bénin. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'est érigée en rempart contre ce châtiment en adoptant sa première résolution contre la peine de mort en 1999. En 2015, elle a adopté le projet de protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à l’abolition de la peine de mort en Afrique. Ce projet de protocole n'a pas encore été formellement adopté par l'Union africaine, mais il représente une avancée notable en vue de l'abolition. PAYS ABOLITIONNISTES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET ANNÉE DE L'ABOLITION POUR TOUS LES CRIMES CAP VERT 1981 MOZAMBIQUE 1990 NAMIBIE 1990 SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 1990 ANGOLA 1992 GUINÉE-BISSAU 1993 SEYCHELLES 1993 DJIBOUTI 1995 MAURICE 1995 AFRIQUE DU SUD 1997 CÔTE D’IVOIRE 2000 SÉNÉGAL 2004 RWANDA 2007 BURUNDI 2009 TOGO 2009 GABON 2010 CONGO (RÉPUBLIQUE DU) 2015 MADAGASCAR 2015 BÉNIN 2016 CAS EMBLÉMATIQUES Les « Six de Sharpeville », Afrique du Sud En décembre 1985, six personnes – Mojalefa Reginald Sefatsa, Oupa Moses Diniso, Reid Malebo Mokoena, Theresa Ramashamola, Duma Joshua Khumalo et Francis Don Mokhesi – appelées les « Six de Sharpeville », ont été déclarées coupables et condamnées à mort pour le meurtre, commis en septembre 1984, d'un conseiller municipal de Sharpeville par une foule qui protestait contre la hausse des loyers. Au cours de leur procès, certains des accusés ont déclaré qu'ils avaient été attaqués et torturés par des policiers pendant leur détention au secret. La cour a toutefois rejeté ces allégations. En décembre 1987, une cour d'appel a confirmé ces déclarations de culpabilité et ces condamnations, et pris une décision contestée en estimant que la condamnation à mort de ces six personnes pour meurtre sur la base d'un « objectif commun » avec l'« attroupement » était appropriée. En mars 1988, le recours en grâce déposé par les « Six de Sharpeville » a été rejeté par le président P. W. Botha. De plus, le recours en appel qu'ils ont introduit pour être rejugés a également été rejeté. Amnistie internationale a intensivement mené campagne pour obtenir la commutation de leur peine de mort. Finalement, le 23 novembre 1988, le président Botha a commué les sentences capitales en peines de 18 à 25 ans d'emprisonnement. Les « Six de Sharpeville » ont été libérés de prison séparément entre 1991 et 1992. https://www.amnesty.org/fr/documents/pol10/0002/1989/fr/. Meriam Yehya Ibrahim, Soudan « Le fait de savoir que des gens du monde entier se tenaient à mes côtés m'a redonné espoir. » Meriam Yehya Ibrahim a été inculpée d'adultère en 2013. Des proches l'ont dénoncée aux autorités parce qu'elle s'était mariée avec un chrétien. Aux termes de la charia telle qu'elle est appliquée au Soudan, une musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman, et tout mariage de la sorte est considéré comme un adultère. Meriam Yehya Ibrahim a été arrêtée en février 2014 après que le tribunal eut ajouté l'apostasie aux chefs d'inculpation quand elle a informé la justice qu'elle avait été élevée par sa mère dans la foi chrétienne orthodoxe. En mai 2014, le tribunal lui a donné trois jours pour renoncer à sa foi chrétienne sous peine d'être condamnée à mort. Meriam Yehya Ibrahim a rejeté cette possibilité. Elle a en conséquence été condamnée à mort pour apostasie, et à la flagellation pour adultère. Au moment de son procès, Meriam Yehya Ibrahim était enceinte de huit mois, et en mai 2014 elle a accouché de son deuxième enfant dans la prison pour femmes d'Omdurman. Son bébé a été détenu avec elle. Amnistie internationale a intensivement mené campagne en faveur de Meriam Yehya Ibrahim, demandant qu'elle soit libérée immédiatement et sans condition. Cette affaire a attiré l'attention de la communauté internationale, et plus d'un million de personnes ont soutenu l'appel d'Amnistie internationale, adressé aux autorités soudanaises, réclamant sa libération. Le 23 juin, Meriam Yehya Ibrahim a été libérée de prison après l'annulation de sa condamnation en appel. L'apostasie reste sanctionnée par la peine de mort au Soudan. https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2014/06/sudanreleases-woman-condemned-death-after-internationalpressure/. Moses Akatugba, Nigeria « Ce lieu [le quartier des condamnés à mort] est un enfer […] Je suis bouleversé, je remercie Amnistie internationale et ses militants pour leur énorme soutien qui m'a permis de me sortir de cette situation. » Moses Akatugba avait 16 ans et il attendait les résultats de ses examens de fin d'études secondaires lorsqu’il a été arrêté par la police en 2005 pour vol à main armée, une infraction qu’il nie avoir commise. Il a expliqué à Amnistie internationale que des policiers l’avaient battu à plusieurs reprises à coups de machette et de matraque, et qu’ils l’avaient ligoté et suspendu pendant plusieurs heures, avant de lui arracher les ongles des pieds et des mains. Ils l'ont ensuite forcé à signer deux déclarations d'« aveux » prérédigées. En novembre 2013, après avoir passé huit années derrière les barreaux, Moses a été condamné à la mort par pendaison. Le droit international relatif aux droits humains interdit strictement de recourir à la peine de mort contre une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment des faits qui lui sont reprochés. Amnistie internationale a pris en charge le cas de Moses Akatugba, demandant aux autorités nigérianes de commuer sa peine de mort et d'enquêter sur ses déclarations concernant les actes de torture commis par la police. Plus de 35 000 militants d'Amnistie internationale sont intervenus en faveur de Moses. Le 28 mai 2015, la veille de sa cessation de fonctions, Emmanuel Uduaghan, le gouverneur de l'État du Delta au Nigeria, a totalement gracié Moses. https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/05/nigeriapardoned-torture-victim-overwhelmed-by-campaign-tospare-his-life/. PASSEZ À L’ACTION Agissez en faveur des détenus abandonnés à leurs souffrances dans le quartier des condamnés à mort au Bénin Quatorze personnes au Bénin sont maintenues dans le quartier des condamnés à mort alors que la Cour constitutionnelle a de fait aboli la peine de mort pour tous les crimes. Agissez ! https://www.amnesty.org/fr/get-involved/takeaction/prisoners-still-on-death-row-in-benin/.  Depuis quelques années, l’Afrique subsaharienne offre une lueur d’espoir, en se démarquant par des évolutions positives sur la question de l’abolition de la peine de mort. Néanmoins, l’année 2016 a été un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles. Une tribune de Oluwatosin Popoola, chargé de plaidoyer et conseiller sur la peine de mort à Amnistie internationale. Au cours de la semaine du 10 avril 2017, Amnistie internationale a publié l’édition 2016 de son rapport sur la peine de mort dans le monde. Dans ce document, l’organisation indique que 23 pays ont exécuté au moins 1 032 personnes à eux tous. En excluant la Chine, qui a ôté la vie à davantage de personnes que tous les autres pays réunis, 87 % des exécutions se sont déroulées en Iran, en Arabie saoudite, en Irak et au Pakistan. L’année 2016 a été un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles. Du côté positif, le nombre d’exécutions enregistrées a baissé de manière considérable, passant de 43 en 2015 à 22 en 2016, soit un recul de 49 %. En outre, deux pays ont aboli la peine de mort. En janvier 2016, la Cour constitutionnelle béninoise a statué, dans le but de se conformer aux obligations internationales incombant au Bénin en matière de droits humains, que toutes les lois prévoyant le recours à la peine de mort étaient nulles et qu’il était désormais impossible d’infliger ce châtiment. Cette décision historique a permis d’abolir effectivement la peine capitale. Plus tard dans l’année, la Guinée a adopté un nouveau code pénal, qui a supprimé la possibilité de recourir à la peine de mort pour les crimes de droit commun. En vertu du Code militaire, il demeure toutefois possible d’infliger ce châtiment en cas de crime d’une gravité exceptionnelle, mais l’Assemblée nationale examine actuellement un projet de loi visant à éliminer toutes les dispositions y afférentes. Ces évolutions positives observées au Bénin et en Guinée s’inscrivent dans la tendance amorcée en 2015 par Madagascar et la République du Congo, qui ont relégué la peine de mort aux oubliettes. En Afrique subsaharienne, l’abolition suit un rythme régulier et prometteur. En 1977, lorsque Amnistie internationale a commencé à faire campagne et à plaider en faveur de l’abolition de la peine de mort dans le monde, aucun pays d’Afrique subsaharienne n’avait aboli ce châtiment pour toutes les infractions. À ce jour, 19 l’ont fait. Autre point positif, des centaines de condamnés à mort ont vu leur peine commuée en 2016 au Kenya, au Nigeria, au Ghana, en Mauuritanie et au Soudan. Au Kenya, l’ampleur de cette mesure a été remarquable : le président Uhuru Kenyatta a commué la peine des 2 747 prisonniers qui se trouvaient alors sous le coup d’une condamnation à mort. Le pays n’a procédé à aucune exécution depuis 30 ans et cette décision ne fait que l’éloigner encore davantage de la peine de mort. À l’inverse, deux pays qui avaient suspendu les exécutions depuis 2013 les ont reprises. Le Botswana a ôté la vie à un condamné en 2016 et, en décembre, trois prisonniers ont été exécutés de façon soudaine au Nigeria (État d’Edo). L’an dernier, une tendance extrêmement inquiétante s’est fait jour en Afrique subsaharienne : le nombre de condamnations à mort prononcées est monté en flèche, bien que le nombre de pays ayant infligé ce châtiment soit passé de 21 en 2015 à 17 en 2016. Le nombre de condamnations à mort prononcées dans l’ensemble de la région a ainsi augmenté de 145 % (1 086 condamnations à mort confirmées en 2016 contre 443 en 2015). Cette évolution considérable s’explique essentiellement par la forte hausse enregistrée au Nigeria, où les tribunaux ont condamné à mort 527 personnes, ce qui représente le chiffre le plus élevé d’Afrique. Au vu du grand nombre de condamnations à mort prononcées dans ce pays, il est à craindre que des innocents soient exécutés, étant donné que les déclarations de culpabilité sont souvent douteuses. Ainsi, rien qu’en 2016, les tribunaux ont disculpé 32 personnes qui avaient été déclarées coupables à tort. La peine de mort est une violation du droit à la vie et constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit ; il n’a pas sa place dans le monde moderne. Conscients de cela, 104 pays du monde entier, soit la majorité, ont aboli la peine capitale pour toutes les infractions. Il est temps que les pays d’Afrique subsaharienne ne l’ayant pas encore fait suivent cet exemple. Il n’y a aucune raison que, dans un avenir proche, la région n’ait pas totalement abandonné la peine de mort. Cette tribune a été publiée initialement dans Mail & Guardian online. |
Centre de presseLe centre de presse du Secrétariat international met à la disposition des professionnels et du grand public des nouvelles de dernière minute, des commentaires de spécialistes et des informations importantes sur la situation dans le monde relative à la peine de mort. Archives
Janvier 2023
Catégories
Tous
|
Amnistie internationale Canada francophone - Abolition de la peine de mort - Tél. : 819-944-5157
Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca
Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca

 Flux RSS
Flux RSS
